
|
| |
| Musique, Pouvoirs, Politiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Musique officielle et citoyenneté dans la fièvre de 1848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrick Peronnet | Résumé | Mots-clés | Sommaire | Texte | Auteur | Annexes | Notes | Références | Outils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RÉSUMÉ
1848 inaugure la brève expérience de la IIe République. En une petite année, l’alternance heurtée d’éphémères formes de régimes montre les ruptures et la continuité de la musique et particulièrement des musiques officielles d’État instrumentalisées. Besoin de liberté, contestation, militantisme, utopies, climat insurrectionnel, réaction bourgeoise, bilan victimaire, remise en cause et reprise en main autoritaire trouvent dans la musique entendue et les débats engendrés, un formidable écho lorsque l’on s’intéresse à l’histoire culturelle de la France au cœur du xixe siècle. Écouter la musique officielle ou citoyenne devient révélateur d’une société et de ses hésitations. Le son des rues, le silence des salles de théâtre, les débats esthétiques et sociaux, les engagements individuels ou collectifs, du civil ou du militaire, la musique officielle ou citoyenne, tout concourt à donner une image plurielle d’une société française en quête identitaire. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Index historique : xixe siècle ; 1848 ; IIe République |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mourir pour la Patrie
C’est le sort le plus beau Le plus digne d’envie ! [1] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La révolution de février 1848 a mis fin à la monarchie de Juillet et inauguré la brève expérience de la Deuxième République. Quatre mois après cet immense espoir, l'armée et les gardes mobiles ont brisé l'insurrection des ouvriers et artisans parisiens. Pendant plusieurs jours, la République a bombardé et massacré les insurgés, tuant plusieurs milliers d'entre eux. L’adoption de la Constitution en novembre permet l’élection de Louis-Napoléon Bonaparte comme président de la République française et ouvre la voie au césarisme, puis à l’Empire. Deux temps de silence marquent l’année 1848. En définissant le silence, Marc Pincherle écrit qu’en lexicologie musicale, il s’agit d’un « signe indiquant que telle partie instrumentale ou vocale se tait, en précisant la durée de cette inaction [2] ». En février et juin 1848, et à chaque fois dans les semaines subséquentes, les théâtres lyriques sont fermés. S’il s’agit d’un soupir en février, c’est une pause qui s’impose en juin. Dans ces périodes d’incertitude et d’inquiétude, tous les espoirs sont permis dans l’expression d’une diversité politique ouverte, allant du réactionnaire au révolutionnaire, du réformisme au conservatisme, effleurant même l’anarchisme naissant. Ces temps confus sont aussi ceux d’une crise économique. Les temps agités ont pour parallèle la non-dépense et la non-consommation. La volonté d’un retour à la normalité est plus une injonction qu’une réalité. Entre musique, pouvoirs et politique, 1848 s’incarne comme la Révolution retrouvée et perdue [3]. Mais qu’en est-il du son et de la musique ? Malgré les affirmations d’Henri Blanchard, 1848 n’est pas vraiment l’année où « l’art musical s’est tu [4] ». Qu’entend-on dans ces temps de silence imposés au monde musical, ou, plutôt, lyrique ? Les journaux spécialisés et leur maigreur disent bien le désarroi. La suspension de leurs publications pendant les journées révolutionnaires montre bien ce temps où même la critique reste sans voix. Il nous faut donc faire silence pour mieux écouter ce que les musicographes du temps n’ont voulu entendre. I. La Révolution par le son Peuple français, connais ta gloire; Les journées révolutionnaires se déroulent à Paris du 22 au 25 février 1848. Sous l'impulsion des libéraux et des républicains et suite à une fusillade, le peuple de Paris se soulève, appuyé par des gardes nationaux, et parvient à prendre le contrôle de la capitale. Louis-Philippe est contraint d'abdiquer en faveur de son petit-fils le 24 février. Les révolutionnaires proclament la Deuxième République le 25 février 1848 et mettent en place un Gouvernement provisoire républicain, mettant ainsi fin à la monarchie de Juillet. Des journées révolutionnaires elles-mêmes nous retiendrons un épisode tragi-comique. Le 23 février 1848, un bataillon du 14e régiment d’infanterie de ligne barre le boulevard des Capucines pour protéger le chef du gouvernement, François Guizot, réfugié au Ministère des Affaires étrangères. Musique en tête, le 14e forme le carré. Vers 21 h, des manifestants essaient de rompre le barrage. Assaillis par les révolutionnaires menés par des Gardes nationaux, la troupe fait feu et se replie en grande panique par une petite porte latérale. « Mais décidément l’Histoire en rajoute. Le préposé à la grosse caisse reste coincé dans l’étroite porte. Il crie « comme un brûlé », on le tire, on le pousse mais en vain. Le bouchon est en place, on ne passe plus. L’homme à la grosse caisse entrave à lui seul la fuite du bataillon [6]. » L’anecdote ne serait qu’amusante si on oubliait que le même 14e de ligne avait été l’auteur involontaire de la reprise des hostilités meurtrières dans cette soirée du 23 février 1848, faisant trente-cinq morts et une cinquantaine de blessés. La foule charge les cadavres dans un tombereau et appelle Paris aux armes. C’est le début de l’émeute populaire, ce qu’il est convenu d’appeler la Révolution de février 1848 qui met fin, le lendemain, au règne de Louis-Philippe. 1) Entre Marseillaise, Chant du Départ et air des Girondins, là où s’entend la Révolution Une révolution a toujours de quoi inquiéter les musiciens. Si le sentiment prime, l’économie impose de sérieuses inquiétudes. La fermeture temporaire des salles de spectacle met au chômage les interprètes et la disparition des référents-protecteurs du défunt régime inquiète les directeurs de salles nommés si ce n’est par corruption, au moins par subordination, et les compositeurs en recherche ou attente de commande. La tentation de s’expatrier momentanément (notamment en Angleterre) est grande pour les artistes dont la réputation est suffisante pour espérer un accueil quelconque à l’étranger. Ceux qui avaient trop reçu du pouvoir monarchique pouvaient au mieux être inquiets, au pire être inquiétés. La Revue et Gazette musicale de Paris, « qui ne s’occupe que de question d’art », témoigne d’une volonté d’apaisement et voudrait rassurer le monde des producteurs comme celui des consommateurs de musique. Trois journées nouvelles, non moins glorieuses, non moins pures, et bien plus fécondes en résultats immenses que celles que nous comptions déjà dans notre histoire [7], viennent de se dérouler sous nos yeux. Cette euphorie républicaine, trop optimiste, du directeur-gérant de la Revue et Gazette musicale de Paris, Pierre-Charles-Ernest Deschamps d’Hanneucourt, est cependant à mettre en parallèle avec une brève publiée en page 4 : « Tous les théâtres ont été fermés depuis mardi [9] ». Ce premier temps de silence ne serait inquiétant que s’il durait. Mais la voix du peuple n’a pas besoin de théâtre pour se faire entendre. Dans sa réflexion rétrospective sur le premier semestre de l’année 1848, le musicographe Maurice Bourges (1812-1881), grande plume de la Revue et Gazette musicale de Paris en fait un constat sincère. Au fait, le seul concert possible courait alors les rues, réduit, il est vrai, à un programme bien restreint, la Marseillaise, les Girondins, le Chant du Départ ; le Chant du Départ, les Girondins, la Marseillaise ; mais l’enthousiasme et le volume de sonorités gigantesques suppléaient la variété. Deux mois durant, la place de l’Hôtel-de-Ville, les abords du Luxembourg, le Champ-de-Mars, les boulevards, sillonnés de processions patriotiques furent transformés en salles immenses de concerts, vastes arènes, où le peuple était à la fois chanteur et auditeur [10]. Le gouvernement provisoire de la République, par l’intermédiaire de son ministre de l’Intérieur, Alexandre-Auguste Ledru-Rollin (1807-1874), tente une politique artistique et culturelle en réunissant une tumultueuse Assemblée générale des artistes sous la direction du peintre Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867). Face aux récriminations catégorielles du monde artistique, il est décidé de travailler par commission séparée. Celle des musiciens est censée s’emparer des nombreuses questions de l’enseignement de la musique, de sa décentralisation, de la condition des artistes des théâtres, des droits et pensions de retraite des « vieux musiciens », de la liberté d’expression et d’association. Remarquons que, toute parisienne, cette commission ne s’adresse nullement à la province dépourvue de tout représentant. Paris a pris l’habitude de faire et défaire seule les régimes politiques et les réformes. De fait, au fil des semaines, plutôt que de porter le sentiment d’union artistique et musicale de la nation, chacun ira porter ses doléances en rangs dispersés. À ce titre, le Conservatoire, directeur en tête, se sentant menacé comme institution, obtient d’un autre ministre, celui de l’Instruction publique et des Cultes, Lazare Hippolyte Carnot (1801-1888), une autre commission, séparée, devant « faire des propositions pour les améliorations qu’il serait possible d’y introduire ». Dans un temps parallèle, et afin de mieux organiser les réformes, le ministre de l’Intérieur, Ledru-Rollin, finit par nommer une direction des Beaux-arts comprenant deux sous-sections, celle des Musées nationaux et celle des Beaux-arts. Elle forme la 6e section du ministère de l’Intérieur en avril 1848 et Charles Blanc [11], le frère de Louis, en est nommé directeur. Cette tentative de « républicanisation » en période d’effervescence, fut l’occasion, pour certains, d’un engagement politique. C’est le cas de Jacques-Fromental Halévy (1799-1862). Lorsqu’il s’agit de proposer des candidats aux élections législatives complémentaires de juin, l’union des cinq associations des gens de lettres, auteurs dramatiques et artistes, auxquelles est venue se joindre l’association des artistes industriels, veut présenter ses propres candidats. Les regards des musiciens se tournent vers Halévy. Ce dernier, outre son prestige acquis sur les scènes parisiennes avec La Juive (livret d’Eugène Scribe, 1835) ou La Reine de Chypre (livret de Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges, 1841), est célébré en 1848 par la reprise populaire du chœur « La France a l’horreur du servage » encore nommé « Guerre aux Tyrans », extrait de l’opéra en cinq actes Charles VI (livret de Germain et Casimir Delavigne, 1841). Sans doute aussi fut-il influencé par son frère, Léon [12], lui-même très lié aux doctrines saint-simoniennes. Le discours improvisé d’Halévy, le 15 avril 1848, reprend les thèmes attendus de réformes rendues nécessaires par le temps : sanctuariser le Conservatoire tout en lui permettant une évolution pédagogique, maintenir l’idée des théâtres subventionnés tout en confiant leurs destinées à la République, militer pour un droit de retraite pour tous, synonyme d’un droit au repos, permettre la libre entreprise pour les théâtres secondaires et encourager des représentations gratuites pour l’éducation des masses. Halévy, emporté dans son élan, fait sa déclaration de foi : « Je n’étais pas républicain le 22 février. Mais quel citoyen n’est pas aujourd’hui loyalement, sincèrement républicain ? La République n’est-elle pas le dernier mot des Sociétés [13] ? » Sa candidature est d’abord proposée pour la députation en tant que représentant du département de la Seine à l’Assemblée nationale. Il y est le candidat de l’Association des artistes musiciens, aux côtés de Victor Hugo, candidat de la Société des auteurs dramatiques, qui, d’ailleurs, n’était pas plus républicain qu’Halévy en février 1848. Finalement ce sera sur la candidature d’Hugo que se portera le soutien des cinq associations à la veille du scrutin [14]. Surtout, les événements de février ont généré une crise économique que les actions et exhortations gouvernementales n’ont pu juguler. Dès le 14 mai, la Revue et Gazette musicale de Paris lance un cri d’alarme dans un article au titre évocateur : « Questions d’avenir pour les artistes musiciens [15] ». Maurice Bourges y évoque les musiciens « prolétaires » (c’est le mot qu’il utilise) au chômage depuis les événements de février : musiciens des théâtres, d’église, de bals, copistes, graveurs, luthiers, facteurs d’instruments, personnels des théâtres (machinistes, ouvreuses, contrôleurs, figurants, choristes, décorateurs, etc.) autant d’intermittents du spectacle qui ne portent pas encore ce nom, empêtrés dans des difficultés économiques engendrées par la Révolution elle-même. 2) Les signes audibles de la victoire républicaine et sociale Le recours à La Marseillaise ou au Chant du Départ, hymnes « révolutionnaires » tolérés mais jugés jusqu’alors séditieux, anime la Révolution nouvelle. Cette spontanéité à s’appuyer sur les héritages glorieux d’un passé pas si lointain (une soixantaine d’années) montre la fascination des républicains de 1848 vis-à-vis des révolutionnaires de 1789-1799 qui avaient su instrumentaliser la musique dans un sens identitaire et social. Le recours à l’imagerie révolutionnaire permet de réveiller des consciences ou simplement des souvenirs. L’usage du Chant des Girondins est là encore un rappel historique et littéraire. Les Girondins, drame écrit et joué au Théâtre-Historique (création le 3 août 1847), est une mise en scène du Chevalier de Maison-Rouge d’Alexandre Dumas et Auguste Maquet. De l'adaptation de son roman au théâtre, Dumas fait un véritable manifeste politique. Il compose alors sur une musique de Pierre-Joseph-Alphonse Varney (1811-1879) [16] ce chœur, qui deviendra une sorte d'hymne officieux pendant la Deuxième République sous le titre Chant des Girondins : Par la voix du canon d'alarmes, Mourir pour la patrie Succombons dans l'obscurité, Vouons du moins nos funérailles À la France, à sa liberté ! Populaire à souhait le Chant des Girondins rejoint pour un temps le panthéon des hymnes révolutionnaires, même si, dans une période de remise en cause, il est de bon ton que la rumeur s’attaque à tout, y compris à l’auteur du nouvel hymne. Les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons ont donné une vogue immense au Chant des Girondins. Dire qu’il est devenu en peu de jours aussi populaire que la Marseillaise, ne serait pas de l’exagération. Au service funèbre qui a été célébré samedi dernier en l’honneur des victimes des 22, 23 et 24 février, les musiques des diverses légions [de la Garde nationale] et les Orphéonistes ont fait entendre alternativement le chant de Rouget de l’Isle [sic] et l’hymne de M. Warnery [sic], qui est aujourd’hui l’expression la plus poétique du sentiment national. Il n’en fallait pas davantage pour que des envieux contestassent à l’habile chef d’orchestre du Théâtre-Historique la paternité de cette noble inspiration musicale. Nous devons protester contre cette odieuse calomnie, qui atteint dans son honneur un artiste aussi distingué par son caractère que par son talent [18].  Mourir pour la Patrie !!! (Choeur des Girondins), lithographie (h : 39,6 cm, l : 28,4 cm), Domaine public, Bibliothèque nationale de France Notice Gallica Ce sont les chœurs orphéoniques, constitués depuis une petite dizaine d’année, qui jouent le rôle de vecteur politico-musical dans les premiers mois de la nouvelle République, particulièrement les chœurs sans accompagnement. Né dans les années 1820-1830, l’orphéonisme a pour vertu de brasser les classes sociales entre ouvriers, employés et petite bourgeoisie, tout en contribuant par l’art à l’« éducation morale et civique » du peuple, sinon de la Nation. Et c’est bien au son de chœurs orphéoniques que s’est déroulée la Révolution de Février comme en témoigne Jules Lovy, rédacteur du Ménestrel. L’artiste et le dilettante ont salué avec joie l’ère nouvelle qui s’ouvre pour la France ; la République, cet énergique symbole de l’honneur national, a déjà inspiré les plus mâles accents à d’illustres compositeurs ; elle a produit un hymne sublime qui, depuis plus d’un demi-siècle, vibre dans toutes les âmes [référence à La Marseillaise]. Cette fois encore, un refrain patriotique, le Chant des Girondins, a présidé à l’héroïque lutte du peuple, chant de guerre avant le combat, hymne de triomphe après la victoire. Et quand la tâche des combattants était accomplie, c’est encore la musique qui est venue remplir une sainte mission, mission de calme et d’ordre au milieu d’une population palpitante. Honneur aux orphéonistes ! honneur à la Société lyrique des Enfants de Paris [19] ! Pendant trois nuits consécutives leurs harmonieuses patrouilles retentissaient dans nos rues, et mêlaient au trouble général un élément de confiance et de sécurité [20]. La réappropriation de La Marseillaise par le peuple révolté est soutenue par une série de trois articles du musicologue et compositeur Georges Kastner dans les colonnes de la Revue et Gazette musicale de Paris [21]. Il n’y a pas de triomphe populaire auquel la Marseillaise n’ait participé depuis la première heure de son apparition ; aussi l’histoire de la France nouvelle pourra-t-elle être un jour renfermée tout entière dans celle de ce chant célèbre. Que d’événements déjà ont été arrachés aux entrailles du destin par ces accents terribles qui remuent des nations, ébranlent des mondes et menace de changer la face de l’univers ! Née d’une première république, voici que la Marseillaise en enfante une seconde. Qui peut dire où s’arrêtera son influence sur les destinées de la mère-patrie [22] ? Si Kastner revient sur le « chant national et patriotique », c’est pour en défendre la paternité attaquée de Rouget de Lisle décédé en 1836. Mais une Marseillaise trop symbolique heurte un grand nombre de consciences, particulièrement en province. Un événement local, à Vendôme (Loir-et-Cher) dit assez bien en quoi La Marseillaise peut froisser les autorités « provisoires » de 1848. Ainsi, au cours de la fête célébrée à Vendôme (Loir-et-Cher), en l’honneur de la proclamation de la République, le commissaire du gouvernement provisoire, Germain Sarrut, s’écria : « Citoyens, je viens au milieu de vous proclamer la République, non seulement la République française, mais encore la République humanitaire. » Et, comme sur ces mots une musique militaire joua La Marseillaise, Sarrut reprit : « Je vous dis la République humanitaire et vous me répondez par La Marseillaise, cette sublime héroïde qui guida nos pères à la victoire et fit trembler les rois. Oh ! non ! ne crions plus aux armes, que la République soit une république de paix. Contre qui donc courrions-nous aux armes ? Bientôt il n’y aura plus de rois : bientôt l’Europe entière sera républicaine [23] ». Le journal républicain Le Progrès d’Indre-et-Loire témoigne d’une autre polémique, liée à l’interprétation de La Marseillaise par une musique militaire dans la cathédrale de Tours (Indre-et-Moire) et jugée déplacée par « ceux de la calotte ». Le journal « rappelle que les oreilles délicates des casuistes ne sont pas offensées par le cantique Allons, enfants de l’Évangile ! qu’on chantait alors sur le même air dans les églises de Tours » ou encore l’air du Chant du Départ affublé des paroles suivantes : La religion nous appelle La popularité des hymnes est bien réelle. L’éditeur Brandus publie d’ailleurs dans la foulée des événements un recueil « de luxe » des Chants patriotiques de la France [25]. Mais puisque le ton est donné, sans air ni parole appropriés aux événements précis de 1848, Carnot, ministre provisoire de l’Instruction publique et des Cultes lance un très officiel « Concours de chants nationaux » le 27 mars [26]. L’article 3 du règlement de ce concours précise : « Des médailles de bronze, décernées au nom de la République et l’honneur de l’exécution dans les fêtes nationales, sont les seules récompenses offertes aux concurrents [27] ». Huit cents poèmes et partitions seront recueillis et confiés à une commission ad hoc pour en primer les meilleurs. Hélas, et le monde musical ne s’y trompe pas, les « grandes plumes » ne se ruent pas sur l’écritoire pour composer l’hymne immortel de la Deuxième République. Il est vrai que nos auteurs et nos compositeurs en réputation semblent s’abstenir, et font de l’aristocratie artistique. Les premiers n’ont point encore fait une bonne pièce républicaine, et les seconds, malgré la lettre-prière que leur a adressé le ministre de l’instruction publique afin d’exciter leur verve créatrice à produire quelque chant national digne de la Marseillaise, en les dispensant de la gêne du concours qu’il a ouvert à ce sujet, n’ont pas même pu encore trouver un hymne patriotique comme celui de la Parisienne [28], mélodie empruntée à l’Allemagne, cependant, pour chanter les vertus guerrières de l’ex-roi [29]. Ce n’est qu’à la fin du mois de juillet suivant que la commission rend son Rapport à M. le Ministre de l’Instruction publique. Il comporte une liste d’œuvres recommandables et encense trois œuvres particulières. Trois de ces morceaux ont été déclarés hors ligne par le jury, savoir : l’Ode-symphonie, paroles et musique de M. Elwart [30] ; l’Hymne triomphal à la liberté, paroles de M. Fournier, musique de M. Ermel ; l’Hymne à la patrie, paroles de madame d’Altenheim-Soumet, musique de M. Jules Creste-Faulander [31]. Encore faut-il préciser qu’entre l’ouverture du « concours » et l’attribution des mentions par le jury, de sombres événements, sur lesquels nous reviendrons, s’étaient passés en juin 1848. Sans doute peut-on mieux comprendre alors les propos de Jacques Gabriel Prod’homme (1871-1956) dans son étude sur La Musique et les Musiciens en 1848. Si la musique n’a pas joué, en 1848, un rôle aussi important que dans les révolutions précédentes, et surtout la première, ce rôle a néanmoins été très appréciable et n’est pas indigne d’intéresser l’historien de notre art. Sous toutes ses formes, depuis la romance et la chansonnette, comique ou sentimentale, cette plaie de notre littérature musicale, jusqu’à l’hymne religieux, au théâtre ou dans la rue ; la musique de 1848, presque toujours humble, indigente ou maladroite, et d’un mince intérêt artistique, d’ailleurs, souligne d’un commentaire perpétuel les événements auxquels elle se mêle intimement, plus intimement qu’aucune autre manifestation intellectuelle [32]. Mais la répétition de La Marseillaise ou du Chant du Départ finit par lasser. La question que se pose le Ménestrel le 21 mai 1848 résume à elle seule ce phénomène de lassitude : « Que sont devenues les romances depuis le 24 février 1848 ? » Que sont devenues les romances depuis le 24 février 1848 ?... Ces sentimentales filles des salons ont complètement disparu devant les énergiques accents de la Marseillaise. En entendant crier de tous côtés et hors de propos : « Qu’un sang impur abreuve nos sillons, » les pauvres tremblantes ont frémi, elles si innocentes, pourtant ; – et elles ont fui comme les hirondelles, à l’approche des mauvais jours ; mais voilà que toutes les voix rappellent ces peureuses émigrées : « Revenez, leur dit-on, il ne vous sera fait aucun mal : au chant du Départ faites succéder le chant de votre retour. L’ouvrière qui vous aime, comme elle aime ses fleurs, vous appelle ; ses fleurs sont là, sur le rebord de sa fenêtre, car le printemps a été fidèle, cette fois... il ne manque plus que vous..., fleurs et chansons doivent aller ensemble... Revenez ! » Et déjà, dans plus d’un atelier, sous plus d’une mansarde, bien des refrains aimés ont ramené un peu de joie ; on y chante aussi la patrie, pour laquelle, – s’il est beau de mourir, – il est bien doux aussi de vivre. Avec ces refrains là les cœurs s’ouvrent à l’espérance, et les boutiques ne se ferment pas. – Allez aux Champs-Élysées, et à côté des airs nationaux, dont on a abusé, vous entendrez le répertoire populaire des airs d’Étienne Arnaud [33] ou de Paul Henrion 34] : c’est Jenny l’ouvrière [35], petit tableau d’intérieur ; ou bien : Dieu et ma Mère [36], sages conseils donnés à un jeune ouvrier. [...] Oui, la chanson peut jouer un grand rôle dans notre République ! Espérons qu’il apparaîtra quelque Rouget de Lisle qui improvisera une Marseillaise de la Paix, car les temps sont changés ; la liberté nous l’avons, malgré les utopistes ; il ne nous faut plus que l’ordre, sans lequel tout est remis en question et en péril. Une Marseillaise de la Paix ! disions-nous tout à l’heure ; oh ! pour écrire un chant si noble et si sacré, il nous reste Béranger [37]. Si sa modestie lui a fait déserter le palais des Représentants du Peuple, il n’a pas abdiqué sa plume, et cette plume peut tracer un chef-d’œuvre de plus : c’est là une grande mission pour un grand poète [38]. Hélas et au risque de décevoir, il n’y eut ni un « nouveau Rouget de Lisle », ni même un Béranger [39] pour immortaliser 1848 par la chanson, et la seule Marseillaise de la Paix [40] produite sera celle de Julien Martin d’Anger. 3) Le temps de la réforme ou de la révolution ? Un long article de Julien Martin d’Angers, « Avenir musical : Le Conservatoire, les théâtres, le Gymnase militaire et l’Orphéon », publié dans La France musicale le 19 mars 1848 [41], fournit une somme de griefs et de revendications adressés aux institutions officielles issues de la Monarchie de Juillet ou liées à elle. Julien Martin dit d’Angers (1811- ?), compositeur de musique religieuse (cantiques, messes, etc.) et profane (essentiellement des romances), fut très actif dans les années 1840-1850. Nommé maître de chapelle et organiste accompagnateur de la paroisse royale de Saint-Germain-l’Auxerrois et du collège royal de Saint-Louis en 1841, il fonde la même année une société chorale pour la propagation de la musique d’ensemble admettant « tous les jeunes gens ayant de la voix et quelque habitude de la lecture musicale [42] ». Cité régulièrement dans les journaux spécialisés de l’époque, il est l’auteur d’une série de publications à vocation pédagogique, De l’Enseignement musical dans les collèges royaux de Paris (Paris, imp. de Bourgogne, 1841, rééd. en 1846), De l’Avenir de l’orphéon et de toutes les écoles populaires de musique en France [43] (1846), Plain-chant populaire pour tous les offices de l’année [44] (1846). Il reçoit à ce sujet les louanges d’une commission de l’Institut (Onslow, A. Adam, Carafa, Auber, Halévy, Spontini), le 15 avril 1847. La charge est forte et assez inattendue pour un honorable ex-maître de chapelle « royale ». Elle débute par une accusation de passéisme visant le Conservatoire. Le directeur et les professeurs du Conservatoire sont usés, soit par l’âge, soit par les principes caducs dont ils se nourrissent [...] Une ère nouvelle s’élève pour l’art comme pour la politique : arrière donc la vieille école ! Que le gouvernement exauce les vœux des vrais artistes, en nous donnant des hommes nouveaux, des professeurs progressistes qui ne veuillent en musique qu’une science raisonnable et qui en fassent de cette science, la compagne du génie et non son éteignoir. Il met en doute la volonté réformiste de la commission nouvellement chargée par le ministre Ledru-Rollin du sort du Conservatoire, s’appuyant sur le fait qu’elle n’est composée que de professeurs en poste. La République ne veut pas détruire, mais régénérer les belles institutions. Ce qu’elle veut, c’est que les abus disparaissent et que l’égalité règne là comme partout ailleurs : or, jusqu’ici, la faveur presque seule a décidé de bien des choses, rue du Faubourg-Poissonnière [45]. Il suffisait d’être protégé par quelque grand seigneur ou quelque belle dame pour être admis dans les différentes classes : les droits acquis étaient le plus souvent méconnus. On vous disait effrontément : « Si vous n’êtes pas bien épaulé, ce que vous avez de mieux à faire c’est de rester chez vous ». Et la charge se poursuit évoquant le népotisme, l’absentéisme des professeurs « qui ne paraissent que pour toucher leurs appointements », le favoritisme accordé à ceux qui prennent des leçons particulières ou encore les scandales de mœurs lorsque les classes de chant féminines deviennent un vivier pour les enseignants masculins : « ils ne permettent à ces pauvres malheureuses d’acquérir du talent qu’au prix de leur vertu !... ». Bien évidemment, aucun nom n’est cité et la gratuité de ce persiflage pouvait discréditer de nombreuses gloires musicales trop liées au régime précédent. Sans doute est-ce le but, et la toute nouvelle liberté de la presse pouvait faire espérer une immunité face aux poursuites en évoquant une « liberté d’expression » de bon ton. L’auteur, que rien n’arrête, poursuit donc son offensive. Sa deuxième argumentation s’appuie sur les conditions précaires faites aux musiciens des orchestres, aux choristes et aux danseurs des théâtres et aux injustices salariales. Ces artistes « du rang » sont mal payés et leurs conditions de travail assujetties aux heures de répétition multipliées à loisir. Il y a bien une question sociale, et si elle n’est pas nouvelle, elle trouve toute son acuité dans ces temps troubles. [...] le premier sujet du théâtre de la Nation gagne autant à lui seul que tout l’orchestre ensemble !... Justice ! Justice ! il en est temps. Une aussi monstrueuse anomalie se concevait à peine sous le gouvernement déchu ; que serait-ce donc sous le règne de l’égalité ? [...] Puisqu’un ministre se contente aujourd’hui de vingt-cinq mille francs, il faut qu’un premier chanteur ou une première danseuse se trouve très-heureux d’en obtenir autant pour maximum . Les aspirations égalitaires de l’auteur sur la disparité des salaires et le scandale de la fracture sociale se complètent de revendications pour un droit à la retraite possible après vingt-cinq ans de carrière. Décidément Martin d’Angers connaît son bréviaire social. Depuis le début du xixe siècle, de nombreux réformateurs sociaux attribuent à l’art en général et à la musique en particulier, un rôle social majeur. Ce furent notamment les cas des saint-simoniens ou des fouriéristes [46]. Les convictions de Martin d’Angers peuvent se rattacher ostensiblement à ce courant de pensée. Sa troisième cible mêle Gymnase musical militaire et Orphéon. Occasion pour Martin d’Angers d’évoquer la restauration d’une structure fondée, en 1817, par Alexandre Choron (1771-1834), l’Institution royale de musique classique et religieuse disparue en 1830, qui avait eu l’idée de recruter localement des ouvriers dans ses rangs et qu’avait essayé de perpétuer Martin d’Angers lui-même, dans sa société chorale. La réforme c’est aussi reprendre de vieilles idées dans le magasin des accessoires de l’Histoire culturelle et artistique. Un mot sur le Gymnase militaire et l’Orphéon. Le premier de ces établissements nous a toujours semblé parfaitement inutile. Renvoyez tous ces jeunes gens à leurs corps, répartissez-les dans les différentes musiques militaires, où ils trouveront des chefs habiles pour le perfectionnement de leur instruction musicale, et que les fonds destinés à cette école servent à la création, bien plus urgente, d’une succursale du Conservatoire, d’une nouvelle école Choron, exclusivement consacrée à l’étude des solfèges et des morceaux d’ensemble. On ne manque pas d’instrumentistes, mais il y a pénurie de chanteurs. Quant à l’Orphéon, nous croyons indispensable de le conserver, mais à condition de lui donner des bases plus larges, un but plus direct, une éducation moins superficielle. Dieu merci ! les vieux entêtés du conseil municipal ne sont plus là pour s’opposer à toutes les améliorations, et nous espérons bien qu’on nommera promptement, pour inspecter l’Orphéon, non point des membres de l’Institut, professeurs au Conservatoire et compositeurs dramatiques (ce n’est pas là leur affaire, et ils n’ont pas le temps de s’en occuper), mais des artistes spéciaux, pleins de zèle et d’ardeur pour la propagation de la musique en France. Pour l’auteur, le développement de l’Orphéon pourrait passer par la création d’antennes dans les lycées de Paris et par l’introduction d’une concurrence entre l’Orphéon traditionnel (méthode Wilhem) et sa forme « novatrice » (méthode Chevé [47]). Espoirs, espoirs... Chacun peut le constater, Martin d’Angers a des idées et connaît bien le milieu parisien. Rien, ou presque, ne semble trouver grâce. On croit entendre un chant bien révolutionnaire mais qui n’a pas encore été écrit : « Du passé faisons table rase [48] ». De la polémique on passe à la politique. Sans doute notre homme voudrait incarner le réformiste que la Musique française espère. Las, les événements de juin et le « souffre rouge » de la guerre civile lui ôteront nombre d’illusions. Après avoir écrit sa Marseillaise de la Paix, il signe un L. Napoléon Président ! chant patriotique [49], montrant sans ambiguïté son adhésion au régime, espérant sans doute que l’amnésie puisse frapper ses lecteurs « du temps de la réforme ». Révolution donc, en 1848, mais pour les ensembles à vent, ces événements paraissent assez mineurs vis-à-vis d’une autre révolution qui avait précédé, celle de la facture instrumentale de 1845. Celle-ci avait été espérée et soutenue par l’élite musicale française. Elle permettait de rendre cohérent un instrumentarium qui s’était construit depuis le xviiie siècle avec des éléments très hétéroclites. Au tout début de cette même année 1848 [50] paraît un ouvrage fondateur, le Manuel général de Musique militaire à l’usage des armées françaises [51] de Georges Kastner (1810-1867). Musicien reconnu et musicographe sérieux, auteur à succès d’ouvrages lyriques, Kastner comble d’éloges la nouvelle organisation de 1845 et relaie le sentiment de la plupart des musiciens de son temps. Comment expliquer alors la suspension de cette réforme « tant désirée » des musiques militaires, par le nouveau gouvernement ? En effet, deux décisions ministérielles consécutives annulent en partie la cohérence des « formations Sax » et sont censées s’appliquer immédiatement aux musiques militaires. La première, en date du 21 mars 1848, vise les musiques d’infanterie, la seconde, le 18 mai de la même année, les fanfares de cavalerie. Ce qui surprit le monde musical, ce fut la négation d’un véritable progrès fait pour les musiques militaires par l’adoption des instruments d’Adolphe Sax. Certes de nombreux corps militaires, fidèles à Louis-Philippe, se sont opposés aux révolutionnaires, bien que la monarchie bourgeoise ait eu de grandes difficultés à s’attirer les bonnes grâces de l’armée. C’est parce que l’armée a tiré sur la foule le 23 février que la colère populaire a explosé, même si le roi, enfermé dans les Tuileries, ressentit violemment l’hostilité de la troupe stationnée au Carrousel. Il pourrait y avoir un aspect punitif et vexatoire à priver un régiment de sa musique. Mais l’essentiel de la réponse ne semble pas se trouver dans ce registre. 4) Une nouvelle fin des privilèges En analysant en détail cette volonté réformiste qui semble unanime dans les milieux populaires, il paraît assez clair que, derrière les institutions, ce sont les hommes qui sont directement visés. Une fois la première salve tirée, par Martin d’Angers notamment, d’autres se chargent de régler la mire et de préciser le tir. Si nous reprenons le sort des musiques militaires, le dommage n’est pas si grand que cela. Les effectifs des musiques militaires ne sont pas touchés, les musiciens-militaires ne sont pas sans emploi et seule la composition de l’instrumentarium diffère. Dans les musiques des régiments d’infanterie c’est le retour des hautbois, bassons et cors « ordinaires », et la disparition des « inventions » de Sax (clarinette basse modèle « Sax », saxophone, saxhorns, saxotrombas, et autres améliorations dites du « système Sax») et, victimes collatérales, des trombones. Pour les fanfares de cavalerie, même chose, c’est le retour des clavicors et clairons chromatiques et la disparition de tout objet où apparaîtrait le nom de Sax. La décision qui les concerne spécifie l’objet de la réorganisation nouvelle « sous le rapport de la dénomination aux divers instruments [52] ». Il y a du réactionnaire dans la réforme. Il y a donc un véritable règlement de compte vis-à-vis de Sax lui-même. Il serait heureux de ne pas oublier que c’est au nom d’un monopole de fait que les facteurs d’instruments à vent s’opposent depuis 1845 à la réforme des musiques militaires et ce, non sans raison réelle [53]. Évoquant cette période de la vie d’Adolphe Sax, Constant Pierre écrit : C’est avec tristesse que l’on songe à la situation précaire de ce facteur de talent, néanmoins, il ne faut pas oublier qu’il a causé d’autres situations également pénibles : Raoux [54] a cessé prématurément de fabriquer, non-seulement pour se soustraire aux ennuis suscités par les procès Sax, mais encore par suite de la suppression, dans les musiques militaires, des instruments de sa spécialité ; Labbaye [55] s’est vu contraint, pour les mêmes raisons, d’abandonner également la facture et de terminer ses jours comme ouvrier ; Halary [56] est mort de chagrin en présence des difficultés qu’il rencontra ; Besson [57] dut s’expatrier et mourir à l’étranger… [58]. Sax, sans doute conscient des difficultés à venir, a anticipé la sanction en faisant un « cadeau d’allégeance » au gouvernement dès mars 1848, répétant des pratiques de lobbying dont il était un spécialiste. M. Ad. Sax vient d’offrir au gouvernement provisoire une musique complète, formée d’instruments de sa fabrique, pour la première légion de la garde nationale mobile. Dès le lundi 28 [février], M. Sax avait rouvert ses ateliers, et ses ouvriers consacraient spontanément le produit de leur première journée de travail au profit des blessés [59]. Politiquement et socialement, il faut voir dans les décrets concernant la composition des musiques militaires de 1848, une forme évidente de la lutte contre toute forme de monopole économique. La remarque de Michel Brenet [60] revenant sur la réforme de 1845 favorable aux instruments Sax, est à prendre en compte. Ceux des instruments qui ne portaient pas ostensiblement le nom de Sax étaient au moins du « système Sax » et la réforme aboutissait à l’obtention pour l’habile facteur d’un monopole de la fabrication et de la fourniture du matériel musical à l’usage de l’armée. On s’explique aisément le trouble suscité dans les milieux artistiques et industriels par des changements dont le motif pouvait paraître trop ouvertement intéressé [61]. En fait, c’est Adolphe Sax et son entreprise qui semblent seuls visés par ces décrets. Tous les témoins contemporains l’ont compris très vite, l’activisme de Sax met en péril les autres facteurs d’instruments à vent à Paris et en province. Le fait que ce dernier ait déposé de très nombreux brevets pour protéger ses inventions et améliorations, au nom de la propriété industrielle, compromet des établissements industriels conséquents, vite qualifiés de « contrefacteurs ». C’est au moins ce dont se plaignent, en niant les brevets d’invention, les nombreux facteurs réunis qui attaquent Sax devant les tribunaux. Nombreux aussi seront ceux qui voudront défendre Sax mué en « martyr » [62] (Kastner, Comettant, Berlioz, Neukomm, Pontécoulant, etc.). Pour les musiques militaires françaises, l’ensemble nouvellement formé est idoine. Ce n’est ni celui proposé par Carafa en 1845, bien qu’il s’en approche, ni le retour réel aux nomenclatures d’avant 1845. La difficulté est que quelques musiques ont acquis très récemment un instrumentarium « Sax » à un prix conséquent. La décision ministérielle bien hâtivement signée pose plus de questions qu’elle ne donne de réponses. Parmi les cibles de la Révolution de février, figure en deuxième ligne le Gymnase musical militaire. Créé en 1836, le Gymnase musical militaire répond à des demandes très précises : former des musiciens-militaires et des chefs pour les nombreuses musiques d’infanterie et de cavalerie, tout en précisant que ceux-ci se voyaient refuser l’accès au Conservatoire depuis sa reprise en main, par le pouvoir politique, en 1815 [63]. L’une des réformes proposées vise à renouer le lien Conservatoire / Armée tout en faisant l’économie du Gymnase musical. Puisque nous en sommes sur le chapitre des réformes, nous demanderons qu’on donne plus d’importance aux classes d’instruments à vent, qu’on y admette les meilleurs élèves du Gymnase militaire, après avoir renvoyé les autres dans leurs régiments. Nous ne prêchons pas l’ostracisme comme on veut bien le dire, mais le sage emploi des revenus de l’état et des ressources de l’armée. Jusqu’à preuve du contraire nous persistons à dire que le Gymnase militaire est une superfétation. La plupart des jeunes soldats qui en font partie peuvent fort bien recevoir, dans leur régiment même, une instruction musicale suffisante, sous le rapport de la théorie et de la pratique ; quant aux plus capables, à ceux dont l’aptitude promet de bons chefs de musique, envoyez-les, comme nous le disions tout à l’heure, se parfaire au Conservatoire de Paris, et vous aurez réalisé de sages et utiles économies. À l’heure qu’il est, tout bon citoyen doit plaider pour le nécessaire et non pour le superflu. Sans doute la place de directeur du Gymnase militaire peut être enviée, mais, dans des circonstances difficiles l’intérêt particulier doit s’effacer devant l’intérêt général. Encore une fois, remplissons les coffres de l’état au lieu de les épuiser [64]. Si l’idée d’intégrer les musiciens militaires au Conservatoire (en augmentant les capacités d’accueil des instruments à vent) est récurrente, l’institution du Gymnase a aussi ses défenseurs, tel qu’en témoigne le polonais Karol Forster [65], observateur des mœurs parisiennes. Un gymnase musical, sous la direction de M. Carafa, fournit aux différents régiments des sujets distingués. Par mesure d’économie, on s’est levé contre cette institution à la Chambre des Députés ; mais cette mesquinerie financière ne peut trouver aucune excuse [66]. Michele Carafa de Colobrano [67], directeur du Gymnase musical militaire depuis 1837, se voit particulièrement visé par des critiques de plus en plus vives. Sans doute soupçonne-t-on le compositeur d’avoir bénéficié de la magnanimité du prince pour l’installer à un poste que ses compétences spécifiques n’appelaient pas particulièrement. Une révolution, c’est d’abord la remise en cause de l’ordre établi. Dans une lettre anonyme signée « un de vos abonnés », et adressée à la France musicale, l’article de J. Martin (d’Angers) est complété par une pensée plus nette mais moins expéditive pour le Gymnase. Ce n’est peut-être pas l’institution qu’il s’agit de supprimer, mais le directeur qu’il serait heureux de limoger. [...] si, au lieu de s’occuper de l’administration de son établissement, M. le Directeur du Gymnase devait persister à faire antichambre dans les bureaux de la guerre, pour s’y créer des intimités qui le missent à l’abri des justes réclamations soulevées de toutes parts contre son administration... oui, et mille fois oui, M. Martin d’Angers aurait raison de demander la suppression du Gymnase. Mais qu’on place à la tête de cet établissement un homme jeune, énergique, à idées neuves, animé de l’esprit de justice et de l’amour du progrès, on verra combien de services le Gymnase est appelé à rendre dans l’avenir [68]. Et le même journal ne peut s’empêcher d’« enfoncer le clou » en publiant, une page plus loin, une information montrant le climat délétère qui règne dans l’institution militaire d’État qu’est le Gymnase. Les élèves du Gymnase musical militaire ont eu, cette semaine, leur petite révolution. Ils avaient formulé des plaintes contre leur directeur, et par suite de leurs réclamations réitérées, plusieurs avaient été consignés au poste de police. Ils n’ont pas voulu subir cette punition, et d’un commun accord ils ont protesté contre les condamnations prononcées. M. Caraffa [sic], qui tient sa position de la dynastie déchue et qui était un des familiers de l’ancienne cour, a, dit-on, renvoyé à la suite de cette scène une vingtaine d’élèves. Laissera-t-on encore longtemps M. Caraffa à la tête d’un établissement national qui réclame une main ferme, une tête intelligente, un citoyen dévoué à notre République ? C’est une question qu’il suffit de poser au ministre de la guerre pour être sûr qu’elle sera tranchée dans le sens qu’indique la situation actuelle des affaires politiques [69]. On peut se demander quel règlement de compte il y a derrière cet acharnement. En dehors du seul symbole que représente le « prince de Colobrano », une partie de la réponse est fournie tardivement par la Revue et Gazette musicale de Paris. Évoquant les décrets jugés désastreux qui ont touché l’instrumentarium des musiques militaires et Adolphe Sax en particulier, une série de trois articles portant le titre « De l’organisation des musiques militaires » donne quelques clés de lecture. Il serait enfin temps qu’on assignât à la musique militaire en France le rang qui lui est dû. M. Carafa la traite par-dessous la jambe, et avec un dédain qui ressemble à de l’ingratitude, car le Gymnase musical lui donne des avantages qui sont loin d’être à dédaigner. S’il ne porte plus d’intérêt à la musique militaire, serait-ce qu’il est déjà arrivé à cet âge où l’on n’aime plus tout ce qui a l’apparence du progrès ou du perfectionnement ? ou bien, jaloux de son omni-sapience, cherche-t-il à éloigner tous ceux qu’il voit arriver avec une idée nouvelle ? [...] Il est curieux d’examiner comment il s’y est pris pour obtenir l’ordonnance d’organisation du 24 mars dernier, [...] immédiatement après la révolution de février, alors qu’on était exclusivement sous l’empire des plus graves préoccupations politiques, M. Carafa porte sa demande dans les bureaux de la guerre, et à force d’insistances, d’importunités, il obtient l’ordonnance [...] Ainsi, pendant que partout on n’avait de vœux, d’élan, que pour le progrès en toutes choses, M. Carafa, lui, faisait sa petite révolution à sa manière, c’est-à-dire en faisant faire à la musique militaire un énorme retour en arrière [70]. Et le journal de poursuivre en demandant « une enquête sévère, compétente et impartiale, provoquée par M. le ministre de la guerre » pour examiner ce qu’il en fut du rôle du directeur du Gymnase et de ses complices au sein du ministère. Là encore la sanction tombe, souveraine. « Un décret du mois d’avril dernier, rendu par le gouvernement provisoire, a supprimé le Gymnase musical à compter du 16 septembre 1848 [71] ». En fait la raison économique l’emporte sans doute sur la question morale. Et puisque nous en sommes encore aux remises en cause et attaques personnelles, même le brave Orphéon est sujet à critique. Lancé par sa condition nouvelle de « Voix du vrai peuple », il organise deux concerts à bénéfice, au nom de l’œuvre sociale et philanthropique, pour les blessés de février, les chômeurs et les orphelins. Il y a de la citoyenneté en cela et le Gouvernement provisoire ne peut qu’y être sensible. Lors du premier concert, le 26 mars 1848, ce ne sont pas moins de six membres de ce dernier, deux ministres (celui de l’Intérieur et celui de l’Instruction publique), accompagnés de l’état-major de la Garde nationale et des représentants de la municipalité de Paris, qui assistent à cet événement populaire au Cirque des Champs-Élysées. Le répertoire a été particulièrement soigné pour ces deux manifestations. Il représente un véritable florilège de ce que la voix du peuple éduqué chante dans ce printemps 1848. La première partie du programme commençait par notre immortelle Marseillaise et la seconde par le Chant du départ, de Chénier et Méhul. Dans la première partie, il y avait encore deux chants patriotiques, la République de 1848, paroles de M. E. Lacan, musique de M. C. Lysberg ; la Plébéienne, invocation aux martyrs de la liberté, paroles de J.-T. Flotard, musique d’E. Bienaimé. Ce sont là des productions trop inférieures à leurs aînées pour soutenir le parallèle : on n’en peut guère louer que l’intention. [...] Cependant le morceau qui a produit le plus d’effet, c’est l’Appel au combat, double-chœur de M. Lefébure-Wély, sur des paroles de M. A. Lefèvre. La mélodie en est franche, la marche naturelle, l’ensemble intéressant. On l’a redemandé de toutes parts, ainsi que les Enfants de Paris d’Adolphe Adam. La Symphonie vocale, savante et charmante composition de Chelard, terminait la séance ; mais les orphéonistes ont exprimé le désir d’exécuter le chœur des soldats, tiré d’un opéra de Grisard. C’est, dans tout leur répertoire, ce qu’il y a de plus simple et ce qui saisit le plus vivement l’auditoire, grâce au contraste heureux d’un forte et d’un piano [72]. Le compte-rendu donné par La France musicale en date du 2 avril est précédé d’une anonyme « Lettre aux orphéonistes ». Au su de ce qui a été évoqué précédemment, nul ne sera surpris de lire une attaque personnelle contre le directeur Joseph Hubert (1810-ca 1878), élève et successeur du fondateur de l’Orphéon, Bocquillon-Wilhem [73] (1781-1842). Que peut-on reprocher à Hubert ? Le fait qu’il soit « l’homme que la faveur monarchique a fait le chef de cette admirable institution. [...] aujourd’hui, sous notre gouvernement républicain, il est impossible [74] ! ». Dès le 9 avril J. L. Vaïsse, orphéoniste lui-même, fait une réponse à l’auteur anonyme et prend la défense de Joseph Hubert face à ces « critiques injustes » [75]. Mais l’Orphéon ne peut être attaqué en lui-même ni pour lui-même. En fait de réforme, il semble bien que l’action de l’Orphéon républicain porte tous les espoirs pour poursuivre son œuvre de démocratisation de la musique doublée de son rôle social et pacificateur. [...] l’Orphéon républicain doit être monté sur la plus grande échelle possible : il doit être appelé à donner des fêtes les plus grandioses des temps modernes, des fêtes comme les gouvernements non populaires ne sauraient même en rêver ! [...] Chers camarades ! lorsque toutes les corporations ont été soumettre leurs justes griefs au Gouvernement provisoire, devons-nous rester en arrière de ce mouvement ? Ouvriers, nous avons été lui demander la vie du corps et le travail matériel ; orphéonistes, allons maintenant réclamer de lui la vie du cœur et de l’intelligence, et les hommes dévoués qui organisent pour nous la République, se rendant à nos justes réclamations, après nous avoir faits forts en nous accordant le travail et les droits du citoyen, nous rendront heureux, en nous rendant l’exercice des arts qu’on avait voulu faire le privilège de l’aristocratie, et qui doit rester désormais dans le domaine du peuple, comme tout ce qui est grand et glorieux [76]. Toute la rhétorique, la sémantique et l’idéalisme du discours révolutionnaire et social du temps sont compris dans ces lignes. II. De la fête révolutionnaire aux lendemains qui déchantent La France que l’Europe admire Il serait bien temps de clore la Révolution. Trois journées de barricades et d’émeutes étaient venues à bout du régime de Louis-Philippe et la patrie reconnaissante pouvait enterrer ses morts. La cérémonie des Funérailles des citoyens morts pour la République fait une référence directe aux Trois Glorieuses de 1830 et nombre de citoyens parisiens pouvaient se souvenir de la déambulation des victimes de la place de la Concorde à la Colonne de Juillet, place de la Bastille, aux sons de la Symphonie funèbre et triomphale (H.80A) d’Hector Berlioz [78] à l’occasion du 10e anniversaire, huit ans avant celle de 1848. La cérémonie du 4 mars 1848 a de nombreuses similitudes avec celle de juillet 1840. Seule s’en distingue l’absence d’une musique digne d’un tel événement. Il faut reconnaître que la commande faite à Berlioz lui avait laissé trois mois pour composer [79]. Ainsi entendra-t-on le 4 mars 1848, dans l’immense cortège célébrant la révolution aboutie et honorant ses victimes [80] « les corps de musique des six premières légions de la Garde nationale, qui entretiennent dans le silence le roulement grave de tous leurs tambours… » [81]. La France musicale, faisant preuve de réactivité, publie dès le lendemain un sommaire compte-rendu. Hier samedi, a été célébrée une fête funèbre qui laissera de profonds souvenirs. [...] Nous n’avons que le temps aujourd’hui de décrire la marche du cortège. On verra que la musique n’avait pas été oubliée par les ordonnateurs de cette fête. À midi précis, un service religieux a été solennellement célébré dans l’église de la Madeleine et dans toutes les autres églises de Paris. Le cortège s’est ensuite dirigé de la Madeleine à la colonne de Juillet, dans l’ordre suivant : [...] La musique des six premières légions de la garde nationale, les tambours en tête. [...] Par intervalles, les Orphéonistes, au nombre de douze cents, faisaient entendre des chants de liberté. [...] Les chœurs des divers théâtres de la République étaient placés sur les degrés de l’église de la Madeleine [82]. Voulant revenir sur la musique interprétée à cette occasion, le rédacteur de La France musicale reprend sa plume huit jours plus tard pour compléter son propos. Mais il n’évoque que le Chant des Girondins et la Marseillaise. Un bien court hommage aux citoyens morts pour la République et une fête funèbre qui, contrairement à ce que pouvait penser le rédacteur huit jours plus tôt, ne laissera pas un « profond souvenir ». Mieux encore, les quelques mots de l’anonyme auteur de la « Lettre aux orphéonistes » précédemment citée, résume un sentiment très perceptible. Le triste rôle que l’on a fait jouer aux Orphéonistes dans la fête funèbre de la translation des nobles victimes de février à la colonne de juillet est la meilleure preuve de la nécessité où nous sommes de donner à l’Orphéon une direction éclairée, par conséquent toute autre que celle qui nous afflige en ce moment [83].  Funérailles des victimes des 22, 23 et 24 février 1848, lithographie de S. Vanson (h : 41,5 cm, l : 64,5 cm), chez Pellerin, imprimeur © Cliché : Bruce, Musées de Mâcon, Musée des Ursulines Notice Joconde 1) Des rites hérités et l’éclat des fêtes de la République L’ambiance des premiers mois de 1848, à Paris comme en province, renoue avec les enthousiasmes de la Révolution française et ses rites. Ainsi voit-on des républicains tel Grégoire Bordillon, nouveau commissaire du gouvernement, puis, préfet du Maine-et-Loire, agiter l’Anjou de fêtes révolutionnaires. Pendant des mois, les célébrations républicaines se multiplient en Anjou comme partout en France : fêtes patriotiques, plantation d’arbres de la liberté, banquets et revues de la garde nationale, etc. Ces fêtes révolutionnaires, fêtes de la fraternité qui renouent avec celles de la première révolution, veulent régénérer le civisme patriotique et faire assumer, à l’échelon communal, l’héritage démocratique et républicain. C’est le printemps joyeux de la République pacifique et romantique qui s’assombrira avec les journées de juin. Bordillon est partout, ordonnateur et président de ces moments d’exaltation où s’épanouissent les drapeaux et cocardes tricolores, où afflue une population bon enfant, où résonnent les fanfares. Son verbe fleuri enthousiasmant les foules, il devient une sorte de ministre de la foi républicaine dans des liturgies unanimistes ponctuées de vibrants « Vive la République [84] ! » Les événements de 1848 ouvrent des temps politiques nouveaux et la fête républicaine perpétue, dans sa forme, une tradition établie une soixantaine d’années auparavant [85]. Cependant, à la grande différence de 1789, ce ne sont pas les « masses d’instruments à vent » de la Garde nationale de Paris qui se trouvent portées par la vague révolutionnaire. Ce sont les voix. Celles du peuple en priorité. Si l’esprit est à la fête, c’est une société sous tension qui se donne l’espoir de temps nouveaux. C’est ce dont témoigne Xavier Marmier auteur de romans, de poésies et de récits de voyage qu’on ne lit plus, dans son Journal. Une scène datant de la fin mars 1848 à l’occasion de la plantation d’un « arbre de la liberté » dit assez bien l’esprit du temps. [...] je suis interrompu dans mes travaux par une troupe d’ouvriers qui creuse la place Saint-Thomas-d’Aquin pour y planter l’arbre de la liberté. À 5 heures, l’arbre est apporté sur une charrette. Une foule d’hommes, de femmes, d’enfants l’entoure. Deux gardes nationaux vont chercher le curé qui vient bénir ce symbole d’émancipation et prononcer un discours fort applaudi. Puis le curé se retire, et l’on entonne le chant des Girondins, la Marseillaise, avec accompagnement de coups de fusil, de fifres et de roulements de tambour, plus un aveugle qui jouait il y a quelques mois avec sa clarinette les plus innocents airs de vaudeville et qui maintenant entonne bravement les chants guerriers. Après la cérémonie, les braves patriotes font une tournée dans les maisons voisines, recueillant 4 francs par-ci, 5 francs par-là, et s’en vont boire à la prospérité de la république. Ainsi finit la fête. Puissions-nous n’en avoir pas de plus terrible [86] ! Et puisqu’il est de bon ton de planter des arbres en plein printemps, le Théâtre de la Nation (nom nouveau de l’Opéra de Paris alors situé rue Le Peletier) plante le sien dans la cour, le 2 avril, au son de la Marseillaise et du Chant du Départ exécutés par les artistes de l’orchestre et des chœurs. D’autres fêtes bien plus institutionnelles s’organisent à Paris et en province. Si nous ne pouvons les citer toutes, quelques-unes retiennent notre attention.  Jean Jacques Champin, Fête de la fraternité sur la place de l'Étoile, 1848 © Musée Carnavalet / Roger-Viollet Notice Joconde Alors que les tensions montent, en vue des prochaines élections législatives, le gouvernement célèbre la Fête de la fraternité le 20 avril 1848. À cette occasion furent remis les nouveaux drapeaux bleu-blanc-rouge à l’armée et à la garde nationale. Tous les ministres, installés sur une estrade au pied de l’Arc de triomphe de l’Étoile, assistent alors au défilé de tous les hommes armés de la région parisienne : Garde nationale, infanterie, cavalerie, artillerie, pompiers, etc. On parle d’une parade de quatre cent milles uniformes qui défilent de 11h à 23h devant près d’un million de personnes dans les rues. Le spectacle avait de quoi émouvoir, y compris George Sand. Quel spectacle ! jamais dans les annales de la vie humaine il ne s’en est produit un semblable ; jamais tant d’êtres humains ne se sont trouvés rassemblés à la fois dans un si petit espace. Un million d’âmes ! car toute la banlieue, toute la vaste ceinture de Paris accourait aussi, chaque citoyen avec sa famille. Du sommet de l’Arc de triomphe, c’était une vision, un rêve... La fédération du Champs-de-Mars n’était qu’un jeu d’enfant auprès de ce qui s’est produit aujourd’hui devant Dieu qui préside aux destinées de la France. Quatre cent mille hommes armés, marchant sur une ligne immense et dont l’œil ne pouvait voir ni le commencement ni la fin ; et, sur les flancs de cette colonne monstre, toute une population pour témoin de la manifestation de ses forces les plus vives. Douze heures pour épuiser le passage de ce flot, de ce fleuve, de cette mer humaine [87]. À l’issue de la manifestation, le gouvernement décida de maintenir à Paris deux régiments de cavalerie et trois d’infanterie, signe que malgré l’enthousiasme apparent, le climat était fort délétère. Les commentaires sur le décorum qui entoure la fête du 20 avril disent le côté rigide et par trop officiel de celle-ci. À propos de la grande revue du 20 avril, plusieurs journaux exprimaient un vœu qui a trouvé de l’écho dans tous les chœurs. Il s’agissait de régénérer nos fêtes publiques et de leur enlever ce cachet de monotonie et de banalité qui enfantait l’apathie des masses et la répugnance des gens de goût [88]. La question esthétique n’a de juge, dans le Ménestrel que de la part « des gens de goût » et si ce n’est par pédanterie, au moins la presse spécialisée reste-t-elle une presse de classe. S’il ne s’agit pas particulièrement de la distinction entre musique savante et musique populaire, il s’agit au moins de l’expression d’un goût mondain. Aussi tente-t-on d’améliorer « l’ordinaire » des fêtes qui s’enchaînent, dès la suivante, celle du 4 mai dite de la Proclamation de la république. Le 4 mai, la France entière viendra dans le Champs-de-Mars s’assoir au banquet de la République. Les travailleurs, la garde nationale et l’armée, représentés par cent mille délégués ; les envoyés des départements, convoqués par le Gouvernement provisoire, fraterniseront et jureront de défendre la patrie contre l’ennemi du dehors ou du dedans et de mourir pour elle. Le Gouvernement veut donner à cette fête de la fédération un immense éclat. Au premier rang figureront l’Agriculture et l’Industrie. La première sera représentée par un char attelé de quatre paires de bœufs ayant les cornes dorées et ornées de bandelettes. [...] Autour de ce char, un chœur composé de jeunes filles, élèves du Conservatoire de musique, chantera des hymnes patriotiques ; derrière le char, les orphéonistes alterneront les chants [89]. La fête du 4 mai sera reportée au 10. Le satirique et charivarique journal Le Tintamarre de Jean-Louis-Auguste Commerson (1803-1879) ne pouvait qu’épingler ce retard. Mais comme toute satire, une part de grande vérité se cache dans les propos du citoyen Joseph Citrouillard (alias Commerson). La fête du 4 mai a été remise au 10 de ce mois ; mais nous ne savons pas si elle restera fidèle à son premier programme. M. Ledru-Rellin a rencontré des résistances dans le camp d’Apollon et de ses neuf sœurs. Les nymphes du Conservatoire refusent de marcher derrière les bœufs aux cornes dorées. D’autre part, on se demande ce que la France de 1848 a de commun avec un programme mythologique. Le gouvernement rangerait-il notre République dans le domaine de la fable ? Qu’on laisse tous ces anachronismes à certains clubistes rouges qui se croient les contemporains de leurs grands-pères, et font de la politique neuve avec des idées vieilles [90]... La remarque sur les élèves réticentes du Conservatoire laisse imaginer qu’une contestation existe entre l’institution bourgeoise et le monde orphéonique populaire. Mettre côte à côte ces deux entités reviendrait à « mélanger torchons et serviettes », à moins que, plus prosaïquement, les jeunes filles ne soient incommodées par la présence de ces bœufs symboliques. Au titre de la création musicale, la fête du 10 mai permit d’entendre un nouveau Chant des Travailleurs, paroles de Tisserant sur une musique de Maria Satin « simple choriste du théâtre du Gymnase », interprété par deux cents choristes représentants la corporation des artistes dramatiques. Ce chant reçut un accueil chaleureux, interprété trois fois notamment aux pieds de la statue colossale de la République en fin de déambulation. Et même lorsqu’il s’agit de célébrer la Fête de la Concorde dédiée aux travailleurs, à la Garde nationale et à l’Armée, le 21 mai, le gouvernement apporte plus d’attention aux mots prononcés par les masses vocales qu’aux notes de la musique instrumentale. Quelques musiciens qui ne sont pas en première ligne ont essayé du moins de chanter quelque chose de nouveau pour notre jeune république, M. Elwart est de ceux-là. Il a écrit, pour la fête du 21 [mai 1848], un Te Deum républicain et un Hymne à la fraternité qui ont été exécutés devant l’Assemblée nationale. Ces deux morceaux sont bien écrits pour les voix ; mais l’auteur aurait dû se souvenir qu’il n’y a que le formidable unisson d’une mélodie bien franche qui puisse produire de l’effet dans une salle de concert comme celle du Champ-de-Mars qui a le ciel pour coupole. Quoi qu’il en soit, M. Elwart a fait preuve de zèle, de talent et d’un grand désintéressement en cette circonstance [91]. Si la République donne de la voix, les musiques militaires ou paramilitaires, outils traditionnels du pouvoir dans ce genre de manifestation de masse, restent assez discrètes ou si peu audibles que leur présence n’est même pas signalée dans les journaux musicaux. Dans ces temps incertains, une autre structure instrumentale « populaire et philanthropique » accompagne les premiers pas de la jeune République, celle de la Musique populaire de la République et de la ville de Paris. 2) Le grand désordre chez les gardiens de l’ordre Un grave problème se pose aux nouvelles autorités politiques. Dès février 1848 le maintien de l’ordre, aux lendemains de la Révolution, est une question assez inextricable. Même s’il n’y eut pas unanimité dans les rangs de l’armée royale, cette dernière devait être mise à l’écart de par l’action de certains régiments et par l’incertitude de sa fidélité à la République, voire la menace qu’elle pouvait représenter au su des liens qui liaient l’État-major et le régime déchu. En cela rien d’extraordinaire, mais pour notre sujet il devient évident que les musiques institutionnelles de l’armée devaient rester discrètes et silencieuses. Leur casernement en province ou en banlieue permettait une immédiate prise de distance. De la même façon la Garde nationale, institution paramilitaire qui avait soutenu la Révolution de 1830 et grandement contribué à l’accession au trône du roi-déchu, ne pouvait qu’être assimilée à ce dernier. À Paris, les douze musiques de ces dernières jouaient le rôle de musiques officielles lors des événements à connotation politique, le roi Louis-Philippe ayant renoncé à une Maison militaire et donc à des musiques d’apparat pour des événements à portée nationale. Les musiques des Gardes nationales, tout comme les musiques militaires régimentaires furent associées aux célébrations annuelles des Trois Glorieuses de 1830 et au Retour des Cendres le 15 décembre 1840. L’Ordonnance du 1er avril 1838 relative à la musique des légions de la Garde nationale de Paris donne une nette préférence à ces dernières de la part de l’État. On le sait, la Monarchie de juillet a encouragé ces Gardes nationales, et le statut, comme le mode de recrutement des musiques parisiennes est favorisé vis-à-vis des musiques régimentaires. En effet les douze musiques de la Garde nationale parisienne accueillent une mixité de musiciens professionnels (gagistes) et de musiciens amateurs. Le nombre autorisé de gagistes allant jusqu’à trente, c’est toute une génération de musiciens professionnels de haut niveau, la plupart formés au Conservatoire et occupant un siège dans un des orchestres parisiens (Opéra, Opéra-comique, Théâtre Italien, etc.) qui intègre ces formations, tout en étant dispensée du service ordinaire de la Garde nationale. Sur les trois cent quatre-vingt-dix-huit musiciens composant en 1837 les musiques des douze légions, trois cent quinze sont qualifiés de « musiciens professionnels [92] ». Cependant, les gardes nationaux se recrutent pour l'essentiel dans la bourgeoisie, puisqu'ils doivent justifier qu'ils payent l'impôt personnel et acheter eux-mêmes leur équipement. Pour autant, la grande majorité d'entre eux ne sont pas assez fortunés pour atteindre le cens de 200 francs de contributions directes exigé pour participer à l'élection des députés par la loi électorale du 19 avril 1831. Or, ils considèrent que si le régime attend d'eux qu'ils versent leur sang pour le défendre, il doit leur concéder la participation aux affaires politiques : l'élargissement du cens constitue donc une revendication permanente au sein de la Garde nationale. En janvier 1840, pendant que la Chambre des députés délibère sur l'adresse au roi, plusieurs centaines de gardes nationaux parisiens manifestent pour réclamer le droit de vote. Des comités lancent un très important mouvement pétitionnaire en faveur des droits politiques des gardes nationaux. Dans une proclamation du 14 janvier 1840, le maréchal Gérard, commandant supérieur des Gardes nationales de la Seine et proche du roi, condamne ces manifestations au nom de la loi du 22 mars 1831 qui interdit à la Garde toute délibération sur les affaires de l'État, du département ou de la commune. Dès ses premiers jours, la République invite la Garde nationale à affirmer sa démocratisation intégrale et immédiate en permettant à tout citoyen d’intégrer celle-ci par le décret du 25 février 1848. Très rapidement, la classe ouvrière intègre cette Garde nationale rénovée et revivifiée. Ses effectifs passent de 57 000 en janvier 1848 à 190 000 en mars, puis 237 000 en juin. Un des premiers effets de la Révolution de février 1848 fut de permettre l’élection espérée au sein des Gardes nationales, puisque le suffrage universel masculin pour les citoyens de plus de 21 ans est proclamé le 2 mars 1848, ainsi que la liberté de presse et de réunion. La pratique démocratique de l’élection des « chefs » de musique dans la Garde nationale mérite alors d’être soulignée. La désignation du hautboïste Stanislas Verroust [93] en juin 1848, à la tête de la musique de la Deuxième Légion, répète cette pratique. La musique de la 2e légion de la garde nationale a pourvu vendredi dernier au remplacement de M. Barizel, ancien capitaine de musique, qui prend décidément sa retraite. Stanislas Verroust, lieutenant de la même musique, et qui exerçait depuis longtemps les fonctions de capitaine, a été nommé à l’unanimité en remplacement de M. Barizel. M. Weber a ensuite été appelé à remplacer M. Verroust comme lieutenant. Ces deux nominations, soumises à l’élection, ont eu lieu au milieu des applaudissements des artistes et amateurs qui composent la musique de la 2e légion [94]. Curieusement les musiques des Gardes nationales ne se font pas entendre au lendemain des événements de février. Les journaux du temps restent muets sur leur participation à quelque événement commémoratif que ce soit. Dans ces temps troublés, d’autres structures sécuritaires sont créées : la Garde civique ou républicaine et la Garde mobile. Formée dès février la Garde mobile comptera jusqu’à 14 000 parisiens à la veille des journées de juin. Placée sous l’autorité du ministre de l’Intérieur elle sera vite qualifiée de garde prétorienne et jouera le rôle de fer de lance de la répression aux lendemains des événements de juin. C’est à la Première légion de la Garde mobile qu’Adolphe Sax offre une musique complète. 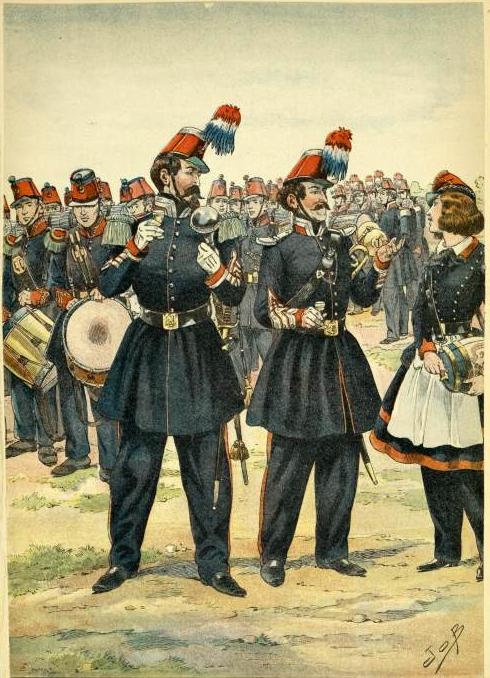 Tambour-Major - Chef de Musique - Cantinière de la Garde Nationale Mobile de Paris (1848), lithographie de Job, Société Française d’Édition d’Art L.-Henry May, Paris, 1898 © Jean-Louis Couturier Source De façon spontanée sont nées d’autres gardes irrégulières dans Paris, dont celle dite de l’Hôtel de Ville, composée d’ouvriers, de bourgeois et intégrant quelques polytechniciens. Elles forment à partir du 28 mars 1848 une Garde civique. Transformée en Garde républicaine dès le 16 mai 1848, cette dernière compte à la mi-avril 2 800 hommes et 300 cavaliers répartis en trois escadrons [95]. C’est pour doter cette dernière d’un corps de musique à la hauteur des espoirs symbolisés par cette force publique qu’est créée la Musique populaire de la République et de la Ville de Paris. 3) De la Musique populaire de la République, adresse des ouvriers de l’art aux ouvriers de la pensée C’est par les cuivres que s’annonce la victoire républicaine, lorsque naît une Musique populaire de la République et de la ville de Paris fort proche, dans ses buts et ses attendus, de ce que fut, sous la Révolution de 1789, la Musique de la Garde nationale de Paris [96]. Lundi a eu lieu, au Luxembourg [97] une manifestation du plus noble caractère : dans l’après-midi, la grande cour du palais étant, comme elle l’est chaque jour, remplie d’ouvriers, hommes et femmes, qui venaient apporter à la commission du gouvernement provisoire pour les travailleurs leurs vœux, leurs sympathies ardentes, et surtout ce grand encouragement, - le spectacle de la misère qu’il faut guérir, - trois ou quatre cents musiciens, rangés avec ordre, se sont présentés dans la cour, et ont donné, au milieu des applaudissements de la foule, une aubade à la commission. Un artiste a lu à MM. Louis Blanc et Albert une adresse chaleureuse où, après s’être associés par le cœur aux travaux de la commission, les musiciens annonçaient que, formés en une famille de frères, ils allaient désormais s’associer, par leur art, d’une manière permanente, aux fêtes populaires et à la vie même du peuple [98]. L’événement revêt une certaine importance. Très inspiré des idées de 1789, du message des Lumières permettant de faire naître un corps social par l’éducation collective, il est plein de rêves idéalistes, maçonniques, fourriéristes et saint-simoniens mélangés. CLUBS D’HARMONIE Nous recevons à l’instant la lettre suivante ; elle nous annonce un projet grandiose et artistique avec lequel nous sympathisons de toute notre âme. « Monsieur le rédacteur, Nous venons au nom de l’œuvre toute populaire et toute philanthropique que nous venons de fonder, vous prier de nous venir en aide en nous accordant quelquefois une petite place dans votre estimable journal. LES OUVRIERS DE L’ART AUX OUVRIERS DE LA PENSÉE Une immense association de tous les artistes de Paris, jouant les instruments de cuivre, vient de se former, afin de constituer un formidable corps de musique, ayant pour devise : Musique populaire de la République et de la ville de Paris, et pour but : d’assister et de marcher en tête des grandes manifestations des corporations, et de les instruire par des cours publics et mutuels de théorie pratique de chant et d’instrument, de se réunir aux sociétés chantantes, afin de ne former qu’une seule famille et de donner des concerts au peuple, afin de l’initier et de le faire participer aux beautés, aux bienfait, aux douces et nobles émotions que la musique procure. Ce projet a été soumis à l’approbation du citoyen Marrast, Maire de Paris, qui l’a parfaitement accueilli et a bien voulu nous promettre son patronage et son concours ; ainsi qu’au citoyen Rey, colonel-gouverneur de l’Hôtel-de-Ville, qui, dans cette occasion, nous a donné les plus grandes preuves de sa bienveillance et de sa sympathie, en s’abonnant immédiatement pour sa Garde Républicaine. Une manifestation pour le même objet a été faite ensuite auprès du citoyen Louis Blanc, et appuyée par quatre cents instrumentistes exécutant des airs patriotiques au milieu d’un concours immense de peuple et de corporations. Le citoyen Louis Blanc a voulu lui-même recevoir des mains des chefs et des délégués le projet d’association, et dans une chaleureuse et poétique improvisation sur l’influence salutaire de la musique, sur l’essence éminemment généreuse et divine de l’âme et du cœur du peuple, a promis de le remettre lui-même aux corporations, d’user de toute son influence, de coopérer de toutes ses forces à la réalisation de cette grande pensée. Les dispositions de notre organisation nous permettent de nous diviser par section, c'est-à-dire par corps de musique détachés dans des cas particuliers. Déjà plusieurs réunions et répétitions ont eu lieu dans la salle Saint-Jean, et les résultats en sont des plus satisfaisants. Trois principaux chefs ont été nommés par acclamation et à l’unanimité. Le citoyen Dufresne, chef général de toutes les musiques : le citoyen Juvin, administrateur, et le citoyen Meifred, conseiller rédacteur général ; quelques chefs de section ont été désignés provisoirement. Nous venons donc faire un dernier appel à tous sans exclusion, et prévenir ceux de nos collègues qui n’auraient point eu connaissance de notre organisation, et le nombre en est très restreint à cette heure, qu’ils aient à se faire inscrire et se joindre à nous à notre prochaine convocation, afin d’adopter un règlement et de procéder à une organisation toute définitive. Les fondateurs, Les citoyens Gossec et Sarrette devaient en rougir dans leurs tombes. C’est la première fois que l’on aborde de façon aussi avancée, depuis la Révolution de 1789, l’idée d’un enseignement « démocratisé » de la musique chorale et surtout instrumentale, à l’image de ce qui s’opère dans la pratique chorale orphéonique. De façon inattendue et nouvelle, cette masse d’instrumentistes parisiens (« quatre cents artistes ») réunit amateurs et professionnels. Le projet initial des citoyens Meifred, Juvinet, Dufresne [102] se concrétise timidement et partiellement dans les semaines qui suivent. « La garde de l’Hôtel-de-Ville a, aujourd’hui, une musique très nombreuse et bien organisée. Cette garde, après la parade qui a lieu sur la place de l’Hôtel-de-Ville, entre dans le jardin et donne chaque jour une aubade au maire de Paris pendant qu’il déjeune [103] ». C’est à l’occasion de la fête nationale du 14 mai 1848 dite « Fête Républicaine des Corporations » que l’éphémère Musique populaire de la République poussera son chant du cygne sans le savoir. La fête républicaine de dimanche dernier ne sera pas perdue pour l’art, la musique y a joué un rôle important. On a surtout remarqué la musique populaire de la République, fondée par M. Juvin et dirigée par M. Dufresne, composée de quatre cents artistes jouant les instruments en cuivre ; elle marchait immédiatement après le char, en tête des corporations ; indépendamment des morceaux spéciaux de son répertoire, elle accompagnait les airs nationaux et les chants patriotiques chantés par 500 jeunes filles et une partie de l’Orphéon. Plusieurs hymnes composés ou arrangés pour cette solennité devaient être exécutés avec les 1 200 Orphéonistes dirigés par M. Huber ; mais la tribune destinée à cette masse imposante ayant été envahie par la foule, cette exécution qui aurait été des plus belles par l’importance numérique des chanteurs, n’a pu avoir lieu [104]. Le rêve de la Musique populaire de la République et de la ville de Paris ne pouvait que s’affronter à de formidables résistances. La classe dominante n’était pas prête à entamer une politique d’ouverture culturelle et encore moins favoriser une culture de masse remettant en cause leur supériorité de caste. S’il n’y a pas ouverture, en dehors d’un orphéonisme tolérable mais peu dangereux, il y a autocélébration en essayant de contrôler, de maîtriser, entre autres, un répertoire, voire neutraliser l’effet populaire des chants révolutionnaires ou des musiques révolutionnaires. En ce sens, la bourgeoisie parisienne peut chercher à instrumentaliser un autre média d’importance, proche de ses attentes « de classe », contrariant l’image de la Musique populaire de la République : le Conservatoire de Paris. 4) Les musiques institutionnelles en province et le retour temporaire à la « normalité » à Paris. Dans la foulée des événements, et avec un joli brin d’opportunisme, les éditeurs musicaux parisiens fournissent une littérature « révolutionnaire » et républicaine. C’est le cas de l’éditeur Brantus ou de Meissonnier et fils qui publie une série impressionnante d’Airs nationaux pour musique militaire [105] écrits ou arrangés par Frédéric Beer (1794-1838). On y trouve essentiellement des pièces anciennes exhumées de la période révolutionnaire (1789-1799) du Consulat, de l’Empire et même de la Restauration : La Marseillaise, le Chant du Départ, une série de pas redoublés « du 5e régiment de ligne », des Enfants de la Patrie, de l’École Polytechnique, Hommage au drapeau, La Victoire est à nous, Veillons au Salut de l’Empire, Le Léger bateau, une valse favorite de M. de Lafayette, la marche Où peut-on être mieux, le Chant national des Polonais, etc. Il n’y a aucune originalité dans ce répertoire. Il est celui de la période précédente et l’on sent bien que l’éditeur cherche à faire du neuf avec du vieux. Les éventuels récepteurs de ces publications ne sont pas directement les musiques militaires ou associées de Paris, mais bien plus les musiques paramilitaires des Gardes nationales de province. Peu d’études ont été faites sur ces formations musicales en gestation, seules musiques institutionnelles pouvant se faire entendre en province, en dehors des musiques militaires casernées. Dopées par les effets de la Révolution et de la République, de nombreuses formations, réunissant amateurs et professionnels se créent en province, profitant de la liberté d’association, mais se plaçant sous l’autorité des élus locaux. Le 23 avril 1848, tous les Français sont appelés à élire une Assemblée constituante. À ce titre un rituel s’institue partout en France, mêlant autorités civiles et religieuses : le cortège (si possible en musique) des électeurs se déplaçant vers le chef-lieu de canton. Curieusement, Maurice Dommanget, évoquant l’événement en province, oublie que les seules musiques institutionnelles des villes moyennes ou des arrondissements ruraux sont celles des Gardes nationales. Aussi, tout naturellement, au sortir de la messe […] le curé prend-il la tête du cortège des paroissiens électeurs, grossi de leurs familles endimanchées, qui se dirige au chef-lieu de canton. Le maire, le juge de paix, l’instituteur, sont là aussi, au premier rang. Bannières et drapeaux se mêlent, cliques et orphéons complètent la note de fête spirituelle et patriotique [106]. Passées les élections du mois d’avril, le pouvoir veut revenir à une situation politique plus consensuelle tout en restant républicaine. Dans ce premier temps, la France connaît un véritable élan d'optimisme. L'armée se rallie au nouveau régime, des arbres de la liberté sont plantés et parfois même bénis par le clergé. La musique adoucirait-elle les mœurs ? La fête organisée à l’Élysée, début juin 1848, se veut fondatrice tout en révélant la volonté de renouer avec un passé déjà lointain. Il est question d’une grande fête musicale que doivent donner, le 7 juin prochain, des associations d’artistes réunies. Cette fête aura lieu dans le jardin de l’Élysée-National (ci-devant Élysée-Bourbon), où des solennités de ce genre avaient lieu sous le consulat et dans les premiers temps de l’empire. Il y aura non seulement musique instrumentale et vocale, exécutée par des masses nombreuses, sous la direction de chefs connus par leur talent, mais, en outre, le jardin sera illuminé de la manière la plus pittoresque, et un feu d’artifice original terminera la soirée. Nous publierons le programme détaillé dans notre prochain numéro [107]. L’unanimité de façade, née de l’enthousiasme des premières semaines ne dure pas. En avril 1848, lors de l'élection de l'Assemblée nationale constituante, le suffrage universel permet aux libéraux d'obtenir la majorité, dans une France encore rurale qui craint les grands changements. Dans le même temps une formidable pression « rouge » se nourrit des avatars nombreux de la crise économique. Le phénomène est parfaitement perceptible dans le monde musical. Dès le lendemain de la Fête de la proclamation de la République, le 4 mai, le Ménestrel relaie un plaidoyer prémonitoire de Louis-Désiré Besozzi [108] sur la Nécessité d’organiser le travail des ouvriers musiciens, publié par le journal la Démocratie pacifique. Il y a au moins 10 000 artistes à Paris, et en France plus de 60 000 peut-être. Cette armée se voit à la veille de manquer de pain. Si la première impression parmi les artistes a été l’enthousiasme pour le mouvement qui vient de s’opérer, le premier effet de ce mouvement a été d’amener pour eux la perspective de mourir de faim presque tous prochainement, et beaucoup immédiatement. Il n’y a ici aucune exagération ; la plupart des artistes vivent, sinon au jour le jour, au moins au mois le mois ; beaucoup, particulièrement les musiciens, ne gagnent que pendant l’hiver ce qui doit les faire vivre pendant le reste de l’année. Cet hiver est perdu pour eux par diverses causes qui peuvent se résumer en ces deux mots : crise financière. Pour les arts plastiques, plus de commandes ni d’achats ; le paiement des œuvres terminées, livrées ou en voie d’exécution est suspendu ; pour les musiciens, plus de fêtes particulières, plus de concerts, de bals ni de leçons ; les théâtres sont tous à la veille de fermer par leur nullité ou l’insignifiance de leurs recettes ; les églises suppriment leur musique ou diminuent des appointements déjà très modiques. Les arts industriels sont dans la plus complète stagnation, ainsi que les industries qui se rallient intimement à l’art et qui existent par lui. Enfin, si ce n’est quelques exceptions tout individuelles, tous tremblent pour l’avenir, et l’avenir, pour la plupart, c’est le lendemain. L’art étant en anarchie complète, l’art ayant vécu jusqu’à présent sans direction unitaire, ayant été rabaissé sous le règne dernier aux proportions mesquines d’influence gouvernementale, et même, dans les temps de sa plus grande splendeur, n’ayant jamais représenté que des expansions individuelles non reliées à des ensembles organisés ; en un mot, tout étant à faire dans l’organisation de l’art, ce n’est pas cette organisation que nous pouvons demander que l’on réalise du jour au lendemain, mais ce qu’exige notre position, et surtout ce qui est une condition de vie ou de mort pour l’art, comme pour l’artiste, c’est que l’on fasse pour nous ce que, par justice et prudence sociale, on fait pour les ouvriers en leur donnant des travaux malheureusement peu productifs. [...] En résumé, il y a en ce moment désorganisation, ou plutôt démoralisation complète dans le corps artistique [109] [...]. Les députés libéraux s'inquiètent du regroupement, à Paris, de cent cinquante milles ouvriers dans les Ateliers nationaux, qui pourraient constituer des foyers de propagation d'idées subversives. Prétextant leur coût (les Ateliers nationaux ne représentent en réalité que moins de 1 % du budget global du gouvernement) ils en décident la fermeture le 22 juin 1848. C’est la réforme de trop. Dès le lendemain l’est de Paris s’hérisse de près de quatre cents barricades. L’émeute est violente et la Garde nationale comme la Garde républicaine sont très divisées pendant ces événements. On retrouve des combattants des mêmes unités des deux côtés des barricades. La proclamation de l’état de siège par l’Assemblée nationale oblige le recours à l’armée qui jusqu’alors était confinée hors de Paris. Tous les pouvoirs sont alors confiés au général Louis-Eugène Cavaignac (1802-1857). En trois jours, la révolte populaire est durement réprimée par l’armée et les sections des Gardes nationales restées fidèles au régime. La Revue et Gazette musicale de Paris, bien que très modérée en matière politique, mais bourgeoise par son lectorat, ne peut être qu’ébranlée par les événements tragiques. L’autre semaine, en terminant ma lettre, je vous parlais de révolution, et voilà que nous avons eu quelque chose de bien plus formidable, un soulèvement de barbares, une révolte furieuse, acharnée, de toutes les mauvaises passions, qu’aucune révolution ne peut satisfaire, et qui veulent toujours recommencer. Pour cette fois, il n’y avait plus de dynastie à renverser, plus de charte à reconquérir, plus de droits à invoquer ! C’était la société même qu’il s’agissait de frapper à la tête et au cœur. La société s’est vaillamment défendue : elle a triomphé d’une horde sauvage, mais au prix de quel sang, de quelles larmes, et que de sombres pensées l’inexorable nécessité d’une telle victoire ne jette-t-elle pas dans les esprits ! Serait-il vrai que la civilisation pût reculer à l’heure où nous devions la croire plus avancée que jamais ? Serait-il vrai qu’après tant de siècles nous en fussions encore aux questions agitées sur le mont Aventin, au problème des lois agraires, à la guerre des Spartacus, transformés en ouvriers ? Serait-il vrai que lorsque les nations ne se font plus la guerre entre elles, il faut qu’elles se la fassent à elles-mêmes, de citoyen à citoyen, et que l’état actuel de l’Europe, où tant de nations déchirent leurs entrailles, fût le résultat inévitable de trente années de paix ? Serait-il vrai qu’après avoir atteint la vérité morale et politique, l’homme fût condamné à se rejeter dans l’erreur, au point de renverser tous les axiomes, de retourner toutes les maximes et de préconiser le mal par dégoût et par ennui du bien ? Nous avons tous montré de la résolution, du courage contre les coups de fusil, qui donnent la mort ; pourquoi n’en montrerions-nous pas autant contre les fatales doctrines qui excitent à la donner ? Pourquoi tous les écrivains, tous les penseurs éclairés et honnêtes ne se ligueraient-ils pas contre les affreuses doctrines qui perdent tant de malheureux ? Quand on prêche tous les jours à des gens dépourvus de sens et de lumières que la propriété est un vol, le commerce un brigandage, ils finissent par le croire, et ils en concluent naturellement que le pillage est un droit, l’assassinat un devoir. Et nous voyons comment on applique cette morale de forçats libérés ! Le paradoxe littéraire a préludé chez nous au paradoxe politique et social. Le premier amuse, mais le second tue, non seulement un homme, mais un pays tout entier [...] [110]. Là où l’auteur anonyme travestit la réalité, c’est que le mouvement de juin fut loin d’être une simple révolte. Il s’agit plus d’une guerre civile aux épouvantables conséquences humaines. Elle totalise quinze milles victimes de tous âges et de toutes conditions, dont mille huit cents morts pour les forces de l'ordre et quatre milles tués pour les insurgés (sur vingt-cinq milles combattants), sans évoquer les arrestations, les procès et les déportations ou « transportation » des parias au lendemain des événements. Le traumatisme est profond. Ce qui marque le temps des semaines suivantes sera un deuxième temps de silence long et lourd. III. Le temps du silence et la réhabilitation de l’armée Grand Dieu ! par des mains enchaînées Pas de chants, pas de musique ! Voilà malheureusement la conséquence d’une guerre impie et sauvage, comme celle que nous venons d’avoir à soutenir ! Écoutez dans nos rues, sur nos places ! Le silence !... partout le silence ! Et qui se sentirait le chœur de chanter après de tels combats, après une telle victoire, même dans un pays, où, jadis, tout finissait par des chansons ? Aux chansons, qui duraient depuis Mazarin, succédèrent les hymnes patriotiques, la Marseillaise, le Chant du départ : Juillet [1830] eut sa Parisienne, Février [1848] ses Girondins, mais Juin n’aura rien qu’un De profondis : Juin a fait taire toutes les chansons, tous les hymnes anciens et nouveaux : Juin a marqué en traits de sang, dans nos annales, une époque dont nous n’avions pas l’idée, une époque bien nouvelle et bien étrange en France, que la postérité frémissante pourra désigner par ces mots seulement : « L’époque où l’on ne chantait pas » [112]. Il paraît en effet bien loin ce temps où les masses chantantes rassuraient les Parisiens lors des nuits de février. Et le ressentiment est fort contre ces « partageux », « communistes », « anarchistes », « socialistes-libertaires » ou « mutuellistes ». Même la Marseillaise est devenue l’épouvantail, l’objet qui étymologiquement inspire de vaines terreurs. Cinq mois sont à peine écoulés, et, dans la fièvre de civilisation – des esprits chagrins disent de dissolution – qui nous travaille, nous avons tout usé, république sociale, démocratique, bourgeoise, gouvernements d’avocats, de savants, d’ignorants, de poètes, de militaires ; et au milieu de ce tohu-bohu de recherches de formes gouvernementales, l’art musical s’est tu, comme on le pense bien ; car il n’y avait rien d’harmonieux dans la Marseillaise provoquant à verser le sang impur des soldats étrangers qui ne sont guère plus féroces que nous, et ne songent nullement à venir mugir dans nos campagnes. Même avant que la guerre civile vint rugir dans la cité les chants avaient cessé. Il faut espérer qu’ils vont reprendre : c’est un des meilleurs moyens de persuader l’Europe pour laquelle la France, Paris surtout, est un objet d’anxieuse curiosité, que notre capitale peut redevenir le centre des arts et de la civilisation [113]. La cérémonie funèbre du 6 juillet 1848, voulue pour honorer les « victimes des glorieuses journées de juin » (formule désignant les seuls soldats, gardes nationaux et gardes mobiles tombés pour la défense de la légalité et excluant de fait les insurgés) voudrait introduire, dans l’esprit de ses organisateurs, un esprit d’apaisement et de concorde nationale retrouvée. Après le temps de l’hécatombe, c’est celui du recueillement et de la célébration pour les « gardiens de l’ordre » que furent les troupes militaires, instruments de la répression. Ce que le Constitutionnel résume par la formule « La fraternité du deuil couronnait la fraternité du sang répandu » et de préciser « pour la première fois, dans la longue série de nos luttes intestines, la province avait à prendre sa part de cette cérémonie funèbre [114] ». La déambulation du char funèbre lie deux lieux parisiens très symboliques. Débutée place de la Concorde, elle se termine place de la Bastille, lieu où les victimes sont inhumées dans les caveaux déjà peuplés des victimes des Trois Glorieuses de 1830 et de celles de la Révolution de février. Le programme voulu pour cette cérémonie funèbre montre bien l’autocensure dont font part les vainqueurs vis-à-vis des vaincus, une victoire aux goûts amers. La musique ne peut être ni celle des uns, ni celle des autres. Seul le chant liturgique apolitique trouve une place consensuelle. La messe ne sera accompagnée d’aucune musique si ce n’est du chant d’église. [...] Le cortège défilera dans un profond silence, qui ne sera interrompu que par des roulements de tambour et par des chants d’église. [...] Arrivés sur la place de la Bastille, le char et le cortège s’arrêteront à l’entrée des caveaux où seront déposés les cercueils. Un De profondis sera chanté par le clergé [115]. Le « retour à la normalité », autrement dit, le retour à l’ordre, est soutenu par les campagnes françaises et tous ceux que les « rouges » de juin 1848 avaient effrayés. Le politique se radicalise. 1) Réhabiliter l’armée et le Gymnase musical militaire Le concept de concerts usant de masses instrumentales et vocales avait fait espérer la démonstration d’unité du peuple de Paris, mêlant symboliquement artistes et orphéonistes, professionnels et amateurs. L’idée reprise par l’ Association des artistes musiciens au bénéfice de sa caisse de secours, faisait espérer une fête à la fois musicale et foraine permettant de faire se côtoyer bourgeois et ouvriers. La musique n’adoucit-elle pas les mœurs ? L’Association demande et obtient l’usage des jardins de l’« Élysée National [116] » pour quatre dimanches consécutifs. Les formations musicales sollicitées mêlent la Société de musique populaire de la ville de Paris [117], le Conservatoire, les orphéonistes (école Chevé, l’Athénée musical populaire, les Enfants de Paris, enfants des écoles) soit 300 instrumentistes et 900 choristes. À cet ensemble s’ajoutent les musiques de douze régiments, soit 300 musiciens-militaires. Le programme annoncé lors de la première de ces fêtes, le 24 septembre, est loin d’être banal.
Ce seul programme mériterait un regard approfondi. Il est bien évident qu’il n’a pas été choisi au hasard. Il célèbre les défenseurs de la patrie (marche militaire, garde mobile, « amour sacré de la patrie » du duo de la Muette, l’appel au combat) tout en sacralisant la République (Marseillaise de 1848, Guillaume Tell et marche républicaine) et la liberté (Moïse). Chacun pourra noter la substitution des paroles originales de la Marseillaise par un texte du chansonnier et auteur dramatique Édouard Plouvier (1821-1876). Enfin cette programmation tient compte d’un répertoire déjà pratiqué par l’Orphéon parisien dans le temps de la Révolution de février. Le succès de cette première fête permet de la réitérer les 1er, 8 et 15 octobre suivants. Un concours de musique militaire est alors organisé. ÉLYSÉE NATIONAL. Le troisième festival, donné dimanche dernier dans ce jardin célèbre, avait encore attiré la foule, qui venait jouir à la fois d’une bonne musique et des derniers beaux jours, sous des ombrages ravissants. Aujourd’hui, une solennité d’un genre tout à fait neuf et du plus haut intérêt se célèbrera dans la même enceinte. Un concours aura lieu entre les corps de musique des vingt quatre régiments en garnison à Paris : les 11e léger, 59e de ligne, 48e de ligne, 61e de ligne, 4e de ligne, 21e de ligne, 75e de ligne, 1er léger, 45e de ligne, 52e de ligne, 59e de ligne, 18e de ligne, 29e de ligne, 14 e léger, 24e léger, 57e léger, 74e léger, 7e léger, 9e léger, 24e de ligne, 26e de ligne, 2e dragons, 5e lanciers. Un jury spécial, composé de MM. Adolphe Adam, Bauller, Caussinus, Kastner, Louis, Meifred et Vogt, décernera les prix, consistant en une médaille d’or et quatre médailles de vermeil. La Société des Enfants de Paris, dirigée par M. Philips, exécutera sans accompagnement les morceaux suivants :
Il y aura aussi des jeux, des physiciens, des marchands : il n’est donc pas douteux que la foule ne se presse de nouveau à cette fête, qui sera la dernière de l’année. Le prix d’entrée est fixé à 1 franc : moyennant un supplément de 50 centimes, on se procurera des places réservées sur l’estrade [119]. Ainsi, dans ce programme vocal, réapparait le Chant du Départ de Méhulet Chénier (1794), jouxtant des œuvres déjà entendues le 24 septembre précédent : la Marche républicaine d’Adolphe Adam ou encore La Mobile, célébrant la Garde nationale mobile [120] du ministère de l’Intérieur, créée fin février 1848. 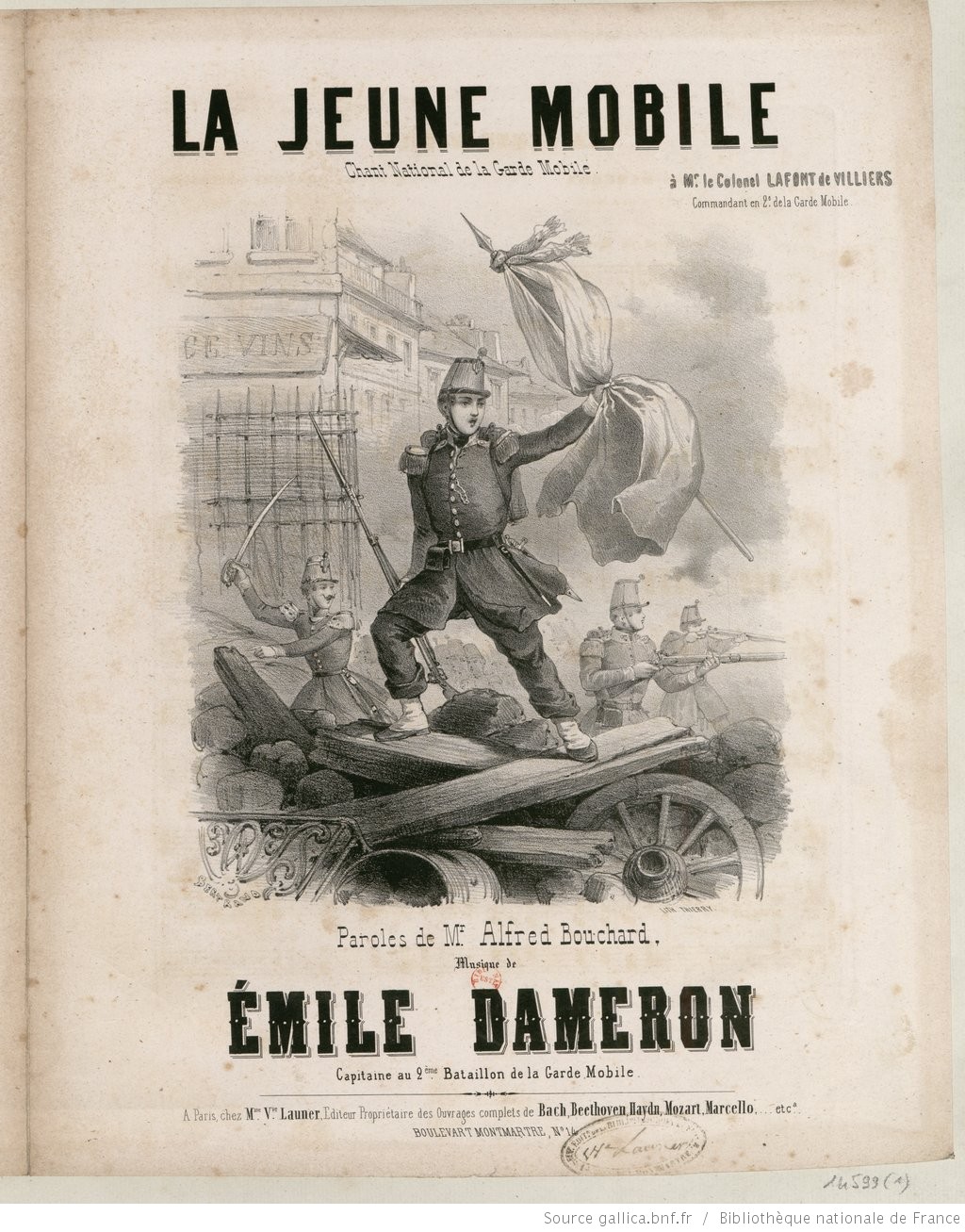 La Jeune mobile, chant national de la Garde mobile, lithographie de Bertrand et Thierry (image : h : 20 cm, l : 18 cm ; ensemble : h : 34 cm, l : 27 cm), chez Madame V.ve Launer Éditeur, Paris, 1848 Domaine public, Bibliothèque nationale de France Notice Gallica Mais l’intérêt de ce concours, c’est aussi, dans une « politique de communication » avant l’heure, d’honorer discrètement mais fermement des régiments ayant particulièrement participé aux événements de juin. La mobilisation des musiques militaires n’est pas due au hasard. Elle répond aux injonctions du général Cavaignac, du général Changarnier, commandant de la division de Paris et de la Garde nationale ou plus encore du général de La Moricière (1806-1865) devenu ministre de la Guerre le 28 juin. Dernièrement a eu lieu, à l’Élysée, un concours fort intéressant entre la musique militaire de divers régiments en garnison à Paris. Deux régiments de cavalerie, lanciers et dragons, et dix-huit régiments d’infanterie ont pris part à ce concours, qui avait attiré une grande affluence d’auditeurs. Le jury, présidé par M. Ad. Adam, était composé de MM. Meifred, secrétaire, Vogt, Louis, Caussinus, Bauller et Klosé. Les musiques de cavalerie ne se composant pas des mêmes éléments que celles de l’infanterie, un concours à part avait été établi pour elles. Une médaille de vermeil a été décernée au 5e lanciers. Une médaille d’or a été obtenue par le 21e régiment de ligne, et quatre médailles ont été remportées par les 73 e, 52e, 59e et 48e régiments de ligne. Le jury a regretté de ne pouvoir disposer d’un plus grand nombre de médailles, car ce concours, presque improvisé, constate une très-grande amélioration dans les musiques militaires. Ce progrès est dû, en grande partie, à l’établissement du Gymnase de musique militaire, qui, chaque année, dote l’armée d’excellents chefs de musique, destinés à leur tour, à former des élèves au régiment. Beaucoup de musiciens se trouvaient ainsi, une fois leur temps rempli, sortir du service avec un talent quelquefois remarquable, et une profession d’artiste qu’ils n’ont dû qu’à l’accomplissement de leur obligation pour le service militaire. Une circonstance intéressante se rattache au corps de musique du 48e de ligne, à qui une médaille de vermeil a été accordée. On sait, en effet, que ces cinquante musiciens et leur chef, M. Henricet, ont seul défendu la caserne du faubourg St Antoine contre les insurgés, pendant les fatales journées de juin. La musique du 48e n’est plus au complet, mais elle a su racheter par le fini de l’exécution l’insuffisance du nombre, dont la cause était d’ailleurs un titre glorieux [121]. Comme le commente justement le Moniteur de Vienne, la réhabilitation du Gymnase musical militaire est en cours. Curieusement c’est à l’occasion d’un nouveau concours de musiques militaires à l’Élysée que l’on perçoit mieux encore les revirements et la reprise en main par le pouvoir politique et militaire dans l’automne 1848. Au premier concours, toutes les musiques de garnison n’avaient pu se trouver réunies. Dans une deuxième épreuve, qui a eu lieu dimanche dernier sur la pelouse de l’Élysée-National, dix corps de musique ont été successivement entendus. [...] En résumé, ce dernier concours a confirmé l’opinion précédemment émise par le jury sur les incontestables progrès de la musique militaire en France. Cette observation a sa valeur dans un moment où l’on se préoccupe à tort ou à raison de la suppression projetée du gymnase musical. Le comité de l’Association, qui, le premier, a constaté dans des épreuves officielles et publiques le degré de développement de cette puissante branche de l’art, emploiera toute son influence, nous n’en doutons pas, pour prévenir une mesure aussi désastreuse, déguisée sous le masque d’une déplorable économie. D’autre part, nous l’engageons à provoquer d’utiles améliorations soit dans l’organisation des musiques militaires, soit dans les conditions d’étude imposées au gymnase musical. C’est là surtout que son attention doit se diriger, c’est là qu’il y a de sérieuses réformes à poursuivre et à accomplir [122]. La charge avait été rude contre Carafa et le Gymnase musical militaire avant juin 1848. Mais vanter les mérites du Gymnase ne calme pas tous les reproches. Une série d’articles publiés dans la Revue et Gazette musicale de Paris [123] entre septembre et octobre 1848 continuent d’accabler l’institution et son directeur. Ce qui est alors reproché à Carafa est d’être responsable de l’ordonnance d’organisation (certains pourraient dire de désorganisation) du 24 mars 1848 contre les instruments Sax. La chose semble d’ailleurs réglée en ce qui concerne le sort du Gymnase musical. [...] Un décret du mois d’avril dernier, rendu par le gouvernement provisoire, a supprimé le Gymnase musical à compter du 16 septembre 1848. Nous savons maintenant, de source certaine, que le gouvernement va s’occuper de la réorganisation de cet utile établissement. [...] il nous paraît indispensable de parler des capacités que le ministre de la guerre sera en droit d’exiger du nouveau directeur [124]. Très curieusement, la « source certaine » se trompait. Le 1er octobre, la Revue et Gazette musicale de Paris introduit un court entrefilet : « Un décret, émané du ministère de la guerre, vient de proroger pour six mois l’existence du gymnase musical militaire [125] ». En réalité il n’est absolument plus question de supprimer ou de réformer le Gymnase ni même de remercier son directeur. La réforme ne passe pas auprès des militaires et il faudra attendre encore quelques années (1856) pour que l’institution soit abolie. 2) Contrôler l’orphéonisme Si la légitimité de Joseph Hubert, le directeur de l’Orphéon de Paris, est temporairement contestée, d’autres musiciens influencés par le rôle social que pouvait jouer la musique n’hésitèrent pas à s’engager sur le terrain des réformes. Telle est la mission que se fixe le citoyen Eugène Delaporte (1818-1886). Si Delaporte eut un tort, ce fut celui d’être un provincial, mais son portrait, bien que ressemblant plus à l’hagiographie d’un saint missionnaire qu’à celle d’un organisateur méthodique, publié bien des années plus tard dans la Monographie universelle de l’Orphéon [126], nous dit son action à la veille des événements de 1848. Né à Paris. À sa sortie du Conservatoire, où il suivit la classe de Zimmermann, il alla se fixer à Sens pour y exercer la profession d’organiste à la cathédrale. Pénétré de l’influence civilisatrice du chant sur les masses, rempli de la foi la plus robuste dans le résultat de la noble campagne qu’il allait entreprendre, Delaporte quitta sans regret une position lucrative pour aller prêcher dans les moindres bourgades l’union et la fraternité au nom de l’art musical. Un simple bâton de voyageur à la main, le missionnaire dévoué du chant d’ensemble, digne propagateur de la belle doctrine de Wilhem, créait sur sa route des associations dont les éléments réunissaient toutes les classes de la société. Mais, pour atteindre ce but, à quels persévérants efforts n’a-t-il pas dû faire appel ! Delaporte seul, a écrit Oscar Comettant, aurait pu dire toutes les tribulations de son apostolat artistique, ce qu’il a eu de difficultés à vaincre, d’antipathies à combattre, de doutes à relever, de susceptibilités à ménager, d’amours-propres à concilier, de défaillances à ranimer, de sottises à écouter, d’humiliations à dévorer, de privations à endurer et de calomnies à subir (Félix BOISSON [Notes intimes]) [127]. Avec l’appui du philanthropique baron Taylor, président entre autres de l’Association des Artistes musiciens, Delaporte s’était approché du Gouvernement provisoire. Il soumet, en juillet 1848, un projet approuvé par le ministre de l’Intérieur à l’Assemblée nationale, « où il prône une arme capitale pour “propager la Sainte Fraternité” et dissiper avec l’aide de la science les ténèbres du fanatisme et de l’ignorance : le développement de la musique chorale. Le rêve d’une harmonie sociale passe un temps par la pratique artistique » comme l’écrit si bien Sylvie Aprile [128]. Et Delaporte obtient un sauf-conduit qui ressemble, sous bien des aspects, à un ordre de mission :
Citoyen préfet, Le citoyen Delaporte, professeur de musique, désirerait établir un vaste système d’éducation musicale par l’application de la méthode Wilhem, et organiser en province, sur une grande échelle, des réunions analogues à celles de l’Orphéon à Paris. Ce projet me paraissant mériter d’être sérieusement encouragé, je vous prierai, citoyen préfet, de vouloir bien donner au citoyen Delaporte toutes les facilités nécessaires pour qu’il puisse le mettre à exécution dans le ressort de votre département. Salut et fraternité Le Ministre de l’intérieur Delaporte put donc devenir missionnaire, porter la bonne parole et l’orphéonisme put se développer avec facilité hors de Paris. Dès 1849 le premier festival-concours chantant organisé par Eugène Delaporte à Troyes regroupe neuf sociétés chorales et deux cents voix. Ce sont des débuts très modestes mais il faut bien un début à tout. L’institution des concours orphéoniques était appelée à recevoir un développement considérable et devint une « marque de fabrique » des orphéons vocaux puis instrumentaux. Cependant Joseph Hubert fut maintenu dans ses fonctions parisiennes de Directeur et demeurera à ce poste jusqu’en 1852. La Direction générale de l’enseignement et de l’Orphéon (de Paris) est alors confiée à Charles Gounod (1818-1893), Hubert restant inspecteur. 3) L’expiation d’Adolphe Sax Nombreux ont été ceux qui voulurent défendre Sax, mué en « martyr » [130] (Kastner, Comettant, Berlioz, Neukomm, Pontécoulant, etc.), personnellement visé par les décrets du Gouvernement provisoire de mars 1848. L’inventeur tente de sauver son entreprise, avec la collaboration de François Joseph Fétis (1784-1871), directeur du Conservatoire de Bruxelles depuis 1832, en investissant une réforme des musiques militaires belges. Parmi les notabilités frappées par le tohu-bohu général, se trouve Adolphe Sax ; mais homme de courage et de résolutions, il ne se laisse point abattre par la mauvaise fortune, et tandis que la situation de la France compromet son industrie artistique, il cherche ailleurs à s’ouvrir des débouchés. Un jury ayant été nommé par le ministre de la guerre, en Belgique, pour l’amélioration des corps de musique militaire, qui sont cependant très bons en général, et votre correspondant en ayant été nommé le président, Sax a cru le moment favorable pour faire adopter son système d’instruments, et en a envoyé une cargaison ; mais il y a dans toutes les administrations des difficultés contre ce qui est nouveau, des lenteurs insurmontables, et la force d’inertie ou l’esprit d’intrigue qu’on y oppose aux hommes de résolution et d’activité ne sont pas de médiocres obstacles. [...] Signé FÉTIS père [131]. Là encore, il faudra attendre en France un autre pouvoir et une autre autorité pour réformer à nouveau l’instrumentarium des musiques militaires [132]. Malgré l’introduction de quelques-uns de ses instruments au Conservatoire de Paris en octobre 1848, Sax fera faillite en 1852. Au nom du libéralisme économique, et en réaction contre le pouvoir politique de la Monarchie de Juillet, considérant le « fait du prince » inacceptable par la nation républicaine, les musiques militaires vont se retrouver devant une situation des plus confuses. Certaines sont déjà équipées d’instruments « Sax » neufs. D’autres se retrouvent avec des juxtapositions d’instruments toujours aussi hétéroclites et peu satisfaisantes. En fait, pour l’instrumentarium des musiques militaires, rien n’est vraiment réglé avant une autre réforme, celle de 1855, marquant le triomphe « définitif » de Sax et de ses instruments. L’adoption de la Constitution, le 4 novembre 1848, est célébrée en musique par un Te Deum [133] très conservateur marquant l’alliance retrouvée, cette fois dans l’ordre, de l’Église et de la République. Ainsi, suite au vote de la nouvelle constitution, cette dernière fut lue au peuple, et officiellement proclamée, lors de ce que Rémi Dalisson qualifie de « cérémonie morose et au didactisme désuet, pour clore l’année de toutes les illusions [134]… » Les fêtes populaires de la Constitution sont l’occasion d’étoffer plus encore le répertoire des musiques militaires. Les musiques militaires de l’armée et de la garde nationale n’apprendront pas sans plaisir que les douze beaux morceaux composés par Fessy et Dufrène pour les grandes fêtes de la Constitution vont paraître au Ménestrel, pour harmonie et pour fanfares. Six de ces morceaux sont déjà en vente, non seulement au Ménestrel, 2bis, rue Vivienne, mais aussi chez Darche, fabricant d’instruments et fournisseur breveté des armées et de la garde nationale [135]. L’élection présidentielle est fixée au 10 décembre 1848. Le scrutin consacre la large victoire de Louis Napoléon Bonaparte. Ainsi, ce dernier recueillit à lui seul 74,2 % des suffrages, soit cinq millions et demi de voix. Du prince-président à Napoléon III il n’y a qu’un pas, mais ceci est une autre histoire. IV. Conclusion 1848 fut bien marquée par des temps de silence et ne peut rester un repère dans la pure musicologie classique au su de la piètre qualité des créations musicales « sérieuses » au long de l’année [136]. À cette situation musicale peu attractive, l’historien trouve, en revanche, dans les affres de la vie politique et sociale un intérêt particulièrement vif. Le nombre impressionnant d’ouvrages consacrés à cette seule année depuis un demi-siècle montre tout son intérêt. Et le sujet semble assez inépuisable. 1848 ne fut pas qu’un temps d’« interruption momentanée » du son. Si celui du canon put faire trembler bien des murs et briser bien des vitres, les voix du peuple, organisées et musicales, rappellent les grandes heures de la Révolution de 1789. Les tentatives d’instrumentalisation des fêtes ou des ensembles musicaux militaires ou paramilitaires par le pouvoir politique nous disent à la fois les temps d’un silence rendu volontaire par l’autorité ou celui d’un « retour à la normale » selon les options politiques qui s’égrènent en quelques mois. 1848 encore, fut cet instant hésitant où musique populaire et musique mondaine s’étreignent ou s’éloignent, valse-hésitation qui de la réforme à la concorde ou du chant d’espoir au chant de gloire pourrait passer pour un modèle des implications de la musique dans la vie quotidienne des Français. L’orphéon pouvait donner de la voie et ne s’en privera pas dans les décennies suivantes. 1848 enfin, fut bien une année en France où musique, pouvoirs et politique se croisent, se mêlent et s’éclairent mutuellement. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Patrick Peronnet Docteur en musicologie Université Paris-Sorbonne - IReMus (Observatoire musical français) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[1] Chœur des Girondins, « hymne » de la Deuxième République. Lire à ce sujet Pierre Constant, Les hymnes et chansons de la Révolution, Paris, Imprimerie nationale, 1904, p. 275-278, et supra note 17. [2] Marc Pincherle, Petit lexique des termes musicaux, Paris, Choudens, 1973, p. 42. [3] Référence à Sylvie Aprile, 1815-1870, La Révolution inachevée, Paris, Belin, 2010, p. 266. [4] Henri Blanchard, « Concert au bénéfice des blessés de juin », Revue et Gazette musicale de Paris, 25 juillet 1848, n° 30, [15e année], p. 5. [5] La Marseillaise, 9e couplet. [6] Pierre Barret et Jean-Noël Gurgand, Le printemps de Paris, 22 février – 25 juin 1848, Paris, Fayard-Hachette, 1988, p. 151-152. [7] Référence aux Trois Glorieuses de la Révolution de 1830 qui mit Louis-Philippe sur le trône. [8] Revue et Gazette musicale de Paris, 27 février 1848, n° 9, p. 1. [9] Ibid., p. 4. Cette situation est encore perceptible dans l’encart publicitaire de la maison Brandus et Cie, éditeurs de musique, inséré dans la même page :
« Au public, Pendant les grandes journées dont Paris vient d’être le théâtre, nos magasins de musique sont restés fermés parce que leurs chefs et employés ne pouvaient, ne devaient avoir d’autre occupation que la conquête de la liberté d’abord, et ensuite le maintien de l’ordre ; mais l’ordre étant rétabli, nos magasins se sont aussitôt rouverts, et rien ne sera changé à leur direction ni à leurs habitudes. Le public est prévenu qu’à partir de demain, lundi, jusqu’au dimanche suivant inclusivement, le produit intégral de la vente qui s’y fera est consacré aux glorieuses victimes de février. » [10] Maurice Bourges, Revue et Gazette musicale de Paris, 3 septembre 1848, n° 36, p. 3. [11] Charles Blanc (1813-1882), historien, critique d’art et graveur, arrive à Paris en 1830, avec son frère Louis, de deux ans son aîné. Il étudie la gravure dans l'atelier de Luigi Calamatta, rédige des comptes rendus de Salons et des notices artistiques dans le Bon Sens, dont Louis Blanc était rédacteur en chef, puis dans la Revue du progrès, le Courrier français et L'Artiste. En 1841, il prend la direction du Propagateur de l'Aube, puis celle du Journal de l'Eure.
[12] Léon Halévy (1802-1883) journaliste, poète, auteur dramatique et historien français, fut le dernier secrétaire de Saint-Simon, après Auguste Comte. Il est ainsi un compagnon de Saint-Simon pendant la dernière année de sa vie, avec Olindes Rodriguès. Après la mort de Saint-Simon (19 mai 1925), il fait partie du premier noyau initial des adeptes de la pensée saint-simonienne. [13] Discours d’Halévy reproduit dans Revue et Gazette musicale de Paris, 23 avril 1848, n° 17 [15e année], p. 2. [14] Revue et Gazette musicale de Paris, 28 mai 1848, n° 22 [15e année], p. 6. Victor Hugo sera élu député le 4 juin 1848. [15] Maurice Bourges, Revue et Gazette musicale de Paris, 14 mai 1848, n° 20, p. 1-3. [16] « Varney ne fut pas sans en tirer quelque gloire. Le Chant des Girondins fut, pour cet excellent homme, ce que fut Guillaume Tell pour Rossini. Lorsque, en 1848, on le nomma chef de musique de la garde nationale, ce chant devint le thème favori de son orchestre. Aimez- vous les Girondins ? on en a mis partout. Comme Maquet n'avait pas manifesté le même enthousiasme pour son œuvre préférée, il prenait un malin plaisir, toutes les fois qu'il en trouvait l'occasion, à la faire exécuter sous ses fenêtres. Si la République avait eu la vie plus dure, l'infortuné collaborateur de Dumas serait devenu fou.
Le plus drôle de l'histoire, c'est que Dumas, par un de ces prodiges d'imagination dont il avait le secret - peut-être une réminiscence de jeunesse- trouvant, au contraire fort à son goût la musique de Varney, se figura qu'elle était de son cru. Mais, comme il a toujours beaucoup plus usé de la clé des champs que de la clé de sol, il se faisait renseigner en cachette sur les modulations, et, tandis qu'on répétait, il disait, d'un air entendu, à son chef d'orchestre : « Ici, vous auriez dû mettre un si bémol. » Le malheureux musicien eût avec joie étranglé son sublime plagiaire. On se demandera peut-être pourquoi Dumas et Maquet, au lieu de se donner la peine de trouver un hymne nouveau, ne prirent pas tout bonnement la Marseillaise, qui jouissait alors de la tolérance gouvernementale et se chantait quotidiennement dans la rue. Dame, du moment qu'elle était permise, la Marseillaise n'avait plus de charme ! Et puis, c'était l'air favori de Louis-Philippe, qui, chaque fois qu'il prenait l’air à son balcon, fredonnait entre ses dents : Aux armes, citoyens ! Deux vices rédhibitoires ! » Extrait de « La Patrie », Le Figaro, 29 décembre 1888. [17] Pour le refrain, déjà présent dans le roman, le parolier et le musicien avaient emprunté les deux vers au Roland à Roncevaux, chant de guerre de Rouget de Lisle écrit en mai 1792. De son propre aveu, ce dernier avait fait l’emprunt de ces mêmes vers à Guillaume Tell, opéra-comique en 3 actes, paroles de Sedaine et musique de Grétry. [18] La France musicale, 12 mars 1848, n° 11 [11e année], p. 79. [19] La société orphéonique « Les Enfants de Paris » a été créée en 1841. Sous la direction de Philipps elle a intégré à son répertoire la Marche de Sarah (Grisard, 1835), le Silence (Carulli, ca 1841) et le chœur de Charles VI (Halévy, 1841). Adolphe Adam (1803-1856) leur dédie le chœur Les Enfants de Paris en 1846. [20] Jules Lovy, « Rouvrez vos salons ! », éditorial du Ménestrel, dimanche 27 février et 5 mars 1848, nos 332-333 [15e année, n° 13-14], p. 1. [21] Georges Kastner, « La Marseillaise et les autres chants de Rouget de Lisle », Revue et Gazette musicale de Paris, 26 mars 1848, n° 13, p. 1-3, 9 avril 1848, n° 15, p. 1-3 et 16 avril 1848, n° 16, p. 2-4 [15e année]. [22] Ibid., 26 mars 1848, p. 1. [23] Maurice Dommanget, De la Marseillaise de Rouget de Lisle à l’Internationale de Pottier. Les leçons de l’histoire, Paris, Librairie populaire, 1938. [24] Jean-Michel Gorby, « Le progrès d’Indre-et-Loire, journal républicain », Mémoires de l'académie de Touraine, Tome 20, Communication du 4 mai 2007. En ligne sur : http://academie-de-touraine.com/Tome_20_files/progres.pdf.
[25] Chants patriotiques de la France avec planches dessinées de J. Bour, Paris, Brandus, avril 1848. Le recueil contient : n° 1. La Marseillaise, n° 2. Le Chant du Départ, n°3. Le Vengeur, de Rouget de Lisle, n°4. Roland à Roncevaux, de Rouget de Lisle, n°5. Chant des Travailleurs, paroles et musique de Rouget de Lisle, n°6. Guerre aux Tyrans, d’Halévy. [26] Lire à ce sujet Sophie-Anne Leterrier, « Du patrimoine musical. Le Concours de chants nationaux de 1848 », Revue d’histoire du XXe siècle, n° 15, « 1848, Nouveaux regards », 1997, ou encore Fridériki Tabari-Iona, Chants de liberté en 1848, Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques historiques », 2001.
[27] Le Ménestrel, 16 avril 1848, n° 339 [15e année, n° 20], p. 2. [28] La Parisienne, chanson de Casimir Delavigne composée peu de temps après la Révolution de 1830 et en hommage à celle-ci. Elle se chante sur l'air d'une marche militaire allemande Ein Schifflein Sah Ich Fahren harmonisé par Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871). [29] Henri Blanchard, « De la question artistique et musicale », Revue et Gazette musicale de Paris, 28 mai 1848, n° 22 [15e année], p. 4. [30] Antoine-Amable-Élie Elwart (1808-1877), compositeur et musicologue. [31] « Jury du Concours des chants nationaux », Revue et Gazette musicale de Paris, 30 juillet 1848, n° 30, p. 5-6. [32] Jacques Gabriel Prod’homme, « La Musique et les Musiciens en 1848 », Sammelbände des Internationalen Musikgesellschaft, octobre-décembre 1912, p. 155-182. [33] Jean-Étienne Guillaume Arnaud (1807-1863), musicien et parolier. [34] Paul Henrion (1819-1901), compositeur, « goguetier » ou chansonnier, auteur de nombreuses chansons et romances, sera un des fondateurs, en 1866, de la Société des Auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. [35] Jenny l’ouvrière, romance populaire, musique d’Étienne Arnaud (1848). Les paroles d’Émile Barateau louent le caractère d’une tisseuse dure à la tâche, pauvre mais fière et courageuse. La chanson est alors assez célèbre pour que « Jenny » devienne un nom générique pour désigner le genre fantasmé et héroïque de la jeune ouvrière qui résiste aux coups durs et surmonte les malheurs de la vie. [36] Dieu et ma Mère, romance pour piano et chant, paroles et musique de Paul Henrion, Paris, Colombier, 1848. [37] Pierre-Jean de Béranger (1780-1857), célèbre et populaire chansonnier. En 1848 il fait partie, à l’Élysée, de la commission des secours, dignité non lucrative, mais qui convenait à son cœur. À cette occasion il reçoit l'hommage de 800 chanteurs, musiciens et mendiants des rues. Ils sont conduits par son ami Aubert (1769-1857), syndic et doyen des chanteurs des rues de Paris. La même année, élu représentant du peuple, il refuse de siéger. Aussi bienfaisant que désintéressé, il n’use de son crédit que pour rendre service.
[38] Le Ménestrel, 21 et 28 mai 1848, nos 344-345 [15e année, nos 25-26], p. 3. [39] Lire à ce sujet Jean-François Brient, Poésie et révolution à Paris en 1848, mémoire sur l’effervescence populaire et la spontanéité créatrice à Paris de février à décembre 1848 à travers l’étude des chansons révolutionnaires, Paris, Les Temps bouleversés, 2003. En ligne : www.lestempsbouleverses.org/images/poesie.pdf.
[40] Julien Martin d’Angers, Marseillaise de la Paix, sous-titrée Vive Paris ! vive la France !, Paris, Richault, 1848. [41] Martin (d’Angers), « Avenir musical : Le conservatoire, les théâtres, le Gymnase militaire et l’Orphéon », La France musicale, 19 mars 1848, n° 12 [11e année], p. 82-83. [42] Revue et Gazette musicale de Paris, 31 octobre 1841, n° 57 [8e année], p. 484. [43] Julien Martin d’Angers, De l’Avenir de l’orphéon et de toutes les écoles populaires de musique en France, Paris, Proux et Cie, 1846. [44] Julien Martin d’Angers, Plain-chant populaire pour tous les offices de l’année, noté dans la voix naturelle du clergé et des fidèles, et harmonisé d’après un nouveau procédé musical déposé, sous cachet, dans les archives de l’Institut, le 24 janvier 1840, par J. Martin d’Angers, maître de chapelle et organiste accompagnateur de la paroisse royale de Saint-Germain l’Auxerrois et du collège royal de Saint-Louis, Première livraison specimen de l’office du matin qui est sous presse [sic]. [45] À l’emplacement de la salle des Menus-Plaisirs et à l’instigation de Napoléon Ier, la salle du Conservatoire, rue Faubourg Poissonnière, s’édifie sur les plans de l’architecte Delannoy à 1806 à 1811. D’autres locaux y étant joints, l’ensemble héberge le Conservatoire de Paris jusqu’à ce que ce dernier déménage rue de Madrid. [46] Lire à ce sujet Sophie-Anne Leterrier, « Musique populaire et musique savante au XIXe siècle. Du ‟peuple” au ‟public” », Revue d’histoire du XIXe siècle, n° 19, 1999, p. 89-103. [47] Il s’agit d’une méthode d'enseignement du déchiffrage à vue conçue par Pierre Galin (1786-1821), Aimé Paris (1798-1866) et Émile Chevé (1804-1864), utilisant une notation chiffrée, d’où son nom de Méthode Galin-Paris-Chevé. [48] L’Internationale , paroles d’Eugène Pottier (1871) mis en musique par l’ouvrier lillois Pierre Degeyter en 1888.
[49] Julien Martin d’Angers, L. Napoléon Président ! chant patriotique, Paris, Vve Canaux, 1848. [50] La dédicace « au Lieutenant-général comte de Rumigny, aide de camps du roi » Louis-Philippe, en date du 10 décembre 1847, permet d’affirmer la période de publication. [51] Georges Kastner, Manuel général de Musique militaire à l’usage des armées françaises..., Paris, Firmin-Didot frères, 1848, 413 p. et 55 pl. de musique gravée. [52] Cité par Edmond Neukomm, Histoire de la musique militaire, op. cit., p. 44. [53] Lire à ce sujet Patrick Péronnet, « Saxons et Carafons, Adolphe Sax et le Gymnase musical militaire, un conflit d’esthétique », dans Actes du colloque Adolphe Sax his influence and legacy : a bicentenary conference, Bruxelles, juillet 2014, à paraître dans la Revue belge de musicologie.
[54] L’entreprise Raoux, née au xviie siècle, s’est faite une spécialité des cuivres et particulièrement des cors. Marcel Auguste Raoux, héritier de la dynastie, ruiné par les procès contre Sax et la mévente de ses produits, fait faillite en 1857. [55] Jacques Christophe Labbaye (1814-1878) succède à son père en 1848. Spécialiste des instruments de cuivre (ophicléides, cors, trompettes, etc.), la réforme des musiques militaires, à l’avantage de Sax, ruine son entreprise. [56] Jean Louis Antoine Halary (1788-1861), héritier d’une entreprise familiale, perfectionne les systèmes de valves et pistons sur les instruments de cuivre. Il a collaboré avec Meifred pour perfectionner le cor à piston. [57] L’entreprise de Gustave Auguste Besson (1820-1874) naît en 1838 et se spécialise dans la fabrication de cornets à pistons. Devant les difficultés rencontrées en France par la menace de contrefaçon des produits d’Adolphe Sax, il préfère s’exiler à Londres dès 1858, laissant cependant sa femme, Florentine, poursuivre une fabrication et un écoulement de ses produits en France. [58] Constant Pierre, Les facteurs d’instruments de musique, les luthiers et la facture instrumentale, précis historique, Paris, Sagot, 1893, p. 358-359. [59] Dans La France musicale, 12 mars 1848, n° 11 [11e année], p. 79. Le même article publié dans Le Ménestrel, 12 mars 1848, n° 334 [15e année, n° 15], p. 3, tronque curieusement la dernière phrase se contentant d’affirmer la réouverture des ateliers. [60] Marie Bobillier (1858-1918) est une musicologue, critique musicale française, écrivant sous le pseudonyme de Michel Brenet. Elle est l’auteur de La musique militaire : étude critique, illustrée de douze planches hors texte, Paris, H. Laurens, coll. « Musiciens célèbres », s.d. (ca 1917), 126 p.
[61] Michel Brenet, op.cit., p. 100-101. [62] Lire à ce sujet Oscar Comettant, Histoire d’un inventeur au XIXe siècle, Adolphe Sax, ses ouvrages, ses luttes, Paris, Pagnerre, 1860, 552 p. L’ouvrage devient parfois hagiographique. [63] Lire à ce sujet Patrick Péronnet, « Saxons et Carafons, Adolphe Sax et le Gymnase Musical Militaire : un conflit d’esthétique », dans les actes du colloque Adolphe Sax, his influence and legacy : a bicentenary conference, 3-5 juillet 2014 à Bruxelles, Musée des instruments de musique, Bruxelles (à paraître dans la Revue Belge de Musicologie). [64] Julien Martin, « Les réformes », La France musicale, 2 avril 1848 [11e année, n° 14], p. 98.
[65] Littérateur né à Varsovie, Karol Forster (1800-1879) est l’ancien secrétaire du prince Zajonczek, vice-roi de Pologne. Il émigre en France en 1830, puis s'établit à Berlin après 1848. Il francise son nom dans les années 1830-1848 en Charles ou Charles de Forster. [66] Charles de Foster, Quinze ans à Paris, 1832-1848 : Paris et les Parisiens, Paris : Firmin-Didot frères, 1848-1849, p. 295. [67] Michele Enrico Carafa de Colobrano (Naples 1787 – Paris 1872) militaire, compositeur italien naturalisé français, second fils de Giovanni Carafa, prince de Colobrano et duc d’Alvito, reçut une solide éducation musicale qu’il renforce en prenant des leçons de composition à Paris auprès de Cherubini en 1806. Mis en demeure par son père d’abandonner la musique pour la carrière des armes il devient lieutenant des hussards dans l’armée française, participe à l’expédition de Sicile puis à la campagne de Russie. Décoré par Napoléon de la Légion d’honneur il est fait baron du Royaume d’Italie. La restauration des Bourbons de Naples entraîne la confiscation des biens des Carafa et met fin à la carrière militaire de Michele Enrico. Il reprend sa carrière de compositeur. Sa musique est caractérisée par une certaine fluidité dans les mélodies et une orchestration peu brillante, à une époque dominée par Rossini, Bellini, Auber, Halévy, dont il était par ailleurs l’ami. Consacré comme compositeur d’opéra il s’installe définitivement à Paris en 1827, obtient la citoyenneté française en 1834. En 1837 il succède à Lesueur à l’Académie des Beaux-arts et est nommé directeur du Gymnase de musique militaire en 1838. De 1840 à 1858 il enseigne le contrepoint et la composition au Conservatoire de Paris. Atteint de paralysie en 1867, il fait don de ses manuscrits à la Bibliothèque du Conservatoire de Naples en 1868. Il décède le 26 juillet 1872. Il a écrit Trois Livres d’Harmonie militaire à l’usage du Gymnase. [68] La France musicale , 26 mars 1848 [11e année, n° 13], p. 93. [69] Ibid., p. 94. [70] « De l’organisation des musiques militaires », article signé E. D. dans Revue et Gazette musicale de Paris, 3 septembre 1848, n° 36 [15e année], p. 4-6. [71] Revue et Gazette musicale de Paris, 10 septembre 1848, n° 37 [15e année], p. 4-5. [72] Revue et Gazette musicale de Paris, 2 avril 1848, n° 14 [15e année], p. 4. [73] Guillaume-Louis Bocquillon, dit Wilhem ou Bocquillon-Wilhem (1781-1842), compositeur, pédagogue et philanthrope français, initiateur du mouvement festif et musical de masses des orphéons et inventeur de la méthode d'enseignement musical qui porte son nom. [74] « Lettre aux orphéonistes », La France musicale, 2 avril 1848, n° 14 [11e année], p. 102. [75] La France musicale, 9 avril 1848, n° 15 [11e année], p. 110. [76] « Lettre aux orphéonistes », La France musicale, 2 avril 1848, n° 14 [11e année], p. 102. [77] La Marseillaise, 11e couplet. [78] Lire à ce sujet Patrick Péronnet, Berlioz et les musiques militaires, influence et métissage, Paris, Observatoire Musical Français / Université de Paris-Sorbonne, Série « Histoire, Théorie, Analyse », n° 14, 2011, p. 14-16. [79] Berlioz reçut commande de cette pièce en avril 1830. [80] On estime que les trois journées de février ont fait trois-cent-cinquante morts et au moins cinq-cents blessés. [81] Pierre Frantz, op. cit., p. 235. Rappelons que les Trois Glorieuses de 1830 donnèrent lieu à un véritable culte funèbre lors des fêtes de Juillet réitérées annuellement, commémoration qui devait durer une dizaine d’années. [82] La France musicale, 5 mars 1848, n° 9-10 [11e année], p. 67-68. [83] « Lettre aux orphéonistes », La France musicale, 2 avril 1848, n° 14 [11e année], p. 102. [84] Jacques-Guy Petit, « Grégoire Bordillon et la République romantique (1848-1849) », dans Jean-Luc Marais [dir.], Les préfets de Maine-et-Loire, Presses Universitaires de Rennes, coll. « Histoire », 2000, p. 16.
[85] Lire à ce sujet Maurice Agulhon, « Fête spontanée et fêtes organisées à Paris en 1848 », dans Jean Éhrard et Paul Viallaneix [dir.], Les Fêtes de la Révolution, Paris, Société des études robespierristes, 1977, p. 243-271 ou encore Rémi Dalisson, « Fête publique et citoyenneté : 1848, une tentative de régénération civique par la fête », Revue d’histoire du XIXe siècle, n° 18, 1999, p. 49-72. [86] Xavier Marmier, Journal (1848-1890), établissement du texte, présentation et notes de Eldon Kaye, Genève, Librairie Droz, 1968, tome 1, p. 76.
[87] George Sand, Souvenirs de 1848, p. 31, cité par Louise Vincent, George Sand et le Berry, Paris, Édouard Champion, 1919, p. 388. [88] Le Ménestrel, 30 avril 1848, n° 341 [15e année, n° 22], p. 2. [89] Ibid., p. 2.
[90] Le Tintamarre, du 7 au 12 mai 1848, n° 18 [6e année], p.2. [91] Henri Blanchard, Revue et Gazette musicale de Paris, 28 mai 1848, n° 22 [15e année], p. 4. [92] D’après les indications fournies par Planque dans Agenda musical, ou Indicateur des amateurs artistes et commerçants en musique, de Paris, de la province et de l’étranger, Paris, Duverger, 1837 (3e année). [93] En 1849, Stanislas Verroust recevra un hommage de ses musiciens de la 2e Légion de la Garde nationale : « Notre députation de la garde nationale parisienne, de retour de son voyage à Lille, vient d’offrir à Verroust, capitaine de musique de la 2e légion, un superbe hautbois de Tulou, monté en or et d’une valeur de mille francs. C’est un témoignage de reconnaissance, non seulement au talent de cet artiste éminent, mais aussi de son obligeance et de son devoûment [sic] à toute épreuve. » Dans Le Ménestrel, 16 décembre 1849, n° 835 [17e année, n° 3], p. 3.
[94] Dans Le Ménestrel, 4 et 11 juin 1848, nos 346-347 [15e année, nos 27-28], p. 3.
[95] C’est de cette formation de cavalerie qu’est née une Fanfare de huit puis douze trompettes organisée par Jean-Georges Paulus (1816-1898), recruté le 18 août 1848 comme maréchal des logis-trompette. Elle se transforme ultérieurement en Musique de la Ville de Paris, puis, par la suite, en Musique de la Garde républicaine. [96] Lire à ce sujet Patrick Péronnet, « L’origine des musiciens de la Garde nationale de Paris, 1789-1795, ‟Qui sert bien sa patrie n'a pas besoin d'ayeux” », Revue historique des armées, Musique militaire, n° 279, 2 e trimestre 2015, p. 42-51. [97] La Commission qui siège au Palais du Luxembourg au printemps 1848, est chargée de réfléchir et de proposer une nouvelle organisation du travail afin d'améliorer le sort des travailleurs. Sous la présidence de Louis Blanc, elle a mis en œuvre, pendant quelques mois, son plan d'Organisation du travail dont l'exemple le plus marquant a été l'atelier social. Véritable « parlement du travail », cette assemblée, démocratique et représentative dans sa composition a été à l'origine d'un projet de loi sur le travail.
[98] Revue et Gazette musicale de Paris, 23 avril 1848, n° 17 [15e année], p. 6-7. [99] Pierre Joseph Émile Meifred (1791-1867), célèbre corniste, il est le promoteur, en France, du cor à pistons. En 1848 Meifred est membre de la commission nommée, au Conservatoire de Paris, dont l’objet était de présenter un rapport « sur les modifications à introduire dans le régime de cet établissement ». Il y représente les classes d’instruments à vent. Lire à son sujet : Nicolas Gouilloux, « Pierre Joseph Meifred (1791-1867), précurseur du cor chromatique en France », dans Le Quintette de cuivres, aspects historiques et actualité, Lyon, Symétrie, 2006. Actes du colloque organisé à Lyon. [100] Edmond Juvin (1811- ?), compositeur formé à Naples puis à Paris entre autres par Anton Reicha, membre de l’association des Artistes musiciens depuis 1847, il est auteur de musique religieuse et d’œuvres lyrique et s’est beaucoup intéressé à l’écriture pour musique de chambre et particulièrement pour ensemble de cuivre. Il écrit notamment un Septuor (pour deux cornets à pistons, deux cors, deux ophicléides et trombone, 1843 – perdu), un Premier Grand Quatuor (op. 2 pour cornet, néocor, clavicor et ophicléide, 1841 ?) et un Grand Nonetto pour cuivres (avant 1843). Lire à ce sujet la notice de Géry Dumoulin dédiée à ces deux dernières œuvres, disponible sur : www.lacourroie.org/lacourroie/Les_cuivres_Romantiques.html.
[101] Dans Le Ménestrel, 23 avril 1848, n° 340 [15e année, n° 21], p. 1-2. [102] L. Dufrène (ou Dufresne), trompettiste renommé est l’auteur d’une Grande méthode raisonnée de cornet-trompette à pistons (Paris, Gambaro, 1834), et d’une Méthode théorique & pratique du cornet à pistons ou cylindres (Paris, ca 1846). [103] Dans Le Ménestrel, 23 avril 1848, n° 340 [15e année, n° 21], p. 1-2. [104] Dans Le Ménestrel, 21 et 28 mai 1848, nos 344-345 [15e année, nos 25-26], p. 2.
[105] Le Ménestrel, 12 mars 1848, n° 334 [15e année, n° 15], p. 4.
[106] Maurice Dommanget, De la Marseillaise de Rouget de Lisle à l’Internationale de Pottier, op. cit., p. 299-300. [107] Dans Revue et Gazette Musicale de Paris, 28 mai 1848, n° 22 [15e année], p. 6. [108] Louis-Désiré Besozzi (1814-1879), Grand Prix de Rome en 1837, consacre sa vie à l’enseignement musical populaire et au développement des sociétés orphéoniques. En dehors d’œuvres pianistiques, il compose des pièces pour l’orphéon dont un Hymne à l’harmonie (paroles de E. Pottier, Paris, imp. Magnier, 1861), un Chant des travailleurs et des pièces religieuses dont un Veni Crator (1858) et un Pater noster (1861). Il est aussi l’auteur de Solfèges artistiques composés pour les sociétés chorales (Paris, Maeyens-Coureur, 1869) et de Solfèges à quatre voix composés pour des concours de lecture à vue (Paris, Prosper Pegiol, 1872). [109] « Ces réflexions de M. Besozzi sont extraites du feuilleton de M. Allyre Bureau, sur la Nécessité d’organiser le travail des ouvriers musiciens, publié par la Démocratie pacifique », dans Le Ménestrel, 21 mai 1848, n° 344 [15e année, n° 25], p.2. [110] Revue et Gazette musicale de Paris, 2 juillet 1848, n° 26-27, [15e année], p. 2-3. [111] La Marseillaise, 3e couplet. [112] Revue et Gazette musicale de Paris, 9 juillet 1848, n° 29 [15e année], p. 1. [113] Henri Blanchard, « Concert au bénéfice des blessés de juin », Revue et Gazette musicale de Paris, 25 juillet 1848, n° 30, [15e année], p. 5. [114] Le Constitutionnel, 7 juillet 1848. [115] « Programme de la cérémonie funèbre du 6 juillet 1848 », La Liberté, journal de Lyon, vendredi 7 juillet 1848 [1ère année, n° 108], p. 2. [116] En 1816, l'Élysée entre définitivement dans les biens de la Couronne et Louis XVIII l'attribue à son neveu, le duc de Berry, à l'occasion du mariage de ce dernier avec Marie-Caroline de Bourbon-Siciles. En 1820, Louis-Philippe prend possession du Palais qui devient, jusqu'en 1848, la résidence des hôtes étrangers de la France en visite à Paris. Puis, pendant le gouvernement provisoire de la Deuxième République, le Palais prend le nom d'Élysée National, et les jardins sont ouverts au public. Le 12 décembre 1848, l'Assemblée nationale assigne par décret l'Élysée National comme résidence du Président de la République. [117] En l’état de nos recherches, nous ne savons pas précisément ce qu’est cette Société. Son nom pourrait faire penser à la Musique populaire de la République et de la ville de Paris évoquée précédemment et que les événements de juin ont certainement fait disparaître. Au su du programme cité, il s’agit plus vraisemblablement d’un orphéon vocal parisien éphémère. Si cette société était la version nouvelle de la Musique populaire, ce serait sa dernière apparition en public, aucune allusion à celle-ci n’étant relevable dans les mois suivants. [118] Le titre de l’œuvre paraît fantaisiste au su du catalogue de Rossini. Il pourrait s’agir d’une adaptation française de Coro della Guarda Civica di Bologna (« Segna Iddio ne’suoi confini ») écrit originellement sur un texte de Fillipo Martinelli et exécuté à Bologne, Piazza Maggiore dans la soirée du 21 juin 1848. (voir : Frédéric Vitoux, Gioacchino Rossini, Paris, Editions Mazarine, 1982, p. 254). [119] Dans Revue et Gazette Musicale de Paris, 1848, p. 315. [120] La Garde nationale mobile se recrute dans une population jeune (à partir de 16 ans), relativement pauvre, et de préférence parmi les provinciaux, pour éviter toute fraternisation avec les ouvriers parisiens. [121] Le Moniteur de Vienne, 26 octobre 1848, p. 3. [122] Maurice Bourges, Revue et Gazette musicale de Paris, 22 octobre 1848, n° 43, [15e année], p. 3-4. [123] Sous l’intitulé « De l’organisation des musiques militaires » une série de trois articles sont publiés les 3, 10 septembre et 1er octobre 1848. [124] Revue et Gazette musicale de Paris, 10 septembre 1848, n° 37, [15e année], p. 4-5. [125] Revue et Gazette musicale de Paris, 1er octobre 1848, n° 40, [15e année], p. 5. [126] Henri Maréchal et Gabriel Parès, Monographie universelle de l’Orphéon, Paris, Delagrave, s. d. [ca 1910], p. 56. [127] Ibid. [128] Sylvie Aprile, 1815-1870, La Révolution inachevée, Paris, Belin, 2010, p. 296. [129] Henri Maréchal et Gabriel Parès, Monographie universelle de l’Orphéon, op. cit., p. 57. [130] Lire à ce sujet Oscar Comettant, Histoire d’un inventeur au XIXe siècle, Adolphe Sax, ses ouvrages, ses luttes, Paris, Pagnerre, 1860, 552 p. L’ouvrage devient parfois hagiographique. [131] Dans Revue et Gazette Musicale de Paris, 29 octobre 1848, n° 44, p. 2. [132] Adolphe Sax est nommé facteur de la Maison Militaire de l’Empereur en 1854. En août, les instruments Sax sont réintégrés dans les musiques militaires. [133] « Le Te Deum qui sera chanté ce matin pendant l’office divin de la fête de la Constitution, est de la composition de M. A. Elwart. Les chœurs du Conservatoire dirigés par le compositeur lui-même, et un orchestre d’harmonie conduit par M. Landelle, interprèteront l’œuvre de notre collaborateur. » Dans Le Ménestrel, 5 et 11 novembre 1848, nos 368-369 [15e année, nos 49-50], p. 4. [134] Rémi Dalisson, Les Trois couleurs, Marianne et l’Empereur. Fêtes libérales et politiques symboliques en France. 1815-1870, Paris, La Boutique de l’Histoire, 2004. [135] Dans Le Ménestrel, 24 décembre 1848, n° 375 [16e année, n° 4], p. 3. [136] Seule la création de l’Éden de Félicien David (livret de L. Méry), le 25 août 1848 à l’Opéra de Paris pourrait être retenue comme œuvre de qualité sur cette année.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pour citer cet article : Patrick Peronnet, « Musique officielle et citoyenneté dans la fièvre de 1848 » dans Musique, Pouvoirs, Politiques, Philippe Gonin et Philippe Poirrier [dir.], Territoires contemporains - nouvelle série [en ligne], 05 février 2016, n° 6, disponible sur : http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/prodscientifique/TC.html. Auteur : Patrick Peronnet. Droits : © Tous droits réservés - Ce texte ne doit pas être reproduit (sauf pour usage strictement privé), traduit ou diffusé. Le principe de la courte citation doit être respecté. ISSN : 1961-9944 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
OUTILS |