La lettre du LIR3S
n° 137 - septembre 2025
La lettre du LIR3S
n° 137 - septembre 2025
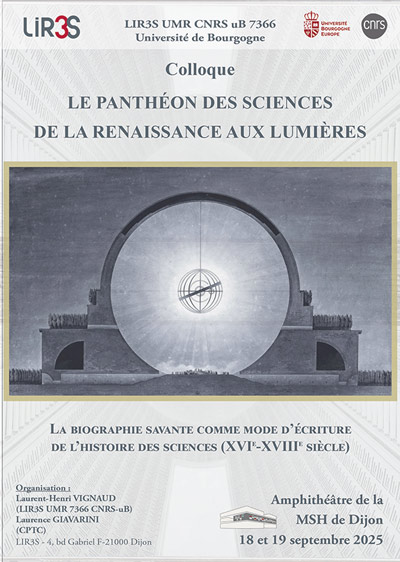 Longtemps prisée et considérée comme une modalité certes minimale mais efficace de pratiquer l’histoire des sciences, la biographie savante a subi au cours du XXe siècle une forte crise de légitimité, la critique moderne tendant à replacer le genre rhétorique de la Vie dans un réseau plus vaste de « formations discursives » ou de relations « objectives », sociales, économiques et familiales…
Longtemps prisée et considérée comme une modalité certes minimale mais efficace de pratiquer l’histoire des sciences, la biographie savante a subi au cours du XXe siècle une forte crise de légitimité, la critique moderne tendant à replacer le genre rhétorique de la Vie dans un réseau plus vaste de « formations discursives » ou de relations « objectives », sociales, économiques et familiales…
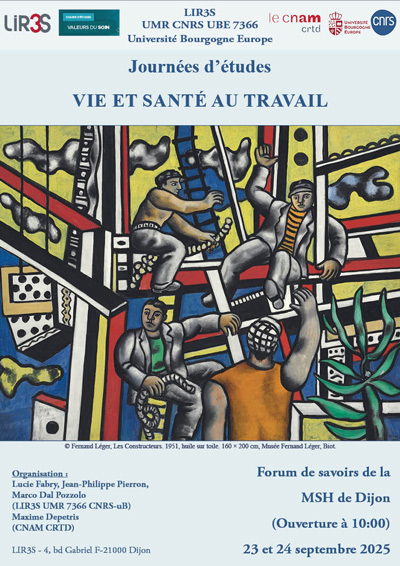 L’articulation entre travail et vie traverse plusieurs courants de pensée et constitue un problème central pour la philosophie du travail contemporaine. Que ce soit pour contester la réduction du travail à la vie biologique, ou pour faire de l’ancrage vital un levier de critique politique et d’émancipation, le prisme de la vie semble incontournable pour penser l’activité de travail. Tout en mobilisant des ressources et des références propres, les « ergo-disciplines », selon le mot de François Daniellou, se sont retrouvées autour du constat de l’écart entre travail prescrit et travail réel, d’une définition de la santé comme processus dynamique, et du projet de contribuer à l’amélioration de la vie au travail…
L’articulation entre travail et vie traverse plusieurs courants de pensée et constitue un problème central pour la philosophie du travail contemporaine. Que ce soit pour contester la réduction du travail à la vie biologique, ou pour faire de l’ancrage vital un levier de critique politique et d’émancipation, le prisme de la vie semble incontournable pour penser l’activité de travail. Tout en mobilisant des ressources et des références propres, les « ergo-disciplines », selon le mot de François Daniellou, se sont retrouvées autour du constat de l’écart entre travail prescrit et travail réel, d’une définition de la santé comme processus dynamique, et du projet de contribuer à l’amélioration de la vie au travail…
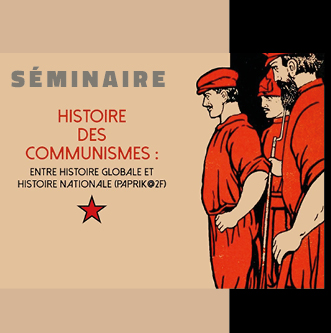 Dans l’histoire de la France contemporaine, 1936 occupe une place singulière ; cette année s’inscrit dans la lignée des grands moments de mobilisations populaires qui ont changé la vie. Elle constitue un événement sans pareil, tout à la fois politique, social et culturel, au cœur duquel la société française, tant en métropole que dans les colonies, mais aussi dans les mondes des villes et des campagnes, est habitée par des sentiments variés : espoir ou désenchantement, peur ou joie, adhésion ou rejet qui laissent alors des traces profondes au sein de la culture nationale, des mémoires…
Dans l’histoire de la France contemporaine, 1936 occupe une place singulière ; cette année s’inscrit dans la lignée des grands moments de mobilisations populaires qui ont changé la vie. Elle constitue un événement sans pareil, tout à la fois politique, social et culturel, au cœur duquel la société française, tant en métropole que dans les colonies, mais aussi dans les mondes des villes et des campagnes, est habitée par des sentiments variés : espoir ou désenchantement, peur ou joie, adhésion ou rejet qui laissent alors des traces profondes au sein de la culture nationale, des mémoires…
 |
Contrairement à l’histoire du communisme, l’anticommunisme est un parent pauvre de l’historiographie. Enrichi de nouvelles approches et de nouveaux fonds d’archives, ce livre a pour ambition de caractériser cet objet polymorphe et polysémique qui n’a cessé d’évoluer au fil des mutations politiques, géopolitiques, sociales et culturelles de l’Europe du XXe siècle. Centré sur l’histoire du communisme soviétique de 1917 à 1991, il s’articule autour de plusieurs séquences clés : l’entre-deux-guerres, la guerre froide, mais aussi les premiers temps de la chute du communisme. Attentif à l’histoire des idées et des représentations, il s’intéresse également aux pratiques de groupements et aux appareils étatiques. … Olivier Dard, Noëlline Castagnez, Maxime Launay, Jean Vigreux [dir.], L’anticommunisme en France et en Europe. 1917-1991, Rennes, PUR, 2025. |
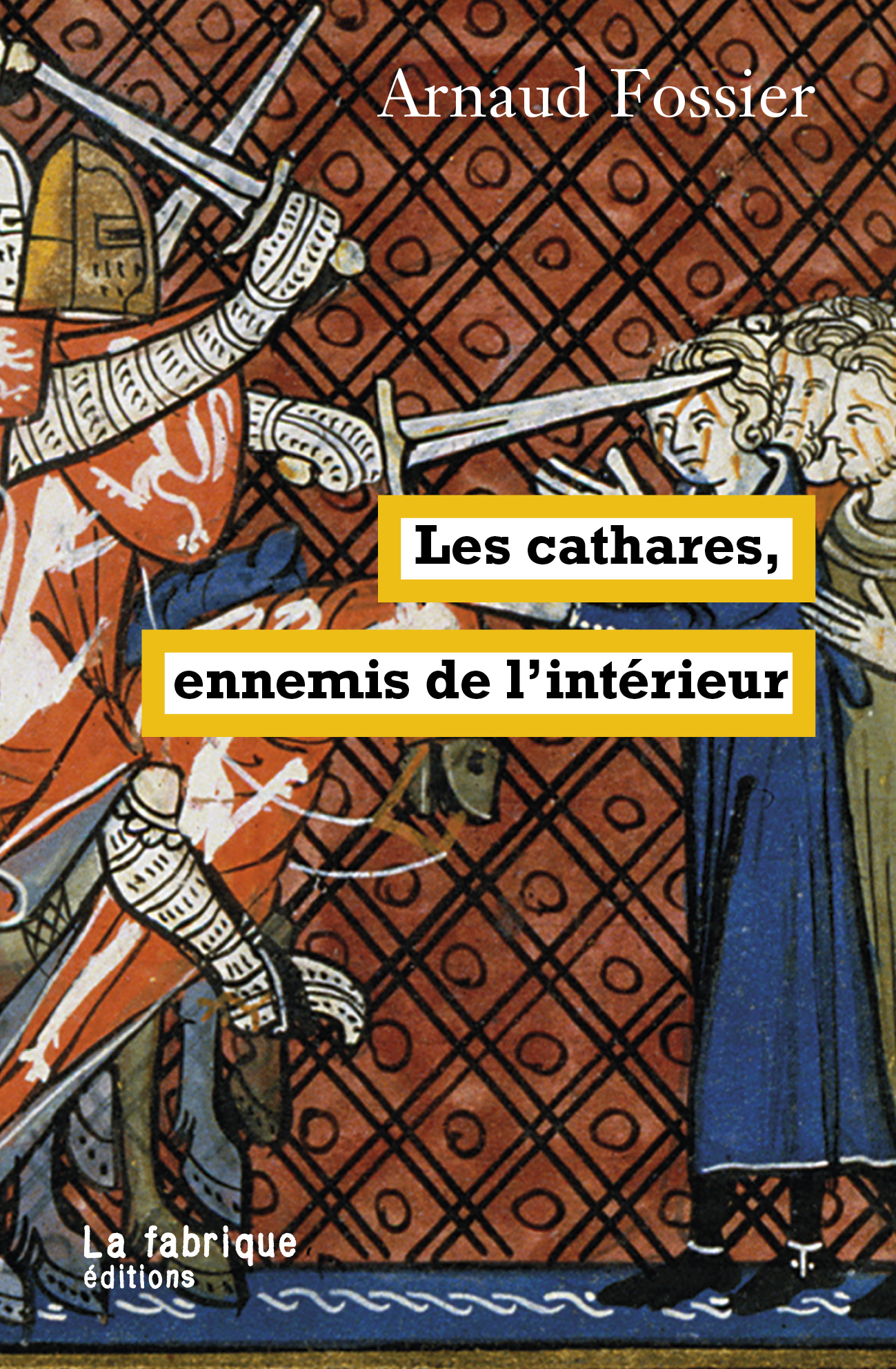 |
Des hérétiques les plus célèbres du Moyen Âge, il ne reste rien, sauf les châteaux qu’on leur attribue à tort. Nous ne les connaissons qu’au travers de ce qu’en ont dit leurs détracteurs et leurs persécuteurs. Si ces écrits ne nous donnent aucun accès direct à la parole des cathares, ils révèlent en revanche une construction savante de l’ennemi, mise au service de la propagande pontificale et d’une croisade intérieure perpétuellement renouvelée. Car les cathares ont bel et bien été combattus avec âpreté par l’Église, parfois en collaboration avec les appareils d’État monarchiques, qui en firent un banc d’essai de leur souveraineté… Arnaud Fossier, Les Cathares, ennemis de l’intérieur, Paris, La Fabrique éditions, 2025. |
 |
Saisir à partir de quelques terrains et expérimentations (essentiellement en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis) la dimension politique de l’alimentation afin d’explorer les mutations, les préoccupations et les controverses qui sous-tendent la modernité désenchantée du XIXe siècle. Derrière l’alimentation se tissent en effet de multiples fils qui relient les humains et les non-humains : les denrées sont des matières qui circulent dans les corps et façonnent les environnements, tout comme les imaginaires culturels et les rapports de force socio-politiques… François Jarrige et Ophélie Simeon [coord.], « Introduction. Alimentation, pouvoirs et politiques au XIXe siècle », Revue d'histoire du XIXe siècle [En ligne], 70 | 2025. |
 Ce colloque propose de dresser un panorama des nouvelles perspectives sur les interactions entre photographie et sciences aux XIXe et XXe siècles, en explorant les enjeux culturels, sociaux, économiques et institutionnels qui les traversent. La photographie y est envisagée à la fois comme outil de connaissance, vecteur de diffusion et objet patrimonial. Il s’agira d’interroger ses usages dans la fabrique des savoirs. Quatre axes sont proposés : les apports épistémologiques de la photographie dans les sciences ; les dispositifs techniques et les pratiques matérielles ; les acteurs et dynamiques sociales impliqués dans la production et l’usage des images ; enfin, la place de la photographie dans la culture scientifique et sa réception par le grand public…
Ce colloque propose de dresser un panorama des nouvelles perspectives sur les interactions entre photographie et sciences aux XIXe et XXe siècles, en explorant les enjeux culturels, sociaux, économiques et institutionnels qui les traversent. La photographie y est envisagée à la fois comme outil de connaissance, vecteur de diffusion et objet patrimonial. Il s’agira d’interroger ses usages dans la fabrique des savoirs. Quatre axes sont proposés : les apports épistémologiques de la photographie dans les sciences ; les dispositifs techniques et les pratiques matérielles ; les acteurs et dynamiques sociales impliqués dans la production et l’usage des images ; enfin, la place de la photographie dans la culture scientifique et sa réception par le grand public…
En savoir plus
 Cette rencontre est destinée aux jeunes chercheur.e.s travaillant une question de recherche relative à la mort, à la fin de vie et aux soins palliatifs, toutes disciplines confondues. Elle aura lieu le 15 décembre dans le cadre des journées scientifiques de la Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie. Elle sera l'occasion de partages d'expériences et d'échanges interdisciplinaires. Elle permettra à chacun d’échanger sur ses travaux de recherche et de susciter de nouveaux questionnements pertinents…
Cette rencontre est destinée aux jeunes chercheur.e.s travaillant une question de recherche relative à la mort, à la fin de vie et aux soins palliatifs, toutes disciplines confondues. Elle aura lieu le 15 décembre dans le cadre des journées scientifiques de la Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie. Elle sera l'occasion de partages d'expériences et d'échanges interdisciplinaires. Elle permettra à chacun d’échanger sur ses travaux de recherche et de susciter de nouveaux questionnements pertinents…
En savoir plus
 L’objectif central de ce colloque, international et interdisciplinaire, est d’identifier et de comprendre le rôle des images de haine et de dénigrement (caricatures, affiches, images numériques fixes ou animées, effigies, mannequins, etc.) à l’égard des hommes et des femmes politiques – c’est-à-dire des représentations iconographiques qui les disqualifient et les agressent non seulement pour leur politique mais aussi parce qu’ils / elles font de la politique – dans le rejet grandissant de la démocratie représentative et l’essor de nouvelles formes de politisation ou de radicalisation.…
L’objectif central de ce colloque, international et interdisciplinaire, est d’identifier et de comprendre le rôle des images de haine et de dénigrement (caricatures, affiches, images numériques fixes ou animées, effigies, mannequins, etc.) à l’égard des hommes et des femmes politiques – c’est-à-dire des représentations iconographiques qui les disqualifient et les agressent non seulement pour leur politique mais aussi parce qu’ils / elles font de la politique – dans le rejet grandissant de la démocratie représentative et l’essor de nouvelles formes de politisation ou de radicalisation.…
En savoir plus
 En hommage à Albert Viala, ancien bâtonnier du barreau de Toulouse, ancien président honoraire de la conférence des bâtonniers de France, Secrétaire perpétuel de l’Académie de législation de Toulouse pendant près de 20 ans, retenu prisonnier en Autriche durant 5 ans entre 1939 et 1945 et auteur d’une thèse portant sur les rapports entre le Parti et l’État dans l’Allemagne nazie, décédé en 2003, la fondation Albert Viala - Institut de France a créé le Prix Albert Viala. D’un montant annuel de 8 000 €, il est destiné à récompenser une œuvre écrite de langue française, publiée ou inédite, de nature littéraire ou juridique, ayant pour objet la défense des libertés fondamentales. Ce prix d’encouragement s’adresse à de jeunes auteurs ou chercheurs, sans restriction de nationalité, titulaires d’un doctorat toutes facultés confondues…
En hommage à Albert Viala, ancien bâtonnier du barreau de Toulouse, ancien président honoraire de la conférence des bâtonniers de France, Secrétaire perpétuel de l’Académie de législation de Toulouse pendant près de 20 ans, retenu prisonnier en Autriche durant 5 ans entre 1939 et 1945 et auteur d’une thèse portant sur les rapports entre le Parti et l’État dans l’Allemagne nazie, décédé en 2003, la fondation Albert Viala - Institut de France a créé le Prix Albert Viala. D’un montant annuel de 8 000 €, il est destiné à récompenser une œuvre écrite de langue française, publiée ou inédite, de nature littéraire ou juridique, ayant pour objet la défense des libertés fondamentales. Ce prix d’encouragement s’adresse à de jeunes auteurs ou chercheurs, sans restriction de nationalité, titulaires d’un doctorat toutes facultés confondues…
En savoir plus
L’Institut national d’histoire de l’art (INHA) et l’Académie de France à Rome – Villa Médicis attribuent chaque année deux bourses pour des recherches portant sur l’art de la Renaissance à nos jours. Ces bourses sont destinées à des chercheuses et chercheurs confirmés, français ou étrangers, souhaitant se rendre à Rome pour y effectuer des recherches. Le montant de la bourse s’élève à 3 000 €. Les boursiers sont logés à la Villa Médicis pour une durée de quatre à six semaines, consécutives ou fractionnées…
En savoir plus
Le Département du Jura propose des bourses départementales de recherche à de jeunes chercheurs de toute discipline inscrits en enseignement supérieur (master, doctorat, etc.) qui doivent recourir de façon importante à l'exploitation d'archives conservées au sein des Archives départementales du Jura pour les besoins de leurs travaux. La bourse allouée est d'un montant annuel de 1 000 € (niveau master), ou de 1 500 € (niveau doctorat)…
En savoir plus
 La bourse vient soutenir un projet de thèse concernant l’histoire de l’art du XIXe siècle et du début du XXe siècle. La bourse vise à encourager des travaux sur les collections (peinture, sculpture, arts décoratifs, arts graphiques, photographie, architecture et imprimés) ainsi que sur les sources documentaires (archives, correspondances, manuscrits, en grande partie inédits) conservées par les musées d’Orsay et de l’Orangerie, mais aussi à soutenir plus largement des projets offrant des éclairages nouveaux sur les œuvres, les artistes et le contexte artistique de cette période, comme le marché de l’art, l’histoire des collections et les figures de collectionneurs et collectionneuses, les expositions et la circulation des œuvres, la critique d’art, les réseaux professionnels et sociaux, les politiques culturelles, la planification urbaine, les transferts artistiques et culturels, la pédagogie artistique, les enjeux de la technique et de la matérialité etc. La gratification annuelle est de 10 000 €, sur trois ans non renouvelables…
La bourse vient soutenir un projet de thèse concernant l’histoire de l’art du XIXe siècle et du début du XXe siècle. La bourse vise à encourager des travaux sur les collections (peinture, sculpture, arts décoratifs, arts graphiques, photographie, architecture et imprimés) ainsi que sur les sources documentaires (archives, correspondances, manuscrits, en grande partie inédits) conservées par les musées d’Orsay et de l’Orangerie, mais aussi à soutenir plus largement des projets offrant des éclairages nouveaux sur les œuvres, les artistes et le contexte artistique de cette période, comme le marché de l’art, l’histoire des collections et les figures de collectionneurs et collectionneuses, les expositions et la circulation des œuvres, la critique d’art, les réseaux professionnels et sociaux, les politiques culturelles, la planification urbaine, les transferts artistiques et culturels, la pédagogie artistique, les enjeux de la technique et de la matérialité etc. La gratification annuelle est de 10 000 €, sur trois ans non renouvelables…
En savoir plus
 La société des amis du musée de l'Ordre de la Libération décerne pour la première fois le Prix Henri Ecochard - résistant (1923-2020) engagé parmi les premiers dans la France libre à Londres en juillet 1940. Le Prix (dotation fixée à 1 000 €) couronne un mémoire de master 2 relatif à la Résistance française (Résistance intérieure et France libre) et à la déportation de répression (1940-1945)…
La société des amis du musée de l'Ordre de la Libération décerne pour la première fois le Prix Henri Ecochard - résistant (1923-2020) engagé parmi les premiers dans la France libre à Londres en juillet 1940. Le Prix (dotation fixée à 1 000 €) couronne un mémoire de master 2 relatif à la Résistance française (Résistance intérieure et France libre) et à la déportation de répression (1940-1945)…
En savoir plus
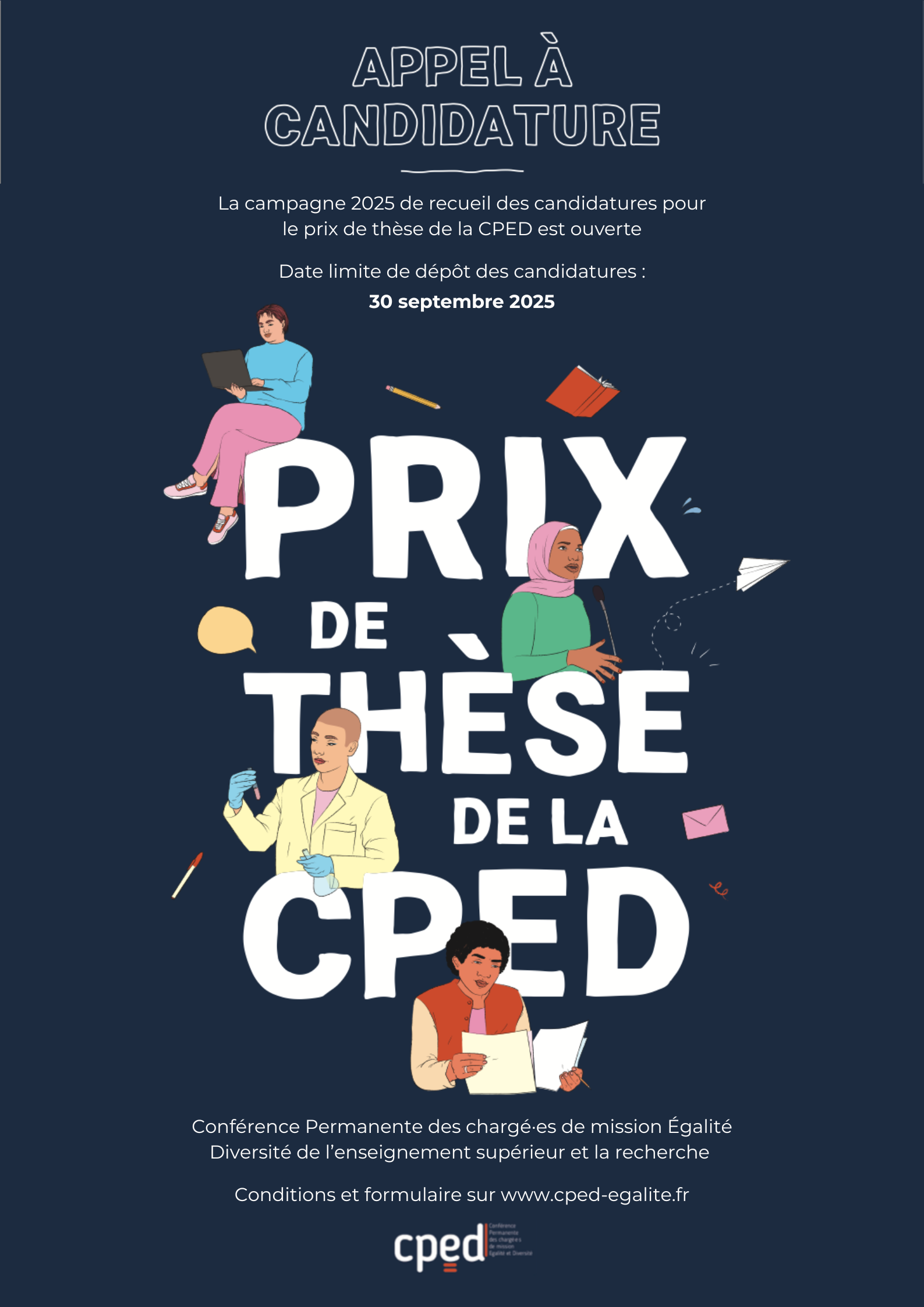 afin de soutenir la recherche sur le genre, l’égalité et la diversité, ce prix d’un montant de 1 500 € récompense des travaux portant sur l’égalité femmes-hommes et la lutte contre les discriminations (mixité des filières, violences sexuelles, stéréotypes de genre, lutte contre le racisme et l’antisémitisme, santé des femmes, communication inclusive,…) Toutes les disciplines juridiques ou des sciences humaines, sociales et politiques (économie, géographie, histoire, sociologie, anthropologie…) ou des sciences et technologies sont concernées…
afin de soutenir la recherche sur le genre, l’égalité et la diversité, ce prix d’un montant de 1 500 € récompense des travaux portant sur l’égalité femmes-hommes et la lutte contre les discriminations (mixité des filières, violences sexuelles, stéréotypes de genre, lutte contre le racisme et l’antisémitisme, santé des femmes, communication inclusive,…) Toutes les disciplines juridiques ou des sciences humaines, sociales et politiques (économie, géographie, histoire, sociologie, anthropologie…) ou des sciences et technologies sont concernées…
En savoir plus
En ce début d'année universitaire, Cécile Pichon-Bonnin rejoint l'UMR THALIM et Thierry Hohl a fait valoir ses droits à la retraite.
Le LIR3S accueille de nouveaux membres : Claire Maingon, professeure en histoire de l’art contemporain et Guillaume Roubaud-Quashie, maître de conférences en histoire contemporaine ; deux nouvelles collaboratrices technique : Florence Chagneux, secrétaire-gestionnaire du laboratoire – qui succède à Camille Soupin – et Clémentine Labrut, chargée de l'édition numérique et du soutien technique à la recherche.
La lettre du LIR3S - UMR 7366 CNRS-UBE
Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche "Sociétés, Sensibilités, Soin"
n° 137 - septembre 2025
Consultez les numéros précédents en cliquant ici
- Je m'abonne à La lettre du LIR3S, ici ;
- Je me désabonne à La lettre du LIR3S, ici ;
- nous faire part de vos remarques, ici.
© LIR3S
Directeurs de la publication : Pierre Ancet et Jérôme Loiseau
Secrétaire de rédaction : Lilian Vincendeau