"Sociétés, Sensibilités, Soin"
UMR 7366 CNRS-UBE
| Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche
"Sociétés, Sensibilités, Soin" UMR 7366 CNRS-UBE |
|
| Territoires contemporains | |
| Varia | ||||
| Basile Zimmermann, Waves and Forms. Electronic Devices and Computer Encoding in China, Cambridge, The MIT Press, 2015, 296 p. [1] | ||||
| François Ribac | Mots-clés | Sommaire | Texte | Auteur | Annexes | Notes | Références | Outils | |||
MOTS-CLÉS
|
||||
|
SOMMAIRE |
||||
| TEXTE | ||||
|
I. Introduction : le son des chinese studies Amorcé par l’ouvrage pionnier de Murray Schafer à la fin des années 1970 puis relancé au début des années 2000 par notamment les travaux de Pinch et Trocco sur le synthétiseur Moog, les recherches de Bull et Back sur l’écoute, la généalogie de la reproduction sonore de Sterne [2] et le réseau Art of Record Production, le domaine des Sound Studies n’a cessé de croître depuis, tant en matière de problématiques que d’initiatives (revues, colloques, ouvrages). Connectant plusieurs champs de recherche et disciplines, les sound studies s’intéressent tant aux modes d’écoute et de consommation de la musique, à la production en (home) studio, à l’histoire des dispositifs et objets sonores (du stéthoscope à l’Ipod) qu’à l’écologie sonore des villes. C’est dans ce contexte qu’a été publié en 2015, dans la collection Inside Technology des éditions de la MIT, le remarquable et original livre Waves and Forms de Basile Zimmermann, sinologue, directeur de l’Institut Confucius de l’Université de Genève, anthropologue et musicien électroacoustique. Dans Waves and Forms, Zimmermann se propose de (re)définir la notion de culture en discutant les façons dont respectivement la sinologie (surtout dédiée à l’étude de textes issus de la Chine ancienne) et les sciences et technologie studies (STS) l’abordent. Avec le double objectif de suggérer à la sinologie de se tourner vers les objets et l’ethnographie et de proposer aux STS de mieux prendre en compte la dimension culturelle. Pour cela, Zimmermann discute les méthodes et les théories mobilisées par ces deux mondes, mobilise un impressionnant corpus de textes et d’auteurs, notamment du côté de l’anthropologie sociale, et s’appuie sur une enquête de terrain sur la naissance de la musique techno dans la Chine des années 2000. L’importation par des amateurs chinois de musiques enregistrées, d’objets, d’instruments de musique, de textes et d’interfaces élaborés ailleurs permet alors de voir (et d’écouter) ce que les objets imposent et ce que ces usagers en tirent d’imprévu. L’ouvrage est divisé en quatre parties où les discussions avec des auteurs et la présentation des différents terrains sont sans cesse croisées. II. Perspectives méthodologiques et théoriques 1) Postulats et théories Le premier chapitre (p. 9-56) est principalement dédié à la présentation des cadres théoriques et méthodologiques mobilisés par Basile Zimmermann. En tout premier lieu, celui-ci revendique son affiliation au courant des STS. Il justifie cette affinité, ainsi qu’avec des socio-anthropologues comme Alfred Gell [3], par le fait que ces approches prêtent attention à ce que des humains font avec des objets et considèrent une culture donnée comme le résultat d’échanges et non comme un étant statique. Si les références à la sociologie de la traduction (Actor Network Theory dans le monde anglophone) [4] sont fréquentes, l’auteur se réfère aussi à d’autres corpus des STS comme par exemple le programme fort de David Bloor [5] qui a posé les bases d’une étude des sciences qui appréhende celles-ci comme des faits sociaux plutôt que comme des séries d’énoncés démontrés. Est également citée la sociologie de l’expertise de Collins et Evans qui s’intéresse de près à la dimension tacite, non verbalisée, informelle, des savoirs [6]. Zimmermann précise par ailleurs qu’il aborde les arts comme des pratiques collectives, se référant notamment aux Mondes de l’Art de Howard Becker [7]. Il aborde donc la (production de) musique comme une affaire d’objets et de dispositifs et s’intéresse tout particulièrement à leurs circulations. Cette attention aux mouvements concerne non seulement la carrière « chinoise » d’objets et de supports enregistrés (disques, consoles, logiciels, ordinateurs, encodages, interfaces) mais aussi les processus par lesquels ceux-ci ont été importés et utilisés en Chine. En mobilisant ainsi les études de sciences pour analyser la naissance de la musique techno en Chine, Zimmermann aborde « la Chine » comme une série de transactions instables sans cesse renégociées, objets de controverses et de pratiques divergentes. En somme, il s’agit moins pour lui d’étudier la « culture chinoise » que des pratiques, des humains, des répertoires et des objets situés en Chine, ce qui signifie quitter la sinologie pour construire des chinese studies, un champ pluridisciplinaire qui mobiliserait largement les sciences sociales. 2) Objets d’attention Une fois ces options posées, l’auteur rappelle qu’un dispositif contraint ses usagers, une constante de l’ouvrage. Ainsi, pour montrer comment la structure matérielle d’un objet impose son format à ses utilisateurs, Zimmermann reproduit une planche de bande dessinée où un grand dadais est contraint (c’est le cas de le dire !) de se plier en quatre pour pouvoir rentrer dans une boîte [8]. La même démonstration est illustrée par un exemple avec des téléphones. Lors d’échanges de SMS avec l’un de ses amis chinois, l’auteur a du mal à comprendre certaines formes de ponctuations et le sens de certaines phrases. Après une rapide enquête, il s’avère que le malentendu tient au fait que l’interface du téléphone de l’ami ne permet pas d’utiliser des caractères chinois (mandarin). Là encore, le dispositif matériel s’impose, en partie, aux personnes qui souhaitent communiquer. À partir de là, la question qui se pose concerne la capacité – la liberté – d’expression dont disposent les usagers d’un dispositif technique et/ou d’un langage. Si la structure matérielle des objets et des langages cadre si fortement nos échanges et nos productions, comment pouvons-nous nous comprendre, communiquer, traduire, nous réinventer, innover ? Comment peut-on inscrire de nouvelles informations dans des dispositifs existants, développer de nouvelles pratiques ? Pour répondre à cette question lancinante, Zimmermann emprunte une fois encore des chemins tracés par les STS. S’appuyant notamment sur les travaux issus du courant intitulé SCOT (Social Construction of Technology), Zimmermann fait sienne l’idée qu’un artefact technique permet à des humains de collaborer et à des mondes sociaux d’émerger [9]. Dans cette acception, la diffusion et la longévité d’une technologie tiennent au fait que des personnes et/ou des groupes d’usagers sont capables d’y trouver du sens et des usages communs. Si l’on en revient à l’exemple du téléphone, les usagers peuvent ainsi mettre à jour des fonctionnalités que les concepteurs n’avaient pas soupçonnées, par exemple utiliser leurs pouces pour écrire à toute vitesse des textos [10]. Conséquemment, il est important de comprendre comment des usagers inventent de nouvelles fonctionnalités et quels canaux ils/elles ont emprunté. Dans ce même ordre d’idées, Zimmermann passe en revue différentes théories de la culture et la façon dont celles-ci articulent (voire opposent) la contrainte et la liberté, le collectif et les individus, la nature et la culture, en s’intéressant tout particulièrement à des approches socio-anthropologiques. Ce jeu de balance entre une conception de la culture ouverte et une autre qui s’attache à ce qui contraint (matériellement) est au cœur de l’ouvrage tant pour ce qui concerne la façon dont le terrain est restitué que pour l’élaboration d’un modèle théorique. Enfin, il faut mentionner que cet (impressionnant) état de l’art est tout sauf une sorte d’exercice mécanique de citation d’auteurs. L’auteur se coltine vraiment aux thèses en présence, présente sa propre compréhension et décline ses conclusions. En d’autres mots, l’introduction théorique de l’ouvrage est déjà... une enquête ! III. Naissance et essor de la techno en Chine 1) Techniques de terrain Dans la deuxième partie du livre (p. 57-172), Basile Zimmermann déploie le terrain qu’il a exploré pendant plusieurs années en Chine, et notamment à Pékin. Au point de vue méthodologique, l’auteur privilégie sans conteste une approche bottom up. Ce parti-pris est décliné par le biais de descriptions minutieuses de situations qui s’étalent sur plusieurs années : composition et production de musique dans des espaces domestiques et des studios d’enregistrement, (groupes de) personnes se produisant lors de concerts dans toutes sortes de lieux, collectes d’infos et de ressources sur Internet par des DJs, etc. Nombre de ces situations décrivent comment les divers protagonistes domptent – le mot n’est pas trop fort – des objets spécifiques, des vinyles pour faire du DJaying, des machines (par exemple une groove box), des logiciels de composition et de manipulation du son, le Web. Et au fur et à mesure que les années passent, les pratiques se stabilisent et l’environnement (studios, réseaux, public, connexions avec des professionnels hors de Chine) se structure. Considérons une des six études de cas présentées dans le livre. 2) Les vinyles de Xiao Deng : ce qui résiste À partir de 2001, Zimmermann a dialogué et collaboré avec un DJ, au sens d’un musicien mixant des vinyles. Son récit rend compte des différentes étapes de l’apprentissage du DJaying. Xiao Deng doit d’abord prendre en main platine-disques et vinyles, savoir les manipuler avec aisance puis apprendre à construire ses sets, choisir le bon disque au bon moment, doser les genres, garder l’attention du dance floor pendant ses performances. Justement, dans une situation où le nombre de disques et de répertoires disponibles en Chine est restreint, les marges du DJ sont étroites. Quelle que soit l’élévation progressive de ses compétences, Xiao Deng a besoin de « bons disques » et d’un nombre suffisant de références pour produire des performances variées. Or, comme les objets qui les jouent, les supports enregistrés transportent des façons de faire, des sonorités, des contenus spécifiques, idée condensée dans une scène mémorable du livre. Alors que Xiao Deng se produit sur la Muraille de Chine en 2005, l’ethnographe ferme les yeux et a soudainement l’impression de se retrouver dans une free partie de techno allemande ! Pourquoi ? Et bien parce que les disques mixés à ce moment précis du set transportent ce monde sonique spécifique. Deux points méritent ici d’être relevés. À la façon dont notre corps doit s’adapter à un espace restreint, le son des vinyles constitue également une contrainte avec laquelle le DJ doit composer. Si les objets et leurs ergonomies spécifiques (un studio, une platine disque, etc.) cadrent notre activité, le son émis par les supports enregistrés est aussi une force matérielle, il transporte des logiques, des grammaires, des époques, des territoires, il compte. Zimmermann n’affirme évidemment pas que tout le monde entend et interprète un disque de la même façon mais que le son d’un disque est un médium au moins aussi important que les appareils avec lesquels on le joue. Constat qui confirme ce que d’autres chercheurs ayant étudié l’apprentissage des musiques populaires avec des disques ont déjà montré [11]. On a ici une des pierres les plus convaincantes et originales de l’édifice Zimmermannien, le fait de prêter attention à la dimension matérielle du son. Deuxième fait à retenir, ce que la musique fait au territoire et à la culture locale. Même sur la Muraille de Chine, lieu emblématique s’il en est, la techno jouée par des DJs chinois transforme la Chine, elle devient un moment de la culture chinoise. Zimmermann étudie la culture produite en Chine et non pas la culture en tant qu’elle serait ontologiquement chinoise. Plus exactement, il étudie le résultat du mix où s’émulsionnent la Muraille de Chine, les DJ chinois, les disques berlinois, les platine-disques fabriquées au Japon, le public. Donc, comme on l’a dit plus haut, il plaide pour que la sinologie se transforme en études chinoises. Intéressons nous à présent à la façon dont l’auteur rend compte de sa propre position. 3) La situation de l’ethnographe Dans son livre, Basile Zimmermann mentionne à de très nombreuses reprises qu’il a noué de forts contacts – amicaux, musicaux – avec les personnes et les collectifs dont il décrit les parcours et les pratiques. Il lui est arrivé de faire de la musique avec eux, d’être consulté pour des choix de matériels, des décisions esthétiques, de participer à des sessions d’enregistrement. De même, il fréquente assidument les clubs où l’on joue et écoute des musiques électroniques et où tous ces protagonistes se retrouvent. En somme, Zimmermann agit comme un socio-anthropologue classique ; il vit avec les gens qu’il étudie, parle leur langue (il est sinologue), il s’immerge pour comprendre « comment ça marche ». Dans ce cadre, l’auteur fait régulièrement part de son incompréhension face aux pratiques de certains musiciens chinois qui lui paraissent abracadabrantes, des choix étranges de matériel, des façons inhabituelles de composer, de se produire en public, des sollicitations à son avis absurdes, etc. Ces étonnements se transforment parfois en agacement, en mécontentement, voire en exaspération. On dira que, là encore, tout cela est très classique. Les anthropologues de la deuxième moitié du xxe siècle nous ont en effet habitué à ces formes de récits où ils font part de leur incompréhension face aux cosmogonies des « sauvages » puis décrivent comment, peu à peu, ils acquièrent une meilleure compréhension des normes, conventions, structures et mythes des populations qu’ils étudient. Cependant, les choses sont ici un peu différentes car Zimmermann n’observe pas une partie spécifique et située de la « culture chinoise », un village, une région, un peuple mais documente la façon dont la techno a été importée en Chine par des amateurs. On dira alors : « Rien de nouveau là non plus, ce n’est pas la première fois qu’un anthropologue décrit comment des éléments de la culture occidentale pénètrent une société traditionnelle et/ou non occidentale. Allez dans un colloque d’ethno-musicologues et vous verrez qu’ils ne parlent que de ça ! ». C’est vrai, mais ce qui est ici particulier est que l’enquêteur regarde et écoute des chinois importer sa propre culture, des pratiques musicales et techniques et même des objets qu’il a lui-même pratiqués. Zimmermann a été formé à la prise de son et à la composition, il a écrit et joué de la musique, programmé des événements musicaux en Suisse, la techno fait partie intégrante de son univers. De ce fait, lorsqu’il indique comment il est décontenancé voire révolté par les pratiques de certains de « ses » enquêtés, ce sont ses propres normes, ses savoirs tacites qui surgissent devant nous. Précisément, l’un des grands intérêts du livre est de nous montrer comment les pionniers chinois mettent en crise les certitudes du professionnel. Peu à peu, « le moderne », « l’occidental » est provincialisé [12] en même temps que les pratiques (jugées) qu’il observe se développent et trouvent leur public. Le(ur) monde techno chinois émerge peu à peu. L’anthropologue n’a pas observé un monde existant mais documenté la naissance une hybridation. 4) Appropriations : ce qui bouge Car l’enquête montre que les membres du panel finissent toujours par se frayer des passages au sein des potentiomètres, des circuits électroniques et des lignes de code venus de l’extérieur de la Chine. Même s’ils ne disposent que de très peu d’instructeurs humains pour leur indiquer comment utiliser les machines, mixer des vinyles et conduire un set de DJaying, même s’il faut décrypter des notices d’appareil et des discussions en ligne en anglais, recourir à des logiciels piratés, les pionniers arrivent à s’approprier ces langages et instruments, à décliner leurs propres façons de faire, à inventer de nouveaux mondes. Pourquoi en est-il ainsi ? Précisément, parce que ces amateurs n’ont pas incorporé « originellement » des conventions, ils peuvent trouver d’autres chemins. Si vous ne connaissez pas les règles du jeu il n’y a pas de raison de les respecter. Logique... Mais en même temps, la professionnalisation et l’arrivée dans le marché mondial, via notamment des tournées en dehors de la Chine et l’insertion de certains DJs chinois sur des labels spécialisés, amène la chinese touch à incorporer les bonnes façons de faire, à se normer, à s’instituer. De la liberté surgit aussi la contrainte et cette dialectique est bien plus complexe et subtile qu’un mouvement de l’underground vers le commerce ou la légitimité culturelle. Les observations de Zimmermann, menées durant plusieurs années, nous montrent de façon remarquable la naissance et la maturation de ce nouveau monde. Cette partie centrale de l’ouvrage est à mon sens la plus passionnante, non seulement parce qu’elle nous fait pénétrer dans les arcanes d’un monde en constitution mais aussi par sa manière de ne pas réifier le récit de l’enquête et de confronter sans cesse le terrain avec les théories et les approches présentées dans la première partie. Conformément au programme qu’il s’est fixé, l’anthropologue documente effectivement la circulation entre des mondes et non pas les mondes eux-mêmes et on comprend alors comment la Chine techno de Zimmermann et sa conception matérielle de la culture peuvent informer les STS et comment l’ethnographie des techniques pourrait (ré)orienter les études chinoises. Cette idée que pour documenter une culture il faut observer par quoi elle se manifeste sera d’ailleurs formalisée à la fin de l’ouvrage [13]. IV. Tests et ajustements Dans une troisième et courte partie, l’auteur met alors en œuvre de façon explicite le programme qu’il a énoncé en ouverture et qu’il a largement exploré dans la partie centrale. Dans un premier chapitre intitulé Beta Testing the Framework: Sinology (p. 175-184), il entend montrer que pour observer la Chine contemporaine il faut prêter attention à des dispositifs techniques et à leurs usages. Pour ce faire, il décrit un réseau social en chinois dont il a observé la vie et les transformations à la fin des années 2000. L’autre démonstration (p. 185-197), Beta Testing the Framework: Science and Technology Studies, est consacrée aux claviers ASCII utilisés en Chine avec une transcription latine de l’alphabet du mandarin le, pinyin (p. 188), et les difficultés de traduction/communication qui en résultent. Zimmermann s’intéresse une fois encore à l’un de ses leitmotiv, l’unmodifiability (p. 185), c’est-à-dire ce qui n’est pas accessible ou très peu modifiable dans un objet et a donc toutes les chances de se maintenir lors des usages. Pour Zimmermann en effet, la rigidité de certains systèmes techniques, l’impossibilité de modifier certains paramètres et/ou l’ergonomie d’un objet, l’intraductibilité de certains signes (par exemple entre des langages utilisant des alphabets et des logiques différentes), signifient qu’une partie de ce qui est émis en sortie (output) conserve ce qui était déjà là. À cet endroit, il s’agit d’attirer l’attention des STS sur le fait que la plupart des objets conservent des traces – souvent difficilement traduisibles – de leur contexte d’origine. On notera au passage que cette attention à l’implicite renvoie à la façon dont Harry Collins (2010) et Collins et Evans (2007) définissent le semantic tacit knowledge, des savoirs qui ne sont pas traduisibles et/ou ne nous sont pas accessibles [14]. V. Une théorie matérielle et comparatiste de la culture Arrivé à ce point de l’ouvrage, Zimmermann systématise ce qu’il a déployé dans les trois précédents chapitres (p. 202-228) et présente ce qui s’apparente à une ontologie de la technologie et de ses usages. 1) Waves Les traces matérielles d’une culture sont présentes dans un objet et celles-ci se maintiennent – à des degrés variables – lors de la circulation de ces objets et de leurs usages (« the cultural contents of a physical object (i.e waves contents) are invariabily present in the output of the circulation process », p. 202). La culture n’est pas ici une chose donnée mais un ensemble dynamique de pratiques sans cesse reconfigurées qui s’expriment via des objets et des dispositifs. Le terme de waves décrit les traces de ces contextes culturels, Zimmermann les appelle « cultural contents », et renvoie explicitement à la figuration la plus courante des ondes sonores (Cf. figure 1). À l’heure où l’on transforme effectivement du son en manipulant la représentation visuelle d’ondes sonores dans un logiciel, Zimmermann nous indique que ces waves ne sont pas directement la matière même des objets mais qu’elles en expriment plutôt les contours. Pour l’auteur, les waves s’apparentent aux propriétés d’un matériau dont parlent les sciences de la nature. Ces propriétés sont tout à la fois constantes, identiques dans tous les objets du même type mais elles peuvent aussi se modifier, par exemple dans le cas d’une exposition à la chaleur. Poussant encore plus loin l’analogie avec les « sciences dures », Zimmermann n’hésite pas à parler de ces waves comme d’une loi. 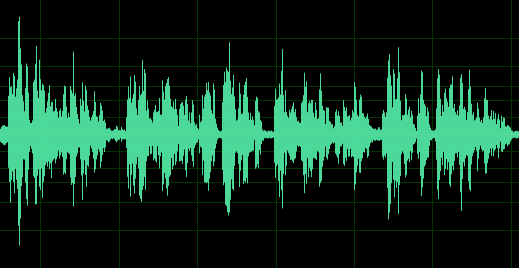
Figure 1 : Représentation du son que l’on manipule dans un logiciel. À noter qu’un des formats du son s’intitule précisément .wav. 2) Forms En prenant l’exemple de la photo d’un arbre envoyée à un ami chinois et dont l’enfant fait un dessin, Zimmermann propose alors son deuxième concept : celui de forms. Celui-ci entend rendre compte des modifications de la figuration de l’arbre. Ce qu’il s’agit ici de désigner c’est le processus par lequel des choses, des objets, des fragments de cultures, des waves, se transforment au gré des circulations et des usages. Cette plasticité est notamment expliquée en s’appuyant sur les travaux de neurosciences (p. 205) qui montrent l’adaptabilité du cerveau ou en comparant les forms au mème de Dawkins [15]. Si l’on reprend la métaphore des formes d’ondes, les forms sont les différentes déclinaisons que prennent des sons mixés par un DJ. Si une partie de leur structure est toujours du même ordre, leur physionomie évolue. Les forms constituent la partie mobile des waves. 3) Waves and Forms En définitive, la modélisation de Zimmermann vise à rendre explicite plusieurs phénomènes cruciaux. En tout premier lieu, il réfléchit à ce qui se conserve et à ce qui se transforme lorsque les productions matérielles d’une culture donnée circulent entre des usagers et des territoires. Il s’agit donc de modéliser ces transformations-permanences, de conceptualiser les mobiles immuables de Latour [16]. Plutôt que d’opposer la contrainte et l’appropriation (reclaim dirait l’anglais) ou d’insister sur l’un des deux termes comme c’est si souvent le cas dans les études sur les technologies, l’approche œcuménique des STS de Zimmermann balance et articule les deux mouvements. En insistant sur les problèmes de traduction et sur les impossibilités matérielles de communiquer, Waves and Forms rappelle que la circulation d’une culture, plus exactement des objets et des usages qui la transportent et en définissent les contours, se heurte souvent à de nombreux problèmes et cause de puissants malentendus. Mais son terrain montre que les obstacles ne sont néanmoins pas insurmontables et comment un certain nombre d’entre eux sont franchis. Ce n’est certainement pas un hasard si une telle perspective est développée par un anthropologue et sinologue qui doit passer son temps à tout traduire et (à se ré-) ajuster. Le fait qu’un musicien de techno mixe tant de théories et de terrains n’est sans doute pas non plus fortuit. Deuxièmement, Waves and Forms s’applique à saisir au plus près la circulation des savoirs. L’exemple des pratiques musicales vient démontrer qu’il s’agit moins de la circulation d’informations et de données (au sens de ce qui serait donné une fois pour toutes) que d’articulations et d’emboîtements entre objets, personnes, savoirs locaux et importés, groupes de pairs et d’amateurs, réseaux matériels et sémantiques, codages et langages, circulations tout autant explicites qu’implicites. Cette attention aux mouvements est d’autant plus bienvenue alors que la numérisation et le Web permettent à d’innombrables choses de circuler et d’être utilisées par d’innombrables internautes. Dans une telle conception il n’existe pas de culture en soi, les relations sociales et la circulation des personnes et des artefacts affectent sans cesse les contours (on n’ose plus écrire les formes !) ce que l’on appelle culture. En somme, les circulations sont aux fondements de ce que percevons comme du « local », de la culture instituée, immuable, territorialisée. Une telle conceptualisation dissone fortement avec les approches qui postulent une identité entre territoire, nation et culture et qui supposent qu’une « culture » (par exemple la Chine) est là de toute éternité. En suivant à la trace les choses, les signes, les usages, Zimmermann propose une conception dynamique de la culture et de la technologie et plaide pour une anthropologie comparatiste du monde contemporain déjà proposée par d’autres chercheurs dans d’autres espaces [17]. Troisièmement, ce livre prend à bras le corps, et avec audace, l’interdisciplinarité. Les terrains dialoguent, les langues s’entrechoquent, les disciplines et les bibliographies valsent de concert, les continents se rejoignent, des régimes de connaissance informent d’autres régimes d’appréhension des choses et des êtres. Que des études de science fécondent des études chinoises (et inversement) et que l’anthropologie complète le tableau n’est pas si fréquent. Peut-être et surtout, ce sont des terrains, menés durant plusieurs années, qui nourrissent la démonstration et servent – au moins autant que les théories – à étayer les raisonnements. Cette pluridisciplinarité ne donne pas lieu à la multiplication des jargons, il n’est pas nécessaire de parler le mandarin ou de pratiquer la musique électronique pour lire un ouvrage écrit avec le souci constant d’être compris. De nombreux croquis, dessins et photos sont régulièrement mobilisés, façon de rappeler tout au long de l’ouvrage la matérialité des objets et de familiariser les lecteurs/trices avec les espaces considérés durant l’enquête. 4) Quelques objections Après tant d’éloges, y a t-il des objections ? Mais oui. La principale tient à la mobilisation des « vraies » sciences à la fin de l’ouvrage pour justifier l’édifice théorique de Zimmermann et le présenter comme l’expression de lois immanentes. Pourquoi mobiliser les sciences dures, et en particulier les neurosciences, comme des juges de paix alors même que l’un des apports les plus significatifs des STS est d’avoir montré que les conditions qui sont censées garantir l’objectivité scientifique ne sont pas plus ni moins dures que les autres productions (des sciences) sociales ? A-t-on besoin de se référer aux neurosciences et au cerveau pour montrer la plasticité des actions humaines et des objets ? Pour rappeler que le destin d’un objet n’est pas entièrement inscrit dans sa structure on peut tout aussi bien prendre l’exemple de la platine-disques, d’abord instrument d’écoute domestique (à la maison ou dans un studio de radio), puis devenant instrument de musique dans les performances et les enregistrements de hip hop et de techno. En rappelant qu’un DJ a tour à tour été un présentateur de radio, l’animateur d’un night club puis un DJ mixant des vinyles dans une free party on peut fort bien rendre compte de ce qui reste (les vinyles, les gestes, les répertoires enregistrés) et de ce qui se modifie (les gestes, les musiques produites). Il aurait au moins fallu expliquer pour quelles raisons le « programme fort » des STS, le fait que l’objectivité scientifique a une histoire et que ces conventions sont négociées [18], est court-circuité. Plus généralement, que peut nous apporter une modélisation ? Proposer une conception dynamique de la culture, renouveler et croiser des champs théoriques, construire des terrains de façon si minutieuse et réflexive, mobiliser la musique et ses interfaces comme de véritables arènes sociales est déjà beaucoup ! L’un des apports sans doute les plus intéressants de l’ouvrage est justement de montrer que les modélisations théoriques – ou ceux qui s’efforcent de démontrer qu’elles sont parfaites – négligent souvent ce qui ne fonctionne pas, ce qui nous échappe. Au final, prétendre décrire la culture et des dynamiques par le biais d’un système est encore un peu trop... moderne [19]. D’autant plus dans un ouvrage de théorie si collaborative, qui mobilise tant de personnes, de faisceaux d’explication, d’acteurs, de temporalités et d’espaces. Une autre remarque que l’on peut formuler, qui émane elle aussi de ce que les STS nous ont enseigné, est que l’on aurait bien aimé suivre un peu plus des gens qui ne « réussissent pas », des amateurs qui ne seraient pas devenus professionnels, des vaincu-e-s. On aurait ainsi aimé savoir comment les femmes ont agi dans ces mondes électroniques et ce que l’ethnographe a vu et entendu, y compris en creux, de ce côté-là. Peut-être qu’alors la résistance des choses, la difficulté de traduire et de s’approprier des langages et des interfaces auraient pris d’autres physionomies. VI. Conclusion Ces réserves ne doivent pas faire oublier le très grand intérêt, le sérieux, l’imagination théorique et ethnographique, les qualités narratives, l’originalité et l’audace réjouissante de cet ouvrage. Au carrefour des sound studies, des popular music studies et de l’ethnomusicologie (dont on n’a pas parlé ici mais qui peuvent tirer grand profit de l’ouvrage), de la socio-anthropologie, des STS et des études sur la Chine, Waves and Forms propose de très nombreuses pistes de réflexions et renouvelle à plus d’un titre la façon de considérer musique et culture. Souhaitons qu’il soit traduit en français le plus rapidement possible, qu’il soit analysé, débattu et lu par le plus grand nombre de chercheur-e-s et d’étudiant-e-s. |
||||
|
AUTEUR François Ribac Maître de conférences Université de Bourgogne Franche-Comté, Cimeos-EA 4177 |
||||
|
ANNEXES |
||||
|
NOTES
[2]
Raymond Murray Schafer,
The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the
World, Rochester, Destiny Books, 1977 ; Michael Bull et Les
Back (dir.), The Auditory Reader, New York, Berg,
2003 ; Trevor Pinch et Franck Trocco,
Analog Days. The Invention and Impact of the Moog Synthesizer, Cambridge, Harvard University Press, 2002 ; Jonathan Sterne, The audible past. Cultural origins of sound reproduction,
Durham, Duke University Press, 2003.
[3]
Alfred Gell, Art and Agency; An Anthropological Theory, New
York, Oxford University Press, 1998.
[4]
Bruno Latour, Madeleine Akrich et Michel Callon (éd.), Sociologie de la traduction. Textes fondateurs, Paris,
Presses des Mines, 2006.
[5]
David Bloor, Knowledge and social imagery, London, Routledge
& Kegan, 1976.
[6]
Harry Collins, Tacit and explicit knowledge, Chicago,
University of Chicago Press, 2010 ; Harry Collins et
Robert Evans, Rethinking Expertise, Chicago-London, The
University of Chicago Press, 2007.
[7]
Howard Becker, Les mondes de l’art, Paris, Flammarion,
1988.
[8]
Sur cet usage de la BD : Basile Zimmermann,
« L’utilisation de la bande dessinée pour
montrer l’action des objets techniques », dans
Pierre-Jean Benghozi et Thomas Paris (dir.), Howard Becker et les mondes de l’art, actes du
colloque de Cerisy, Éditions de l’École
polytechnique, 2013, p. 259-273.
[9]
L’idée que les objets voire les systèmes
technologiques réunissent des acteurs est bien entendu
très importante dans l’ANT. Le concept d’objet
frontière exprime également bien la capacité
d’un objet de réunir des personnes et des pratiques
dissemblables, voire divergentes. Cf. Susan L. Star et James R.
Griesemer. « Institutionnal ecology,
‘Translations’, and Boundary objects: amateurs and
professionals on Berkeley’s museum of vertrebate
zoologie », Social Studies of Science,
vol. 19, no 3, 1989, p. 387-420.
[10]
Voir par exemple Michel Serres, Petite poucette, Paris, Le
Pommier, 2012 ; et Nelly Oudshoorn et Trevor Pinch (dir.),
How Users Matter: The Co-Construction of Users and Technology
(Inside Technology), Cambridge, The MIT Press, 2003.
[11]
H. Stith Bennett, On becoming a rock musician, Amherst,
University of Massachussets Press,1980 ; Lucy Green, How popular musicians learn, a way ahead for music education, Ashgate, Aldershot, 2001 ; François Ribac,
« Sur l’importance des disques et du recording dans
la musique populaire et la techno », Mouvements,
n° 42, 2005, p. 54-60 ; François Ribac,
« L’autre musique de chambre, comment de jeunes
adolescent-es ont appris la musique », dans Sylvie
Octobre et Régine Sirota (dir.), Actes du colloque international Enfance et cultures,
Ministère de la Culture et de la Communication - Association
internationale des sociologues de langue française -
Université Paris Descartes, Paris, 2010, p. 492-504. En
ligne :
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Etudes-et-statistiques/L-actualite-du-DEPS/Actes-du-colloque-Enfance-Cultures-2010/Actes-Enfanceetcultures-global.pdf.
[12]
Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe, Princeton,
Princeton University Press, 2000.
[13]
Cette idée d’aborder la musique à partir de ses
médiations est au cœur des travaux de la sociologie de la
musique de Hennion et DeNora : Antoine Hennion, La Passion Musicale, une sociologie de la médiation,
Paris, Métailé, 1993 ; Tia DeNora, Music in Action. selected essays in sonic ecology, Farnham,
Ashgate, 2011.
[14]
Tant Collins et Evans que Zimmermann divergent de la
définition de Michael Polanyi pour qui les savoirs tacites se
réfèrent à des règles immanentes auxquelles il
n’est pas possible d’accéder. Comme Lawrence, ils
constatent simplement qu’il est difficile et même
impossible de transmettre certaines choses parce qu’elles ne
peuvent être décrites (et enseignées) par
l’intermédiaire de la langue et/ou des modes de
représentation. Cf. Michael Polanyi, The Tacit Dimension, Gloucester (Mass.), Peter Smith,
1983 ; Christopher Lawrence, « Incommunicable
Knowledge: science, technology and the clinical art in Britain
1850-1914 », Journal of contemporary History,
vol. 20, no 4, 1985, p. 503-521.
[15]
Richard Dawkins, Foreword. In the Meme Machine, New York,
Oxford University Press, 2006.
[16]
Bruno Latour « Les “vues” de l’esprit.
Une introduction à l’anthropologie des sciences et des
techniques », Réseaux, vol. 5,
no 27, 1987, p. 79-96.
[17]
Voir en particulier Arjun Appadurai (dir.),
The Social Life of Things Commodities in Cultural Perspective, Cambridge, Cambridge University Press, 1986 ; et pour la
musique : Eliot Bates « The Social Life of Musical
Instruments », Ethnomusicology, vol. 56,
no 3, 2012, p. 363-395. Le fait de considérer
comment une culture musicale circule par l’intermédiaire
de répertoires enregistrés et de machines et est tout
à la fois conservée et transformée par de nouveaux
acteurs et objets évoque le travail d’un autre
genevois : Nicolas Nova, 8 bit Reggae, collision and creolization, Volumique, 2014.
[18]
Lorraine Daston et Peter Galison, Objectivité, traduit
par Sophie Renaut et Hélène Quiniou, Dijon, Les Presses
du réel, 2012.
[19]
Bruno Latour, Nous n’avons jamais été modernes, Paris,
Éditions de la Découverte & Syros, 1991.
|
||||
|
RÉFÉRENCES Pour citer cet article : François Ribac, « Basile Zimmermann, Waves and Forms. Electronic Devices and Computer Enconding in China, Cambridge, The MIT Press, 2015, 277 p. », Territoires contemporains - nouvelle série [en ligne], 8 juin 2018, disponible sur : http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/prodscientifique/TC.html. Auteur : François Ribac. Droits : http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/prodscientifique/TC/credits_contacts.html ISSN : 1961-9944 |
||||
|
OUTILS |