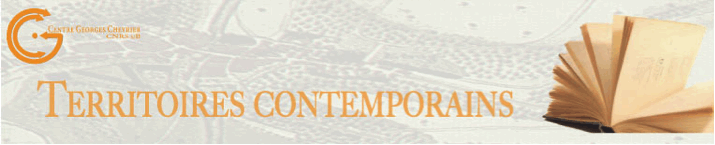 Bruno Delmas, La société sans mémoire. Propos dissidents sur la politique des archives en France, Paris, Bourin éd., 2006. Les Archives
en France sont souffrantes et seraient en proie à une crise structurelle et
conjecturelle. La Direction des archives de France n’aurait plus les moyens de
remplir son rôle et le rayonnement des Archives nationales se réduirait comme
peau de chagrin. Bref, les archives seraient tombées dans un cercle vicieux
dont par méconnaissance et désintérêt personne ne s’émeut aujourd’hui. La
France, forte d’une histoire archivistique longue de deux siècles, se
préparerait donc un avenir sans devenir.
Sur la base de la dialectique de la mémoire et de l’oubli, l’ouvrage se divise en trois parties discutant à leur tour de la mémoire invisible, occultée et retrouvée. Dans la
première partie Bruno Delmas constate, non sans une certaine consternation
lucide, l’inexistence d’une culture des archives tant au sein du grand public
que chez les hauts fonctionnaires de l’Etat et l’absence de volonté d’en
insuffler une. Conscient que les archives sont une « réalité complexe,
mouvante et difficile à imaginer », il tente, au travers d’un propos large
et didactique, de définir ce qu’elles sont, comment elles fonctionnent et à
quoi elles servent. Le tout illustré par des anecdotes et des exemples
concrets.
Loin de se réduire à de vieux
papiers, les archives sont le produit de l’activité de toute personne physique
ou morale, sans distinction de support. La loi du 3 janvier 1979 leur confère
une définition très large qui permet d’y inclure les documents sur parchemin,
les bases de données, les e-mails, mais également les
bandes sonores, ou encore les photographies. Mais à côté de ces archives
traditionnelles, Bruno Delmas rappelle par une série d’exemples marquants que
tout, même dans les productions les plus inattendues, est archives : les
carottes géologiques, comme les flacons de fragrances de parfum, les dessins de
tissus d’ameublement ou encore les archives des scientifiques des relevés
d’observations des astronomes aux immenses collections entomologiques du Muséum
d’Histoire naturelle. A cet égard ses usages sont multiples de l’affirmation
d’un droit ou d’une preuve, et c’était là l’objet premier de la création des
archives, à la recherche scientifique désintéressée. Suivant ce développement
intellectuel et technologique, le vénérable métier d’archiviste s’en trouve
aujourd’hui transformé. Bruno Delmas en souligne la singularité en regard des
autres professions de la documentation : il ne se résume pas à donner
accès à des informations publiques, marquées par une inflation technologique
toujours grandissante. De l’étude de la caroline à l’XML, du parchemin à LINUX,
l’archiviste est toujours celui (ou celle) à qui l’on enseigne le déchiffrement
les écritures pour les rendre aujourd’hui et demain accessibles à tous, pour
« permettre aux sociétés de traverser le temps ». Seulement, les
problématiques qui se posent au métier l’ont un peu plus encore déplacé.
La troisième et dernière partie se fait tribune des « nouveaux horizons » possibles de l’Etat en matière d’archives afin que la société française soit à même de retrouver sa mémoire. Bruno Delmas, dans un premier temps, se plaît à souffler de nouvelles pistes de développement et de refondation de compétences indispensables, selon lui, à l’Etat. Partant du postulat quasi philosophique que les archives sont des actes, il présente au travers de ce qui forme selon lui les grandes questions sociétales, les clés de connaissances que peuvent constituer les archives. L’auteur appelle ainsi à repenser la problématique des archives autour des quatre fondamentaux du métier d’archiviste : la collecte ; le tri et la sélection ; la communication ; la conservation des documents. Il incombe, selon l’auteur, aux archivistes de penser leur mode de collecte en adaptant leurs pratiques aux nouvelles formes prises par les archives, de renouveler la réflexion sur le tri et la sélection des archives, afin de prendre en compte l’imprévisible, il questionne les propositions de réduction des délais de communication en regard du respect de la vie privée, et argue contre les illusions et les promesses de modernité du toute technique de conservation des archives. Quelles conséquences pratiques sur l’appréhension du métier d’archiviste ? La haute opinion de l’auteur quant à sa profession le fait souligner le déplacement du métier vers une discipline autonome et hautement scientifique. Face à la numérisation de la société de l’information et à la redéfinition de l’archiviste en « tiers-archiveur », les archivistes doivent certes repenser leurs objectifs sans pour autant perdre de vue « leur démarche propre ». Face à la constatation d’un déplacement de la notion d’archives, Bruno Delmas invite l’Etat à se resituer. Selon lui, les archives ne se restreignant plus à de simples problèmes patrimoniaux et culturels le rattachement de la DAF au ministère de la Culture s’avère caduque. Repenser sa position sur l’organigramme, en la rattachant au secrétaire général du gouvernement ou au Premier ministre serait une solution, à son sens plus pertinente. Mais l’auteur plaide surtout pour un regard plus global du problème et s’interroge pour un repositionnement des archives dans la société française telle qu’elle est actuellement, une « société de la connaissance ». Véritable
profession de foi archivistique, l’ouvrage de Bruno Delmas expose au travers
d’une réalité bien connue des acteurs des archives, une série de propositions
pour une modification en profondeur, une refondation et une réaffirmation de la
politique des archives en France. Y a-t-il alors, comme l’annonce de manière
alléchante le sous-titre une réelle « dissidence » dans l’ensemble
des propos ? Ils lui sont en tout cas personnels, comme il le précise en
introduction et sortent pour une fois du cadre restreint des réunions ou des
apartés de spécialistes. Que l’on pense avec ou que l’on pense contre, la
lecture ou la relecture de cet ouvrage, après la mise en place de la nouvelle
loi sur les archives en juin 2008, et en pleine R.G.P.P., invite toujours à une
prise de conscience quant aux choix qui doivent être opérés en matière de
politique archivistique sur le territoire français ainsi qu’à un regard
critique et exigeant sur l’évolution administrative, scientifique et d’animation
que l’on veut ou que l’on doit lui assigner.
Julie Lauvernier
Pour citer cet article
: |