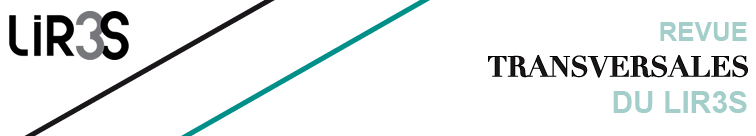
Barbare et sauvage
Au regard des définitions naïves des deux termes, nous voyons déjà s'esquisser une ligne de partage entre le barbare, qui désigne l'altérité, le dehors relatif (l'étranger) ou même absolu (l'inhumain), et le sauvage, qui s'inscrit dans la figure du même, de l'enfance et du bon naturel. Si le barbare est incapable de culture et représente les forces incontrôlables de la nature, il semblerait que le sauvage soit davantage appelé, par sa nature conciliante, à accepter les valeurs de la civilisation et de la société humaine. Le sauvage manque seulement de temps et de progrès ; le barbare est définitivement in-capable ou in-culte. Il semblerait alors que « la défense de la société » soit liée à l'éclosion du sauvage, et menacée par l'indocilité du barbare : si nous filions une image immunitaire (la protection contre un corps étranger), c'est le barbare qu'il nous faudrait désigner comme « élément pathogène ». Exposons une première difficulté : exclure a priori l'autre, le barbare, en prétextant un danger, et inclure a priori le même, le sauvage, en prétextant une sécurité, cela ne cache-t-il pas tout un champ d'analyse, et l'adversaire le plus insidieux ? À titre provisoire donc : le bon sauvage ne pourrait-il pas être théoriquement plus dangereux que le barbare ?
Recentrons sur Foucault : « sauvage » et « barbare » ne sont ni des concepts centraux ni même des termes récurrents. Quelques exceptions apparaissent, comme dans l'Histoire de la folie, lorsque Foucault entend, à la toute fin de l'ouvrage, rendre aux cris des fous qui étoilent l'histoire – Nietzsche, Artaud… – leur « primitive sauvagerie », qui devrait déchirer la longue mise au silence de la folie par la raison. Mais l'ouvrage de 1961, s'il admet en droit une folie sauvage, a davantage pour objet les procédures générales de la raison, qui ont, à différentes époques et différemment, enseveli la folie ; citons la première préface :
« Faire l'histoire de la folie voudra donc dire : faire une étude structurale de l'ensemble historique – notions, institutions, mesures juridiques et policières, concepts scientifiques – qui tient captive une folie dont l'état sauvage ne peut jamais être restitué en lui-même ; mais à défaut de cette inaccessible pureté primitive, l'étude structurale doit remonter vers la décision qui lie et sépare à la fois raison et folie[1]. »
Dans son ouvrage consacré à Foucault, Deleuze, qui insiste sur l'absence du concept de sauvage dans la pensée de Foucault, rappelant d'abord le refus d'une expérience phénoménologique pré-réflexive ou pré-discursive, puis la thèse selon laquelle il n'y a pas de marge ou d'extériorité possible aux relations de pouvoir, évoque un emploi possible de « sauvage » dans la philosophie de Foucault en le liant au « dehors » : il y aurait des « singularités sauvages, qui restent suspendues au dehors, sans entrer dans des rapports ni se laisser intégrer […] là seulement le “sauvage” prend un sens, non pas comme une expérience, mais comme ce qui ne rentre pas encore dans l'expérience[2] ». Sans approfondir cette digression dont nous acceptons l'intuition, retenons que « sauvage » peut trouver une importance clé, et ce dès les années « littéraires » de Foucault, ici dans le sens d'un principe d'altérité.
Rassemblons ces premiers mots épars : notre problème consiste à comprendre, malgré l'absence relative de ces termes dans l'œuvre, comment la distinction entre barbare et sauvage, travaillée par Foucault dans le cours de 1976, Il faut défendre la société, exprime pleinement un tournant dans sa philosophie et permet à son auteur de préciser sa propre démarche généalogique et critique.
Nous essaierons d'abord de montrer que le « barbare » est pour Foucault un instrument théorique plus fertile que le « sauvage », parce qu'il permet seul de rendre visible les rapports réels de pouvoir à l'œuvre dans une société – le sauvage les voilant.
Nous voudrions ensuite nuancer ou plutôt « déborder » la présentation foucaldienne du barbare, en montrant que le barbare nietzschéen, auquel Foucault se réfère pourtant, contredit sur un certain nombre de points cette figure à laquelle Foucault affilie sa généalogie.
Enfin nous nous évertuerons à montrer que cette différence entre barbare (nietzschéen) et barbare (foucaldien) n'est pas un oubli de Foucault – ou alors un oubli bien volontaire, signifiant en réalité que le barbare nietzschéen est « théoriquement » aussi nuisible que le sauvage.
Barbare contre sauvage
Le cours de 1976 Il faut défendre la société s'interroge sur le modèle, la logique,
la rationalité adéquate pour interroger les normes et les relations
de pouvoir qui traversent le champ social. C'est dire que Foucault
s'interroge sur son propre discours ou sa propre méthode, la
généalogie, afin d'en déterminer l'enjeu et la pertinence. La
question que l'on trouve filée à travers tout l'ouvrage est posée
page 14 : « Qu'est-ce que le pouvoir[3] ? »
Pour y répondre, Foucault énonce deux hypothèses :
Premièrement, ce que Foucault nomme le
schéma juridique, qui analyse le pouvoir dans les termes du légitime
ou de l'illégitime : le souverain ne doit pas déborder les
limites qui lui ont été imposées lors du pacte social.
Deuxièmement, le modèle de la lutte,
le modèle « nietzschéen » qui retournerait la formule
de Clausewitz : « la politique, c'est la guerre continuée
par d'autres moyens ». Cette hypothèse revient à analyser le
pouvoir dans les termes de la domination et de la soumission.
On retrouve cette structure binaire à travers tout le cours de 1976, partagé entre les discours historicistes, discours des guerres ou encore discours des races – Boulainvilliers – et les discours qui tentent de nier ces discours des races, de les dépasser dans une vision juridique. Hobbes par exemple n'est pas présenté – à raison – comme le penseur de la guerre généralisée, scandaleuse, indépassable, mais comme le penseur rassurant de la sortie de l'état de guerre de tous contre tous, comme le penseur qui s'oppose aux discours de la lutte permanente qui fleurissent dans l'Angleterre de son époque. Hobbes, à la limite, est l'archétype de l'hypothèse juridique qui manque les relations réelles de pouvoir ; et Foucault décrira sa méthode comme un renversement du modèle du Léviathan : ne pas partir, pour comprendre le pouvoir, d'en haut, du souverain, du droit, mais d'en bas, de la « capilarité » et des connexions fines et réelles du pouvoir.
Que disent ces discours des races dont Foucault fait l'objet central de son cours de 76 ? Que sous la paix et la loi gicle le sang et se déchiffre la guerre. Que la société est traversée par une structure binaire : deux clans, deux groupes, deux armées, qui se sont affrontés, s'affrontent et s'affronteront encore. Que le discourant prend position : non pas sujet juridique universel revendiquant des droits pour tous, mais sujet de lutte ayant choisi son camp dans une bataille, au nom de droits particuliers et selon une vérité perspectiviste. Qu'enfin l'intelligibilité du réel et de l'histoire ne vient pas de quelque principe transcendant et supérieur, mais d'en bas, du plus confus des passions et des violences. Le schéma de la lutte reprend donc les principes de la généalogie exposés dès 1970.
Pour cristalliser le
renversement du schéma juridique dans celui de la guerre, Foucault
explique en substance que Boulainvilliers transforme le sens du
concept de constitution. La constitution, ce n'est plus cette
convention juridique fondatrice, contractée dans un temps premier
entre le souverain et ses sujets, c'est-à-dire quelque chose de
l'ordre de la loi, mais c'est bien plutôt quelque chose de l'ordre
de la force : la constitution en un sens organique, dynamique,
d'équilibre chancelant, de rapport asymétrique. La constitution de
Boulainvilliers, c'est un état transitoire dans une lutte, un moment
dans une bataille. Constitution anti-juridique donc, mais aussi bien
anti-naturaliste : l'adversaire de Boulainvilliers ou du
discours des races, c'est l'homme de nature ou l'homme à l'état de
nature, le sauvage antérieur au corps social qui permet aux
théoriciens du droit de construire ce corps social. Mais c'est
aussi, ajoute Foucault, le sauvage homo oeconomicus créé par les économistes, mû par son seul intérêt et voué à
l'échange et au troc. « En tant qu'échangeur de droits, il
fonde la société et la souveraineté. En tant qu'échangeur de
biens, il constitue un corps social qui est, en même temps, un corps
économique. Depuis le XVIIIe siècle, le sauvage c'est le sujet
de l'échange élémentaire[4]. »
Et c'est précisément contre ce sauvage que le discours
historico-politique des races dresse la figure du barbare. Foucault
distingue alors assez longuement le barbare et le sauvage sur trois
points :
Premièrement, le barbare apparaît sur
un fond de civilisation qu'il vient détruire de l'extérieur, et
suppose donc l'histoire, à l'inverse du sauvage qui repose sur un
fond de nature. Si le barbare appartient à la nature, c'est une
nature qui n'est qu'histoire, que guerre et que violence.
Deuxièmement, le barbare n'est pas
vecteur d'échange comme le sauvage, mais vecteur de domination. Il
ne cède jamais sa liberté naturelle à l'occasion d'un contrat, et
s'il se donne un pouvoir, un chef, c'est pour gagner en force et en
puissance.
Troisièmement, alors que le sauvage
est toujours bon puisqu'il échange dans des conditions de
réciprocité, le barbare est toujours affecté d'une valeur
négative : il est mauvais.
Les deux schémas méthodologiques pour analyser le pouvoir sont donc articulés l'un à l'autre : l'hypothèse juridique, métaphorisée par la figure du sauvage, est ce qui cache, ce qui empêche de considérer les relations de pouvoir à l'œuvre dans la société, dont le mode de réalisation est la guerre, métaphorisée par la figure du barbare. En un sens donc, le sauvage, pour Foucault mais aussi pour toute la tradition historiciste, n'est pas l'image tranquillisante de la santé du corps social : le sauvage est un dangereux artifice qui voile la réalité barbare du pouvoir.
Barbare sauvage
Il nous semble important d'insister sur la distance qui sépare le barbare nietzschéen du barbare tel que Foucault le présente ; en somme de placer la différence non plus entre le sauvage et le barbare, mais entre le barbare et le barbare.
Premièrement, on l'a vu, Foucault présente le mauvais barbare contre le bon sauvage. Or la première dissertation de la Généalogie de la morale s'interroge précisément sur l'apparition du « bon » et du « mauvais ». Pour cela, elle établit une double provenance des jugements moraux, mettant en lumière deux typologies de force : d'une part, l'aristocratie guerrière (le maître, le barbare), d'autre part l'aristocratie des prêtres (l'esclave). Cette double provenance est calquée sur le « critère » nietzschéen, le barbare relevant de l'activité, et l'esclave de la réactivité. Dans un fragment tiré de la Volonté de puissance, Nietzsche rend compte de ce critère : « qu'est-ce qui est actif ? Tendre à la puissance[5] » De ce point de vue, l'aristocratie des guerriers, à laquelle appartient le barbare, évalue le bon et le mauvais par rapport à ses « valeurs » ou « conditions d'existence », c'est-à-dire la puissance : est « bon » ce qui s'affirme comme fort dans une spontanéité autoglorificatrice ; est mauvais ce qui relève de l'impuissance et du ressentiment. C'est l'opposition entre un « oui », et un « non », une réponse, ou plutôt une définition du bon et du mauvais par réaction contre le mode d'évaluation noble : pour l'esclave, est d'abord mauvais ce qui tue, ce qui domine et ce qui asservit – le barbare –, et bon ce qui ne relève pas de la puissance ou de la santé, ce qui est pur de cruauté et de barbarie… Le barbare est donc le résultat d'une évaluation préalable dont le sens varie selon la perspective : portée par une volonté de puissance active, le barbare est synonyme de puissance et de liberté ; portée par une volonté de puissance réactive, le barbare intègre la sphère du mal, de la violence et de l'inhumanité. Chez Nietzsche, la barbarité du barbare est réductible à un jugement moral, mais inverse par rapport à ce qu'énonce Foucault : c'est le barbare qui est bon, parce qu'il s'érige comme bon.
Deuxièmement, Foucault décrit le sauvage au fondement de la société, et le barbare à l'extérieur d'une culture qu'il vient détruire. Or pour Nietzsche le barbare se définit aussi par une société propre : il n'est pas asocial ou inculte, impropre à toute civilisation. Au contraire, s'il apparaît comme barbare, cruel, impitoyable à l'extérieur de son clan, c'est parce qu'il entretient des relations policées et contraignantes à l'intérieur du groupe. Le barbare est ici encore une figure duelle bien plus qu'une figure de pure nature ou de pure histoire : contrainte, complexe et disciplinée à l'intérieur du groupe social, et libérée, débridée contre les peuples extérieurs. Les barbares « savourent la libération à l'égard de toute contrainte sociale, ils se dédommagent dans cette étendue sauvage de la tension résultant d'une longue réclusion et mise en cage dans la paix de la communauté, ils reviennent à l'innocence de conscience qui est celle de la bête de proie, en monstres transportés d'allégresse […] ce fond caché a besoin de se décharger de temps en temps, il faut que l'animal sorte de nouveau, qu'il retourne à l'étendue sauvage[6] ». Plutôt que d'un manque ou d'une incapacité congénitale à s'élever aux conditions de la culture, Nietzsche réfère la cruauté du barbare à un excès de règles et de contraintes sociales.
Autrement dit, Nietzsche renvoie moins le barbare à une servitude vis-à-vis de ses penchants animaux qu'à une liberté qui s'épand faute de l'être au-dedans de la communauté. Seulement on devine que cette liberté n'est pas libre-arbitre : elle est le sentiment qui convient à un accroissement de puissance et à une conquête, elle est un plaisir pris à la destruction. Mais ce n'est là qu'un versant de la liberté, la destruction apparaissant dans le texte nietzschéen comme l'envers d'un miroir dont la création serait l'endroit. Et le mouvement par lequel le barbare anéantit des peuples est indissociable du mouvement par lequel il informe ces peuples et fonde des États : « je signale une chose nouvelle : certes, pour une démocratie, la barbarie est un péril […]. Il existe une autre sorte de barbares, qui viennent des hauteurs : une race conquérante et dominatrice qui se cherche une matière qu'elle puisse modeler[7] ». Les premiers fondateurs d'États, ceux que Nietzsche nomme aussi « les artistes les plus involontaires, les plus inconscients » parce qu'ils ignorent la responsabilité, posent leurs griffes sur une population inorganisée et imposent, sur ce chaos, leurs sens et leurs valeurs. Plutôt que des vecteurs de chaos, les barbares sont des vecteurs d'organisation et de mise en ordre sociales.
Enfin troisièmement Foucault oppose l'historicité du barbare à la naturalité et la juridicité du sauvage. Or le barbare chez Nietzsche convient moins à l'époque historique qu'à l'époque préhistorique. Foucault oppose en un sens le droit comme mythe à la guerre comme réalité historique. Mais le barbare chez Nietzsche est, non pas fictif comme le sauvage à l'état de nature, mais réel avant l'histoire. Il appartient à ce que Nietzsche appelle la « moralité des mœurs », qui est le « travail de l'homme sur lui-même pendant la plus longue période de l'espèce humaine, tout son travail préhistorique […] quel que soit d'ailleurs le degré de cruauté, de tyrannie, de stupidité et d'idiotie qui lui est propre »[8]. Ce travail de l'homme sur l'homme pendant la moralité des mœurs a pour but d'obtenir, selon le mot de La généalogie de la morale, un animal capable de promesse. Mais cette culture est barbare et elle est réalisée dans le sang et la souffrance : à un oubli ou une promesse non tenue répond une douleur subie. Ce qui signifie qu'au fondement de cette justice préhistorique se trouve une logique du châtiment – matrice de toute logique –, et que le rapport d'homme à l'homme est originairement un rapport de créancier à débiteur, ou de barbare à esclave, et non de contractant à contractant.
L'histoire chez Nietzsche caractérise le triomphe des esclaves et la domestication du barbare, dompté par un artifice spirituel, la mauvaise conscience, qui oriente ses forces contre lui-même, plutôt qu'au dehors. L'histoire retrace le dressage « contre-nature » du barbare, c'est-à-dire contre la puissance de vie qui le caractérisait. Seulement, le barbare civilisé est, comme le sauvage rousseauiste forcé à la société, corrompu. Et la généalogie doit retrouver, à travers les vestiges de l'état civilisé, le sens de la nature, l'essence de la vie qui n'est pas de paix mais de guerre : « que signifie vivre ? – Vivre – cela veut dire : rejeter sans cesse loin de soi quelque chose qui tend à mourir ; vivre – cela veut dire : être cruel et inexorable pour tout ce qui en nous n'est que faible et vieilli, et pas seulement en nous. Vivre – serait-ce donc : être impitoyable pour les agonisants, les misérables et les vieillards ? Être sans cesse un assassin ?[9] » En retrouvant l'essence guerrière et barbare de la vie, Nietzsche peut se servir doublement du barbare : il est en effet l'étalon, le fragment brut de vie, par rapport auquel Nietzsche peut juger d'une part de la décadence de sa civilisation, et dessiner d'autre part les linéaments du corps « surhumain » à venir. Le surhumain, c'est la barbarie naturelle travaillée, cultivée, mais dans le sens de l'activité et non plus de la réactivité. L'éthique nietzschéenne visera à « renaturaliser » le corps de l'homme, à retrouver la vie ascendante du barbare. Et de ce point de vue, Nietzsche ne distingue pas le sauvage et le barbare : tous deux réfèrent à la vie non corrompue par la morale des esclaves : « c'est dans sa nature sauvage que l'on se repose le mieux de sa non-nature, de sa spiritualité…[10] ». Sauvage et barbare sont deux métaphores de la nature cad de l'activité et de la vie, dont Nietzsche ne se sert pas comme norme mais comme instrument de lutte contre la contre-nature décadente et nihiliste de son époque. Mais si barbare et sauvage s'équivalent chez Nietzsche, c'est pour une raison dont on pressent qu'elle est à l'origine de la distanciation de Foucault : c'est qu'ils sont tous les deux des métaphores de la vie et donc de la guerre comme norme.
Ni barbare, ni sauvage
Le barbare, par distinction avec le
sauvage, offre à Foucault des instruments d'analyse du pouvoir
convenables – pour un généalogiste –, grâce au
schème de la guerre. Et Foucault, dans le cours de 76, recense bien
les trois grandes technologies de pouvoir qu'il repère au sein des
civilisations occidentales :
Premièrement, le pouvoir souverain, se
caractérisant par le droit de faire mourir et de laisser vivre. La
toute-puissance du souverain se définit par un déséquilibre, moins
en faveur de la vie – cela conviendrait au schéma juridique de la
souveraineté : je contracte dans le but de ma conservation et
de ma liberté – que de la mort : le souverain, c'est d'abord
celui qui peut tuer.
Deuxièmement, le pouvoir
disciplinaire, pouvoir de surveillance continue sur les corps en leur
imposant un rapport d'utilité/docilité.
Troisièmement, et
c'est ce type de pouvoir qui se trouve épistémologiquement
« débloqué » et théorisé dans le cours de 1976, le
bio-pouvoir, qui naît dans la seconde moitié du XVIIIe siècle,
et s'applique au niveau de la vie des hommes, c'est-à-dire, pour le
caractériser par rapport au pouvoir disciplinaire, non plus au
niveau des corps individuels, mais au niveau du corps-espèce, au
niveau d'une masse et de ses variables : natalité, morbidité,
mortalité, mais aussi vieillesse et infirmités, et enfin relation
entre l'espèce et son milieu : effets géographiques,
climatiques sur la démographie… Le bio-pouvoir va donc agir comme
régulateur sur les grandes fonctions vitales et les processus
biologiques ; et dans cette prise en charge de la vie, c'est la
mort qui tombe hors du pouvoir : son extérieur, son autre. Pour
reprendre les termes de Foucault : le bio-pouvoir vise donc un
« équilibre global, quelque chose comme une homéostasie :
la sécurité de l'ensemble par rapport à ses dangers
internes[11] ».
Le pouvoir souverain est du côté de la mort : il fait mourir
et laisse vivre ; le bio-pouvoir, dans son exercice, inverse le
rapport : il fait vivre, et laisse tomber la mort.
Ce panorama des trois grandes technologies du pouvoir en Occident est justifié par le recours à l'image du barbare contre le sauvage, par le recours donc au modèle de la guerre contre celui du droit. Nous aimerions montrer pour terminer comment Foucault, d'une certaine façon, en vient à refuser aussi une certaine pensée du barbare, à partir du problème présent dans le dernier cours de 76, c'est-à-dire le problème d'une société qui tue au nom d'un principe de défense presque immunitaire. Foucault renverse le problème du méchant barbare contre la bonne société en posant le problème suivant : à partir de ce bio-pouvoir, de ce pouvoir qui s'exerce sur la vie et qui s'évertue à tout faire pour faire vivre et maintenir en vie, comment expliquer l'État qui tue, et qui tue à grande échelle ? Comment lier ensemble le bio-pouvoir et le pouvoir sur la mort ? Et la réponse assez surprenante de Foucault, c'est le racisme : qui d'une part établit une distinction et une hiérarchisation de races au sein du continuum biologique ; qui d'autre part établit un rapport entre la mort et la vie selon la maxime : « plus tu tues, plus tu vis ». Seulement la vieille loi barbare et guerrière « tues ou meurs » fonctionne, dans le racisme, selon une rationalité biologique : plus les espèces inférieures disparaissent, plus moi, membre d'une espèce supérieure, je vivrai d'une vie purifiée.
Le racisme d'État auquel pense Foucault, ce fait que la société tue pour se défendre, réactive au sens généalogique le vieux discours des races. Mais à une différence près : c'est que ce droit de faire mourir, l'impératif de mort, n'est rendu possible que par des conditions biologiques et non plus politiques : ce n'est plus l'adversaire que je dois vaincre et subordonner ou informer comme le faisait encore le barbare nietzschéen, c'est l'élimination d'un danger qui menace la vie, et, par cette élimination, le renforcement de la vie. Il s'agit de défendre la société contre le danger qui menace l'intégrité du corps social de l'intérieur, danger que traquent sans relâche les sciences humaines branchées sur les disciplines. Aux dernières pages du cours de 75, Les Anormaux, Foucault écrit ces quelques lignes à propos de la psychiatrie qui résonnent avec celles du cours de 76 que nous suivons : « C'est un racisme donc qui aura pour fonction non pas tellement la prévention ou la défense d'un groupe contre un autre, que la détection, à l'intérieur même d'un groupe, de tous ceux qui pourront être porteurs effectivement du danger. Racisme interne, racisme qui permet de filtrer les individus à l'intérieur d'une société donnée[12]. » À partir du moment où la vie devient la norme – et la thèse de Foucault, c'est qu'elle le devient effectivement dans la civilisation occidentale à partir de la fin du XVIIIe siècle –, à partir du moment où la vie est l'objet principal du pouvoir, à partir du moment, en d'autres termes, où le pouvoir est d'abord et essentiellement un bio-pouvoir, c'est le racisme qui joue comme condition de possibilité du pouvoir sur la mort.
Foucault remonte alors du racisme d'État à la Révolution, puis au discours des races dans la filiation de Boulainvilliers : la Révolution est le moment où le tiers-état transforme le discours des deux races ennemies en un concept unitaire de race, la « nation », qui se définira à partir d'elle-même comme instance de vérité et comme instance normative.
« Au prix d'un transfert qui a été celui de la loi à la norme, du juridique au biologique ; au prix d'un passage qui a été celui du pluriel des races au singulier de la race ; au prix d'une transformation qui a fait du projet d'affranchissement le souci de la pureté, la souveraineté de l'État a investi, repris en compte, réutilisé dans sa stratégie propre le discours de la lutte des races. La souveraineté de l'État en a fait ainsi l'impératif de la protection de la race, comme une alternative et un barrage à l'appel révolutionnaire, qui dérivait, lui-même, de ce vieux discours des luttes, des déchiffrements, des revendications et des promesses [13].»
Le racisme d'État ou la défense de la société, c'est donc le discours révolutionnaire à l'envers : dans sa continuité – mêmes thèmes, même « problématisation » – et en rupture avec lui – subordonnant ces thèmes à une rationalité étatique et biologique.
Pour éclairer cette grande généalogie et les conclusions qui en dérivent, Foucault prend l'exemple-limite et hyperbolique de l'État nazi, comme pouvoir en même temps le plus meurtrier et le plus raciste, comme pouvoir exagérant chacun des trois grands régimes de pouvoir : le plus intensément souverainiste, disciplinaire et bio-logique. Le problème philosophique qui se pose à Foucault, c'est évidemment que la guerre est le souci fondamental et omniprésent du nazisme. Cette guerre à laquelle Foucault s'est affilié par le truchement du discours des races et de la généalogie nietzschéenne ne peut plus constituer le modèle d'analyse du pouvoir, parce qu'elle devient le souci permanent du racisme d'État : faire la guerre, cela devient pour l'État nazi l'unique moyen de défendre la société. La guerre est l'achèvement de la politique nazie, en un double sens qui place la vie au tribunal de la mort : non seulement l'extermination des autres races fortifie la race, mais encore l'exposition à la mort de sa propre race doit purifier et couronner la race aryenne. Il y a donc une exposition universelle à la mort dans le nazisme, non pas comme accident de l'histoire, comme exception, mais comme aboutissement d'une technologie de pouvoir qui fonde l'État moderne sur le bio-pouvoir, le pouvoir sur la vie.
Conclusion
Ce qui importe pour Foucault, c'est moins la construction ou la destruction de la société, le barbare ou le sauvage, que les pouvoirs qui la traversent, les normes qui circulent en elle, les asymétries qu'elle reconduit. Au fond, Foucault prend parti pour le barbare contre le sauvage parce que l'analyse de ces normes et de ces relations de pouvoir ne peut se faire que sur le modèle de la guerre ; et le modèle du droit, cette grande image du corps social fondé par contrat entre volontés universelles, ne fait que masquer les relations de pouvoir à l'oeuvre dans la société. Mais si le barbare a la préférence de Foucault dans le cours de 76, c'est parce qu'il est fertile pour penser ces relations de pouvoir, et non parce qu'il synthétise, comme chez Nietzsche, la normativité de la vie créatrice et dionysiaque. On pourrait établir en fait un double rejet de la part de Foucault, puisque ni la nature ni la vie ne peuvent servir de norme, pour cette raison que la nature ou la vie, et on pourrait même ajouter, parce que c'est l'objet du cours sur le Pouvoir psychiatrique de 1974, la réalité elle-même, sont les objets privilégiés du pouvoir. Double rejet donc du sauvage de Hobbes, de Rousseau, de Lévi-Strauss ou de l'homo oeconomicus d'une part, du barbare nietzschéen d'autre part. Et à travers ce double rejet, ce qui saute, c'est la guerre comme modèle d'analyse du pouvoir.
Pour resserrer sur le lien Nietzsche-Foucault, on peut dire que la présentation que fait Foucault du barbare, qu'il réfère à toute la tradition historiciste, tait volontairement ce que Foucault refuse du barbare nietzschéen, c'est-à-dire la vie considérée comme norme. Évidemment, Foucault connaît trop Nietzsche pour affilier le nazisme à sa philosophie ; mais ce que Foucault refuse, à cause de la menace historique du racisme d'État fondé sur le bio-pouvoir, c'est la possibilité d'utiliser la vie comme norme. La vie est presque un concept trop indéterminé – c'est-à-dire qu'on peut lui donner toutes les déterminations les plus fantasques et les plus dangereuses, et c'est ce que Foucault veut montrer avec l'exemple du nazisme – pour pouvoir être utilisé à la fois comme principe explicatif et comme principe normatif. Le problème du barbare nietzschéen, c'est peut-être que, fondé sur le concept de vie, il ne peut pas com-prendre – ce qui nécessite un « se déprendre » – et par conséquent résister au bio-pouvoir, dont il est contemporain en un sens généalogique. Ce que nous avons voulu dégager, c'est presque une réduction du barbare par lui-même : en démêlant le barbare du sauvage et le barbare du barbare, Foucault ne retient qu'un principe : l'altérité. Et, au fond, cette altérité qui définissait le barbare dans notre introduction, mais aussi bien le dehors sauvage rappelé par l'intermédiaire de Deleuze, Foucault le pense de manière radicale, en insistant sur les dangers naturalistes du barbare nietzschéen, qui ramènent l'altérité à une identité plus profonde. Il nous semble que Foucault fait ainsi jouer l'altérité pour elle-même, au sein d'une perspective critique et généalogique dont le seul horizon est de résistance.
Mathieu Fontaine
Centre Georges
Chevrier,
UMR 7366 CNRS-uB
(sous la direction de Pierre
Guenancia)
[1] « Dits et écrits », I p. 192 . Préface originaire à l'Histoire de la folie.
Pour citer cet article :
Mathieu Fontaine, « Barbare et sauvage », Revue TRANSVERSALES du Centre Georges Chevrier - 1 - mis en ligne le 12 mars 2014.
URL : http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/publications/transversales/Vandales_vandalismes/M_Fontaine.html
Auteur : Mathieu Fontaine
Droits : © Tous droits réservés - Ce texte ne doit pas être reproduit (sauf pour usage strictement privé), traduit ou diffusé. Le principe de la courte citation doit être respecté.