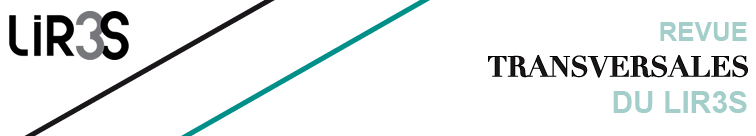
Courbet vandale et anti-vandale
Courbet vandale devient une évidence au moment où la Commune, après 72 jours de luttes, s’effondre face aux assauts des forces versaillaises. Sa responsabilité dans la démolition de la Colonne Vendôme le 16 mai 1871 ne fait aucun doute au cours de son procès en août 1871, tant l’idée en a été diffusée par les forces adverses, et relayée par la presse. Mais le chef d’accusation retenu contre Courbet le 2 septembre 1871, « d’avoir provoqué comme membre de la Commune, la destruction de la Colonne Vendôme », est clairement un moyen d’anéantir un artiste qui n’a cessé de vilipender le système des Beaux-Arts et l’Empire pendant vingt ans. Cette accusation clôt définitivement une carrière officielle commencée au Salon de 1849.
L’été 1871, la presse se déchaîne contre le peintre, et la caricature, la même qui tout au long de sa carrière avait brocardé sa peinture réaliste, fait immédiatement le lien entre le communard vandale et le peintre réaliste[1]. Dans une caricature de Léonce Scherer (Souvenirs de la Commune, 4 août 1871) figurant Courbet, pipe à la bouche, en tenue d’ouvrier et occupé à casser des pierres alors qu’en arrière-plan la colonne Vendôme chute, la logique de cet amalgame est évidente, soulignée par la légende : « L’homme qui était un jour appelé à démolir la colonne Vendôme devait commencer par être casseur de pierres », qui fait évidemment référence à un des premiers tableaux scandaleux du peintre en 1850, Les Casseurs de pierre (anciennement conservé à Dresde, Kunsthaus, détruit).
Rétrospectivement, l’œuvre de Courbet est donc regardée à l’aune du vandalisme, il en est une clé d’interprétation, et si le mot n’est apparu à son sujet qu’avec cette ultime crise, il sous-tend toute la littérature et les jugements nombreux produits pendant ces vingt ans inscrits entre deux épisodes révolutionnaires. Cette opinion a été menée avec une telle virulence qu’elle a perduré en France jusqu’au milieu du XXe siècle, pour être plus « oubliée » que contredite.
La question que l’on peut légitimement se poser, c’est dans quelle mesure la construction du personnage de Courbet vandale est le fait de ce travail de sape des littérateurs dès le début de sa carrière, ou bien s’il résulte des actes, des œuvres et de la personnalité même du peintre.
Les déclarations publiques et désespérées de Courbet, au moment de son procès, montrent que cette qualification de vandalisme le touche au plus profond de lui-même. Courbet se voulait aussi constructeur ; si son œuvre s’est imposée avec tant de force dans un cénacle qui ne l’attendait ni le souhaitait, c’est d’une part, parce qu’elle correspondait aux aspirations et au contexte de la société, mais aussi parce qu’elle représentait une régénérescence de la peinture.
L’entrée de Courbet dans la vie artistique parisienne
Gustave Courbet, né en 1819, originaire d’Ornans en Franche-Comté, arrive à Paris dès 1840, bien décidé à percer comme artiste peintre. Il tente d’exposer vingt-quatre tableaux au Salon entre 1841 et 1847 – quasiment tous refusés. Le Salon de 1848 est sans jury, mais les dix envois de Courbet sont noyés dans la masse et n’attirent pas l’attention. Sa toile la plus ambitieuse pour ce Salon n’a rien de réaliste, c’est au contraire une grande composition à teneur romantique : La Nuit classique de Walpurgis. Cinq ans plus tard, sa réputation de peintre réaliste faite, il recouvre ce tableau par une autre composition : Les Lutteurs (1853, Budapest, Szepmuvezeti Museum), pendant des scandaleuses Baigneuses (1853, Montpellier, Musée Fabre). Ces deux œuvres, considérées comme des manifestes du nu réaliste, occultent son ancien style romantique.
Mais en 1848, Courbet ne s’intéresse que de loin en loin aux événements : « je me mêle fort peu de politique comme c’est mon habitude, je trouve rien de plus creux que cela. […] Chacun son affaire je suis peintre et je fais de la peinture ». En juin, en pleines émeutes sanglantes consécutives à la fermeture des ateliers nationaux, il reprend la plume pour rassurer à nouveau ses parents : « je n’ai pas foi dans la guerre au fusil et au canon et que ce n’est pas dans mes principes. Voilà dix ans que je fais la guerre à l’intelligence, je ne serais pas conséquent avec moi-même si j’agissais autrement[2] ». Il contribue cependant au journal révolutionnaire Le Salut Public publié par Charles Baudelaire, Champfleury et Jules Toubin en février 1848, en y dessinant le frontispice, rappel du tableau de la Révolution de 1830, la Barricade de Delacroix (La Liberté guidant le peuple, 1831, Paris, Louvre). Dans le dessin de Courbet, l’allégorie de la Liberté est remplacée par un citoyen habillé d’une blouse d’ouvrier portant un chapeau haut-de-forme, et si Courbet ne porte pas d’arme, il en fait porter à son révolutionnaire.
C’est au cours du Salon de 1849, que Courbet reçoit la reconnaissance officielle avec Une Après-Dîner à Ornans (1849, Lille, musée des Beaux-Arts). Le tableau est acheté par l’État pour le musée des Beaux-Arts de Lille, le peintre est médaillé, ce qui lui permet de ne plus soumettre ses œuvres au jury pour exposer au Salon. L’œuvre de grandes dimensions correspond, à l’aune des critères académiques, à une vulgaire scène de genre apparemment anodine qui marque pourtant un tournant dans les arts. En effet, si l’avant-garde littéraire place le peintre de son côté, la réaction – au sens politique du terme – ne se fait pas attendre. On voit, dans Une Après-Dîner à Ornans, un effet du soulèvement populaire de 1848 entrer dans le sacro-saint Salon académique ; la monumentalité que donne l’artiste à une scène de genre dans laquelle figurent des personnages, entre paysans et bourgeois de province, provoque. Louis Peisse dans La Presse accuse Courbet « d’encanailler l’art[3] » ; avec cette œuvre, « l’art s’est fait peuple », il a perdu « sa supériorité aristocratique » et, s’insurge-t-il : « ce n’est pas le peuple qui s’est élevé à l’art mais l’art qui s’est affaissé au niveau du peuple ».
Le célèbre envoi du Salon de 1851 constitue « la première crise de réception[4] » de l’œuvre de Courbet. Parmi cet envoi, Les Casseurs de pierre et Un Enterrement à Ornans (1849/1850, Paris, musée d’Orsay), sous-titré tableau historique, cristallisent la lecture de la peinture de Courbet comme iconoclasme d’une part, et comme peinture socialiste, d’autre part. Les discussions par voie de presse et dans les salons sont nombreuses et houleuses, la caricature se déchaîne et initie une longue série qui suivra Courbet durant toute sa carrière. Une lettre d’Urbain Cuénot, ami d’enfance du peintre, à Juliette Courbet fait part du mythe qui se fabrique à propos du peintre :
« On fait courir sur lui les bruits les plus contradictoires et les nouvelles les plus amusantes… Il y a des salons où l’on prétend que Courbet était un ouvrier menuisier, un maçon, qui un beau jour, poussé par son génie s’est mis à faire de la peinture et avait fait des chefs d’œuvre du 1er coup. Dans d’autres, on affirme que c’est un terrible socialiste, qu’il est à la tête d’une bande de conspirateurs. Cela se devine bien à sa peinture, cet homme est un sauvage[5]. »
Ces qualificatifs, « ouvrier », « maçon », « socialiste » et «sauvage », relevés par Cuénot sont autant le fait de la critique d’art détractrice que des soutiens de Courbet ; ils sont à l’origine du néologisme « art réaliste » qui désormais qualifiera l’œuvre de Courbet.
Les éléments de la critique qui préfigurent l’image de Courbet-vandale
La critique adressée à l’aspect formel des œuvres de Courbet s’articule toujours avec un jugement porté sur l’artiste. Courbet est perçu immédiatement comme un intrus dans le Salon, venu « saboter » la pérennité établie par les règles académiques, que ce soit de la part de ses détracteurs comme de ses partisans. Ainsi, Théophile Gautier rappelle en 1853 que Courbet est entré au Salon par effraction « puisqu’il a voulu casser les vitres à son départ pour attirer l’attention sur lui en frappant un coup violent[6] ». Champfleury, compagnon de Courbet de la première heure, décrit l’Enterrement comme « un premier coup de canon tiré par le peintre, regardé comme un émeutier dans l’art ».
Les critiques se scandalisent avant
tout des déviances de Courbet par rapport aux règles académiques,
mais en tirent immédiatement des conclusions sur les traits de la
personnalité de l’artiste et sur ses tendances politiques. Ainsi,
on peut établir une liste des principaux reproches faits à
l’artiste en matière de formalisme :
- Facture :
l’outil-même du peintre est considéré comme une arme attentant à
la peinture ; à la noble finesse du pinceau, Courbet substitue
la brutalité du couteau à palette. Il en résulte une facture
épaisse et grossière, un rendu bâclé qui va à l’encontre de la
parfaite finition exigée par la tradition. C’est de cette
utilisation outrancière du couteau, rapidement remplacée dans la
critique par le terme de « truelle », que Courbet est
ainsi associé au maçon, à l’ouvrier, antithèses du peintre des
Beaux-Arts.
- Composition :
autre défaillance remarquée dès l’Enterrement :
le manque total de composition. On s’accorde à dire que les œuvres
de Courbet sont dénuées d’unité picturale et technique, qu’elles
démontrent une disparité de styles et de procédés. En résulte
une a-hiérarchie dans la composition où tous les objets paraissent
égaux et où le détail prime sur l’harmonie générale, propriété
qui place Courbet, dans l’esprit des critiques, au sein d’un
système de pensée anarchiste.
- Métier : l’œuvre
de Courbet est parfois comparée au daguerréotype, un procédé
industriel qui comme ses opérateurs, tente de s’immiscer dans les
Beaux-Arts. L’Enterrement, en reflétant la nature avec indifférence, en n’omettant pas ses
aspects les plus laids, fait l’effet à Etienne-Jean Delécluze
(Exposition des artistes vivants,
1851) « du résultat d’une impression malvenue d’un
daguerréotype[7] ».
Là encore, Courbet est nié en tant que peintre, il est comparable à
une chambre noire qui enregistre le réel sans critère de choix et
appartient donc au monde de l’industrie plus qu’à celui des
arts.
- Laideur :
à ces dérèglements s’ajoute la laideur des figures peintes par
Courbet, si souvent décriée par la critique, contraire du critère
le plus inaltérable des règles académiques qu’est la beauté
idéale. On reproche non seulement à Courbet le rendu disgracieux de
ses figures, mais aussi sa ferme volonté de les enlaidir. Théophile
Gautier, pour qualifier ce peintre qui pratique un « maniérisme
du laid », le surnomme « le Watteau du laid »[8].
Pour la critique, la propension de Courbet à enlaidir devient une
façon de vouloir mettre en avant la partie la plus laide de la
société. Il ne s’agit plus seulement d’une grossièreté
technique, mais bien d’une perversité complaisante du peintre à
vouloir calomnier l’époque à la manière des caricaturistes.
- Formats : en
utilisant les formats utilisés dans le genre le plus élevé, la
peinture historique et religieuse, pour peindre des scènes associées
aux genres les plus bas, nature morte, scène de genre ou paysage,
Courbet est accusé de vouloir se faire remarquer, d’être
prétentieux et arrogant. Mais il est surtout soupçonné de vouloir
renverser la hiérarchie des genres esthétiques rigoureusement
établie par l’Académie, renversement comparable aux renversements
sociaux contemporains. Cette démarche inquiète les critiques, comme
le remarque Pierre Bourdieu dans ses cours au Collège de France sur
Manet, qui, lui aussi, transgressait cette règle des formats : « il
y a une affinité entre toutes les hiérarchies : qui touche à
une hiérarchie, touche à toutes les autres (ou pourrait y
toucher)[9] ».
- Sujets :
au-delà des déviances formelles, ce sont évidemment les sujets
développés par ses peintures qui font de Courbet un iconoclaste au
sein des Beaux-Arts. Pour la critique, les envois au Salon de
1850-1851 font clairement entrer le « peuple en sabot »
au Salon. La
vision des habitants d’Ornans, dans l’Enterrement,
rappelle aussi les dangereux effets de l’élargissement du suffrage
universel qui donne dorénavant autant de pouvoir à cette masse
organisée de province. De la même manière, Les
Casseurs de pierre sont interprétés,
dans le contexte social et politique de l’après-1848, comme une
dénonciation de la misère et des injustices sociales, et donc comme
une peinture socialiste. L’artiste est associé à l’image du
conspirateur socialiste, car sa peinture semble dangereusement
agissante et être à même de prendre le pouvoir. Il fait des
émules, il est l’objet d’un battage verbal, des clients renommés
acquièrent ses œuvres, et il est en lien avec des factions
contestataires.
C’est donc bien la critique qui politise l’œuvre de Courbet, qui en fait un sujet de scandale. Cette interprétation politique provient aussi des soutiens de Courbet et de son réalisme. Ainsi, dans sa critique bienveillante, le fouriériste François Sabatier-Ungher se promeut « artiste théorique » du tableau de Courbet, et développe l’idée capitale du réalisme comme démocratie dans l’art, voyant dans l’Enterrement les disparités individuelles se fondre dans une masse harmonieuse, masse considérée du point de vue pictural mais aussi politique[10]. Le rapprochement de Courbet avec Pierre-Joseph Proudhon, est particulièrement mal vu ; le fait que ce dernier s’intéresse à son art, étaye ses thèses de la destination sociale de l’art dans la société mutualiste et fédéraliste qu’il développe dans ses écrits[11], associe Courbet à une conspiration anarchiste contre le système. Mais l’attitude et les déclarations publiques devaient faire aussi de Courbet un ennemi de la société. À mesure que son art s’éloigne de ses thèmes « paysans et populaires » des débuts, pour rejoindre des thèmes plus en phase avec l’Académie, les déclarations publiques de Courbet se radicalisent pour s’opposer franchement au système des Beaux-Arts et par là-même à l’Empire.
Le personnage public
Au lendemain du Salon de 1850-1851, au moment du coup d’État de Napoléon III, Courbet répond à un journaliste qui l’accuse d’avoir participé à une réunion politique : « Je suis non seulement socialiste mais bien démocrate et républicain, en un mot partisan de toute la révolution, et par dessus tout je suis réaliste[12]. » Cette déclaration est suivie de beaucoup d’autres, qui associent sa position dans l’art et dans la politique, et qui construisent, au fil de sa carrière, la figure de Courbet comme grand opposant.
Niant toute formation et tout maître, il veut mettre à bas le système de l’école des Beaux-Arts et affiche la liberté inconditionnelle de l’artiste vis-à-vis de son œuvre. En 1861, alors que Castagnary l’enjoint à ouvrir un atelier, il affirme ses vues en matière d’enseignement : « Je ne puis enseigner mon art, ni l’art d’une école quelconque, puisque je nie l’enseignement de l’art […] L’art est individuel et n’est pour chaque artiste que le résultat de sa propre inspiration et de ses propres études de la tradition[13]. »
Sa rencontre en 1853 avec l’intendant aux Beaux-Arts, le comte de Nieuwerkerke, qui lui commande une œuvre destinée à l’Exposition universelle de 1855, reçoit une réponse cinglante : Courbet refuse en considérant le gouvernement comme un « simple particulier » et clame qu’il est « son propre gouvernement »[14]. L’organisation de sa propre exposition dans le Pavillon du Réalisme, qu’il fait ériger à côté de l’Exposition universelle officielle de 1855, est une manière radicale de s’affranchir de toute hiérarchie concernant la visibilité de son art. Cette défiance vis-à-vis du gouvernement atteint un point de non retour lorsqu’il refuse la Légion d’honneur, en mai 1870 : « Mes opinions de citoyen s’opposent à ce que j’accepte une distinction qui relève essentiellement de l’ordre monarchique […] L’État est incompétent en art, quand il entreprend de récompenser il usurpe le goût du public[15]. »
Le refus par le jury du Salon de son tableau anticlérical Le Retour de la Conférence (1863, détruit) auquel il fait une grande publicité et son portrait de Proudhon (Pierre-Joseph Proudhon et ses enfants en 1853, 1865, Petit Palais) se veulent de nouvelles provocations qui le placent dans un position claire : anarchiste, anticentralisateur et individualiste. Ce fédéralisme mâtiné de pacifisme, conforté par le succès de ses nombreuses expositions en dehors des frontières, et en particulier en Allemagne, le mène, à la veille du siège prussien de Paris, à la lecture au théâtre de l’Athénée de sa Lettre ouverte à l’armée allemande et aux artistes allemands[16], plaidoyer pacifiste contre les états centralisateurs et autoritaires, dans lequel l’artiste appelle à la destruction des symboles militaires dont la colonne Vendôme.
L’engagement politique de Courbet pendant la Commune
Suite à la capitulation à Sedan, la chute de l’Empire et l’avènement de la Commune, Courbet s’engage dans la vie politique avec un tel enthousiasme qu’il cesse quasiment la peinture, comme si l’activité politique et l’activité artistique ne faisaient qu’une. Il préside la Commission des Arts qui a pour tâche essentielle d’assurer la protection des arts pendant ces temps de guerre. Il poursuit cette mission en tant que président de la Fédération des Artistes sous la Commune et il interviendra en particulier lors de la destruction symbolique de la maison de Thiers, tenu responsable de la répression, décidée par le Comité de Salut public, mais contre laquelle Courbet s’était prononcé. Cette affaire délicate, qui sera un des chefs d’accusation de vandalisme lors de son procès, le montre tentant de sauver des pièces d’art rassemblées par Thiers pour les faire entrer au Louvre. Dans une lettre à Jules Simon, ministre de l’Instruction publique, alors qu’il est emprisonné à Versailles, il fait état de son sentiment d’impuissance face à une situation qu’il décrit comme un pillage :
« Toutes ces violences nous déplaisaient fortement, Vallès et moi (pour mon compte, ça me rappelait les Prussiens qui avaient arrangé mon atelier d’Ornans dans le même genre). Mais qu’y a t-il à faire ? Comment s’opposer aux vengeances populaires, on n’y peut gagner que la mort à la chambre comme dans cet endroit. Nous étions les plus faibles pour lutter contre ces parti-pris. Nous fumes désagréablement impressionnés[17]. »
Courbet est partagé entre enthousiasme, en animant très activement la Fédération des Artistes avec des propositions qu’il a toujours soutenues de ses vœux, comme un projet de réforme de l’enseignement de l’art, et atermoiements, en tant que pacifiste convaincu, devant la violence des combats et des actes de la Commune. Pour en venir à l’affaire de la colonne Vendôme, la proposition de la « déboulonner » est faite par Courbet dès septembre 1870 pour des raisons clairement symboliques : il veut mettre à bas ce « monument dénué de toute valeur artistique », objet fétiche cristallisant la haine du bonapartisme et de la guerre. En se polarisant autant sur ce monument, dont le maintien au cours du siècle a fait souvent polémique, Courbet fait montre d’une intelligence des révolutions qui nécessitent la destruction d’objets symboliques forts, représentant l’Ancien Régime, pour juguler un vandalisme général. Il réitère cette proposition dans sa fameuse lettre aux Allemands, en proposant de remplacer la colonne napoléonienne par un monument dédié à la révolution, à la paix et à la fédération franco-allemande : il suggère aux Allemands de faire fondre leurs canons Krupp avec les canons français, de placer « le dernier canon la gueule en l’air, coiffé d’un bonnet phrygien et ce monument colossal que nous érigerons ensemble sur la place Vendôme sera votre colonne à vous et à nous, la colonne des peuples, la colonne de l’Allemagne et de la France comme jamais fédérés[18] ». La proposition de Courbet n’est à ce moment-là pas entendue, et la décision de la Commune de démolir la colonne sera prise sans lui. Mais il lui semble que la disparition de ce symbole de l’Empire est une condition nécessaire à la régénérescence de la société et à la naissance d’une république égalitaire.
Si l’on établit le lien entre l’activité politique de Courbet et son activité artistique, les provocations picturales de Courbet peuvent être interprétées comme des tentatives de rénovation d’un milieu artistique perdu dans un éclectisme fin de siècle. Sa propension à vouloir faire table rase de la tradition pour « éviter d’inutiles compilations », son insistance sur la nécessité d’appliquer ses facultés personnelles aux idées et aux choses de l’époque « dans laquelle on vit » sont le signe d’une modernité inédite, difficile à formuler dans un système autoritaire. L’attitude radicale de Courbet sera retenue par nombre de peintres à sa suite, jusqu’aux avant-gardes du début du XXe siècle. Manet et Cézanne, ses immédiats successeurs, deux éternels refusés du Salon, trouvent chez Courbet une référence pour régénérer leur peinture et affirmer leur indépendance. Manet n’est pas seulement stimulé par la peinture de son aîné, il adopte aussi les stratégies d’exposition qu’a inaugurées ce dernier ; il érige un pavillon pour y faire une exposition personnelle lors de l’Exposition universelle de 1867 et affronter directement le public. Samuel Rodary dans son article Courbet manebit,[19] entrevoit dans le tableau de Manet de 1873, Le Bon Bock (Philadelphia Museum of Art), un hommage à Courbet, et par là, à ses prises de positions politiques. À l’époque où l’amnistie des communards n’est pas d’actualité, où Courbet est en prise avec la justice et où il est définitivement écarté par le jury du Salon, Manet fait le portrait du graveur Bellot en buveur de bière, la pipe à la bouche. Le tableau qui reçut un accueil très favorable du public était compris comme « un clin d’œil aux frères des provinces perdues ». Cependant, la figure et ses attributs font irrésistiblement penser à Courbet.
Au même moment, Pissarro fait le portrait de son compagnon de recherches picturales du moment, Cézanne (Portrait de Cézanne, 1874, Collection von Hirsch, Bâle). Ce portrait, analysé par T.J. Clark[20], donne, à travers la description « du négligé de l’artiste », l’image de la souveraineté créatrice de l’artiste de plein-air. Le modèle s’exprime aussi à travers la citation de trois images en arrière-plan qui créent un réseau complexe de références : un paysage de Pissarro, Rue de Gisors, la maison Gallien de 1873, une « une » du journal satirique « L’Eclipse » avec une caricature de Gill figurant Thiers qui brandit un bébé-sac d’argent que vient d’enfanter une allégorie de la République française, symbole des réparations de guerre que la France doit verser à l’Allemagne, et enfin une caricature de Courbet par Léonce Petit pour Le Hanneton de 1862 qui le montre palette dans une main et chope de bière dans l’autre comme portant un toast à Cézanne. L’indépendance du peintre est donc décrite sur plusieurs niveaux, à la fois politique et artistique. Thiers tourné en dérision affiche la contestation du peintre par rapport à l’État, le paysage « impressionniste » inscrit les intentions artistiques de Cézanne dans un réalisme prosaïque loin des canons du paysage académique. Enfin, synthèse des deux dimensions, politique et esthétique, la caricature de Courbet agit comme une référence insistante et consciente du peintre Cézanne. À une époque où Courbet est accablé par le gouvernement après son implication dans la Commune de Paris, afficher si clairement son effigie comme une référence et même un compagnonnage, c’est affirmer à la fois l’influence de son art toujours controversé et de ses positions politiques radicales et anti-bourgeoises.
L’épisode de la Commune, avec son lot de vexation et de sanctions vis-à-vis du peintre, contraint à l’exil, achève de noircir la réputation de Courbet. Les écrits et caricatures prenant le peintre à charge redoublent de violence, même de la part de ses premiers partisans. Ainsi, Francis Wey, littérateur franc-comtois qui suivit les débuts de Courbet, dont il fut intime, et avec qui il partageait dans les années 1850 les idées socialistes, lâche le peintre au fur et à mesure de son entrée en politique. Ses écrits sur Courbet sont un exemple édifiant de la lecture rétrospective influencée par la participation du peintre à la Commune. Courbet, aux incontestables facultés de peintre, y est décrit sombrant dans l’iconoclasme et en proie à l’alcoolisme dans les brasseries allemandes parisiennes, aigri par une carrière qu’il aurait souhaitée voir reconnue par l’Empire. L’accusation de trahison à sa patrie par son attachement à l’Allemagne et à sa fameuse lettre aux Allemands est récurrente dans l’accusation de vandalisme de Courbet, comme le rappelle cet extrait :
« les malandrins prussiens, espions pour la plupart avaient enguirlandé ce nigaud, incapable de se défier de qui le flagornait, et plus de 8 ans avant nos désastres de 1870, il prêchait déjà l’abolition des armées et le déboulonnement de la colonne Vendôme ».
Dans sa chronique du siège de Paris (1870-1871), il décrit Courbet alors président de la Commission des Arts au Louvre vidé de ses collections : « C’était bien là le musée de France tel qu’il le rêvait dans ce qu’il nomme son réalisme, lorsqu’il émettait le vœu en 1848, que m’ssieu Raphaël, m’ssieu Titien, m’ssieu Michel Ange, ainsi que Rubens “un corrompu” fussent brûlés dans l’intérêt de l’art, afin de l’arracher des routines[21]. »
Ce type d’assertion sur Courbet pourrait sembler propre à cette époque qui venait de connaître une défaite cuisante face aux Prussiens. Cependant, si on se rapporte au chapitre « la responsabilité de Courbet » dans L’histoire du vandalisme de Louis Réau[22], éditée pour la première fois en 1958 et rééditée en 1994, puis en 2013, le même sentiment prévaut sous la plume de l’historien. Celui-ci, « en tout impartialité » s’attache à prouver que non seulement Courbet est responsable, anti-bonapartiste, mais pire encore, pro-allemand. La conclusion du chapitre est sans appel :
« Il est donc établi que Courbet a été l’un des principaux instigateurs de cet acte de vandalisme et que, dans son cerveau fumeux d’orateur de brasserie, “déboulonner” avait bien le sens de détruire et non de conserver. Qu’il ait été un “collaborateur”, dans le sens péjoratif qu’a reçu ce mot pendant l’occupation allemande de la Seconde Guerre mondiale, c’est ce qu’il paraît difficile de contester. »
La République qui a suivi la Commune accuse définitivement l’artiste de la démolition de la colonne Vendôme le 24 juin 1874, et le somme de rembourser son rétablissement. Comme on le sait, l’artiste meurt en exil en Suisse en 1877, avant de payer la première traite. Depuis, il n’a pas été amnistié par la République. Son destin patrimonial n’a pu se mettre en place qu’au prix d’un travail de dépolitisation de l’œuvre et du peintre, de la part des historiens français. Il faut attendre les années 1960 et les études d’universitaires anglo-saxons et allemands pour que la portée politique de Courbet soit reconsidérée comme une part majeure de sa démarche artistique. Aujourd’hui, comme l’a souligné Laurence Des Cars, lors du colloque « Transfert de Courbet » à Besançon en septembre 2011, le chapitre politique semble à nouveau être clos en France depuis l’apparition de L’Origine du Monde aux yeux du public en 1995 au musée d’Orsay. « Le tableau est devenu Courbet », affirme-t-elle. Cet avènement est un nouveau tournant dans la perception de l’œuvre et du peintre qui, une fois de plus, occulte leur part politique.
Cécile
Petitet
Centre Georges Chevrier,
UMR 7366 CNRS-uB
(sous
la direction de Bertrand Tillier)
[1] Bertrand Tillier, La Commune de Paris, une révolution sans image ? Politique et représentations dans la France républicaine (1871-1914), Seyssel, Champ Vallon, coll. « Epoques », 2004.
Pour citer cet article :
Cécile Petitet, « Courbet vandale et anti-vandale », Revue TRANSVERSALES du Centre Georges Chevrier - 1 - mis en ligne le 12 mars 2014.
URL : http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/publications/transversales/Vandales_vandalismes/C_Petitet.html
Auteur : Cécile Petitet
Droits : © Tous droits réservés - Ce texte ne doit pas être reproduit (sauf pour usage strictement privé), traduit ou diffusé. Le principe de la courte citation doit être respecté.