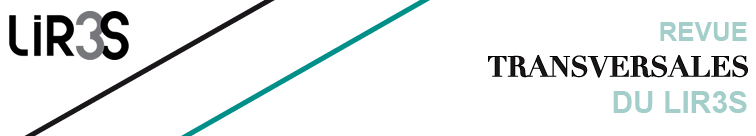
Le pouvoir du corps et le phénomène
de l’orientation.
Lecture des « Leçons sur la corporéité »
de Jan Patočka
Dans le cours professé en 1968 à l’Université « Charles » de Prague et édité sous le titre « Leçons sur la corporéité[1] », Jan Patočka engage une réflexion sur les perspectives que la phénoménologie ouvre à une pensée du corps propre. À l’encontre des approches traditionnelles, qui « ont compris le corps humain d’une façon telle, que le corps comme nôtre, comme ce qu’on vit et comme ce qui s’expérimente lui-même, n’a pas pu devenir thème pour la réflexion philosophique[2] », Patočka se propose de recueillir toute la charge de sens que recèle l’expérience du corps comme mien. L’exigence fondamentale qui se dessine ainsi, à savoir de s’installer dans une dimension qui est celle de l’épreuve du corps, d’assumer donc une perspective en première personne, s’avère également un levier décisif pour mettre à nu les impasses d’une tradition qui a envisagé le corps propre dans une optique impropre (ou bien impersonnelle, ou bien relevant de la troisième personne), mais aussi pour indiquer les insuffisances du traitement de ce problème au sein de la phénoménologie historique, chez Husserl et Heidegger avant tout. Pourtant, expliciter dans toute son ampleur l’expérience que nous faisons du corps, déployer le thème du corps propre dans toute sa richesse, est une tâche qui ne relève pas d’une recherche régionale, mais apparaît au contraire comme une voie privilégiée pour prendre en vue le tout de l’existence humaine. C’est précisément pour avoir donné une portée uniquement locale à la question du corps, c’est pour avoir pensé le corps et non pas selon le corps, que les analyses sur la corporéité orchestrées par Husserl dans les Ideen II semble à Patočka insuffisantes. Ainsi, il note que :
« Husserl n’a pas atteint la question radicale – qu’est-ce que l’humain ? Certes, le chemin de la subjectivité transcendantale vers l’humanité passe par la corporéité. Mais on peut se demander si, dans le chapitre où il traite de la corporéité, Husserl n’est pas en quelque sorte un Colombe à revers. En effet, il semble avoir pensé qu’il a découvert une nouvelle île dans l’océan des significations humaines. Il se peut toutefois qu’il n’ait fait rien d’autre que de découvrir une voie nouvelle vers le vieux continent, celui du tout[3]. »
Le problème du corps se voit donc investir, dans la pensée de Patočka, de la fonction de mettre au jour le tout de l’existence humaine, car « depuis la perception jusqu’à l’activité la plus spirituelle de l’artiste ou à l’attitude méditative du mystique, le faire passe toujours par un mouvement – et le mouvement au milieu des choses est, bien sûr, toujours corporel[4] ». Pour circonscrire l’espace que cette thèse ouvre, il faut faire apparaître ce qui la rend possible, à la fois négativement que positivement. Ce qu’une telle conception rejette, c’est une approche qui réduit le corps à un être de passivité, à une masse qui pèse sur la spontanéité de l’esprit, en rétrécissant son champ d’action. Ressaisi comme mouvement, voire comme un « pouvoir se mouvoir », le corps apparaît au contraire comme ce qui prolonge le « faire » propre au moi, jusqu’à le localiser parmi les choses, sans pour autant le réduire à l’une d’entre elles. Mais pour qu’une telle articulation puisse se produire, l’existence doit à son tour être déterminée, dans ce qu’elle a de plus propre – à savoir, en tant qu’elle est un « rapport à soi » – également dans une optique dynamique, plus précisément comme un « faire »[5]. C’est à la seule condition de comprendre et l’existence et le corps à partir du mouvement, qu’on pourra rendre compte non seulement de leur articulation, mais également de la manière selon laquelle la pensée du corps informe le tout de l’existence.
Soustraire la question de la corporéité à l’emprise de la tradition impose alors de l’envisager à partir de son pouvoir. Mais faire apparaître le pouvoir propre au corps requière à son tour la prise en compte de trois exigences : le corps doit être abordé dans une perspective personnelle – la question « que peut un corps ? » se traduit aussitôt en « que peut mon corps ? ». Ensuite, la question du corps ne doit pas être exilée dans une recherche régionale, mais au contraire articulée à celle de l’existence – la question « que peut un corps ? » se précise en « que peut le corps d’un étant qui existe sur un mode personnel ? », voire en « que peut le corps d’une existence ? ». Enfin, le corps doit être envisagé selon une perspective dynamique : le pouvoir du corps sera fondamentalement déterminé comme un pouvoir se mouvoir – la question « que peut un corps ? » se mue en « quels types de mouvements peut réaliser un corps ? ».
Pour entériner la légitimité de toutes ces exigences, pour faire apparaître qu’il ne s’agit pas de réquisits spéculatifs mais bien de nécessités phénoménales, il convient de montrer comment leur intervention est à même d’éclairer un phénomène précis. Il s’agira de faire ressortir le pouvoir du corps à même un phénomène qui engage le corps tel qu’il est vécu en première personne, dans sa dimension dynamique et dans son rapport indissoluble à l’existence. Un des phénomènes qui réunit ces aspects est celui de l’orientation. L’orientation n’est pensable que pour un étant qui i) peut être envisagé selon une structure personnelle, comme un je, un tu ou un il ; un ça ne s’oriente pas ; ii) est corporel – un pur esprit ne peut pas être quelque part, et par conséquent, parler de l’orientation dans son cas est dépourvu de sens ; enfin iii) peut se mouvoir : un être immobile pourrait éventuellement déterminer sa position dans l’espace, mais en aucun cas s’orienter. En ce sens l’orientation est le préalable du mouvement.
Selon une définition classique, « s’orienter signifie au sens propre du mot : à partir d’une région donnée du ciel (nous divisons l’horizon en quatre régions) trouver les autres, notamment le levant[6] ». Pourtant, comme l’indique Patočka, avant d’être une opération à travers laquelle nous fixons des repères, « la fonction première [de l’orientation] est d’indiquer que nous sommes quelque part et où nous sommes[7] ». Mais si nous voulons savoir « où nous sommes », c’est que le lieu où nous nous trouvons ne nous est pas indifférent. Le « où » recèle une différence qui nous préoccupe. Notre mode d’être, en tant que nous cherchons à déterminer où nous sommes, est donc celui de la non indifférence par rapport à soi, de l’intéressement à soi. Patočka reprend à cet égard la caractérisation heideggérienne de l’existence, qui « dans son être, se rapporte à cette être », en faisant apparaître le rapport à soi comme ce qui motive toute tentative de déterminer le « où ». Si une question du type « où suis-je ? » ne peut surgir que pour un étant qui se préoccupe de son être, elle ne peut s’imposer comme question que pour un étant qui n’est pas transparent à soi, qui peut ne pas savoir où il est. Un étant qui se posséderait de part en part, sans aucune zone d’ombre ou de mystère, pourrait éventuellement être quelque part, mais il ne chercherait pas à déterminer ce lieu, il ne se demanderait pas où il est. Pouvoir s’orienter, vouloir s’orienter, implique alors que la non indifférence à soi se trouve liée à une quête de soi.
Mais, poursuit Patočka, « je ne peux être quelque part en tant que moi purement spirituel. Dans le cas d’un moi purement spirituel, le se-rapporter-à-soi pourrait avoir la signification d’une relation réflexive. Mais on ne peut guère dire d’un moi purement spirituel où il est, ni en général qu’il est quelque part[8] ». La non transparence à soi et l’intéressement à soi ne suffisent donc pas pour rendre compte du statut de celui qui cherche à s’orienter. Cet étant doit être ancré dans le monde par son corps, il doit être fondamentalement corporel. Comme le précise Patočka dans la suite du texte « ce qui est à proprement parler dans l’espace, c’est le corps[9] ». Dire que je suis quelque part c’est donc affirmer que j’ai un corps qui résiste à toute tentative de survol, qui ne se résout pas dans les opérations d’une conscience constituante et par qui je suis placé, dans un rapport de continuité avec les autres étants du monde. Si l’orientation renvoyait en premier lieu à l’être-auprès-de-soi qui nous caractérise, elle s’avère maintenant indissociable d’une communauté ontologique avec le reste de l’étant. Si je suis quelque part, cela ne peut être que dans le monde, au sein de l’étant. Autrement dit, je m’oriente dans le monde parce que j’en fais partie.
Néanmoins, cette nécessaire appartenance ne doit pas compromettre la distinction : une distance absolue et une continuité radicale débouchent toutes les deux sur l’impossibilité de rendre compte de l’orientation. La détermination d’un « où » est le fait d’un étant intéressé à son être et ancré dans le monde qui, sans s’extraire du monde, pose sa différence par rapport au « reste du monde », se sépare de lui. Et Patočka de poursuivre :
« la fonction d’orientation présuppose ainsi deux composantes : d’une part, il doit y avoir une conscience de soi préréflexive sous la forme d’un “je fais”, “je peux”, “je me trouve”, c'est-à-dire la conscience de soi en tant que force et faculté d’apercevoir le reste du monde ; d’autre part le “reste du monde” doit être le milieu dans lequel nous nous localisons nous-mêmes[10] ».
La localisation affirme certes une appartenance au monde, mais elle introduit simultanément un partage, elle détache le lieu où je suis du reste du monde. Ce qui apparaît à travers la question « où suis-je ? » c’est une structuration du monde, la différenciation entre un centre que j’occupe et une périphérie plus ou moins éloignée. Ou, avec les mots de Patočka : « le monde se découvre à moi dans un réseau dont je suis le centre[11] ». En déterminant où je suis, je fais plus que de me localiser parmi les choses, je fais sortir le monde de son indifférence, je le fais apparaître comme champ organisé autour d’un « point zéro ».
Pourtant la question « où suis-je ? » ne recevrait pas une réponse satisfaisante si on se contentait de dire que j’occupe un des centres du monde, que je suis au milieu de l’étant. C’est qu’elle présuppose non seulement l’être-situé dans le monde et la distinction en son sein entre un centre et une périphérie, mais également un ordonnancement plus complexe, une dénivellation au sein de l’étant, qui donne une concrétude supplémentaire à ma situation. À chaque fois que la question « où suis-je ? » se trouve posée, elle me découvre comme pris dans une situation, qui appelle de moi une forme déterminée d’agir correspondant. Ainsi, « l’homme a besoin de savoir où il est […] pour se reconnaître dans le lieu où il demeure, pour pouvoir travailler, remplir ses devoirs les plus essentiels, s’acquitter des rôles sociaux eux aussi toujours spatialement articulés et liés à des activités, c'est-à-dire à des mouvements[12] ». Comprise dans toute sa concrétude, la question « où suis-je ? » renvoie donc à la question « que dois-je faire ? », « comment dois-je répondre à l’appel qui me vient de ce lieu du monde ? ». Envisagé à partir de la question de ma localisation en son sein, le monde est davantage qu’une structure duelle centre-périphérie, il est un système de lieux qui renvoie à mon « faire ». Ceci informe en retour le type de rapport que je suis : la manière dont je me rapporte à moi-même n’est pas d’ordre réflexif, car la réflexion est incapable d’intégrer toute la richesse de sens que mon faire contient, qui s’avère aussitôt « la forme originaire de clarté » que je suis à même de déployer.
Ici quelques précisions s’imposent. Le faire ne se traduit pas en un premier sens par une modification de notre environnement vital, par une action exercée sur les choses, il n’est pas identique à l’action d’un technicien, à la poièsis, mais désigne avant tout un mode de compréhension, une forme de clarté dans laquelle les choses se présentent. Toute intervention dans le monde présuppose le dévoilement des choses à partir d’une structure des renvois, de leur « en vue de quoi ». Le maniement a pour condition la découverte de la chose comme maniable : je ne peux écrire que pour autant que je découvre dans mon espace de proximité des choses à même de laisser des traces durables sur une surface, découverte qui est corrélative d’une clarté que je gagne sur ce qu’elles sont. Ici la position de Patočka se rapproche fortement de celle formulée par Heidegger dans Etre et temps. Il est donc utile d’en marquer, même brièvement, les différences.
À l’encontre d’une tradition qui déterminait le rapport à soi dans le registre de la réflexion, le situant ainsi au niveau de l’intériorité, Heidegger affirme le caractère « ekstatique » du Dasein, le fait qu’il est – selon un mot cité souvent par Patočka – toujours en chemin, immer unterwegs, et reconnaît la nécessité pour tout rapport à soi de passer par le monde, et d’intégrer par conséquent une dimension d’agir. Si Patočka accorde à Heidegger, selon la phrase citée plus haut, que « la praxis est la forme originelle de clarté », il lui reproche simultanément de n’avoir pas suivi jusqu’au bout les implications de cette position, notamment au sujet du corps. En effet, « Heidegger ne prend jamais en considération le fait que la praxis originelle doit être par principe l'activité d'un sujet corporel, que la corporéité doit donc avoir un statut ontologique qui ne peut être identique à l'occurrence du corps comme présent ici et maintenant. L'éclaircissement qui caractérise l'existence est éclaircissement d'un étant corporel[13] ». Si le faire, avant d’être un maniement, est un mode de dévoilement – je ne peux utiliser une craie ou un stylo que dès lors qu’ils apparaissent comme quelque chose à portée de main (Zuhandenes), avec quoi je peux écrire – il n’en demeure pas moins que le Zuhandenes, l’à-portée-de-main, qui est un caractère d’être selon lequel les choses se dévoilent, ne peut être compris que par un étant qui a une main (Hand), qui non seulement peut comprendre un outil dans son ustensilité, mais peut en faire usage. La constitution particulière de mon corps, le fait qu’il est fait d’une façon telle qu’il peut manier des choses a une incidence sur la manière dont les choses se dévoilent. C’est le sens, nous semble-t-il, du passage qu’on vient de citer, « l’éclaircissement de l’existence est l’éclaircissement d’un étant corporel » : sans la référence un corps, et plus particulièrement à une main, la disponibilité pour le maniement (la Zuhandenheit) serait non seulement impensable, mais tout simplement impossible. Que le corps possède une signification ontologique signifie rien de plus qu’il est investi d’un pouvoir de dévoilement. Si Heidegger refuse d’accorder au corps cette fonction, c’est pour l’avoir préalablement assimilé à un « un substrat substantiel », dont l’introduction au cœur de l’existence compromettrait le statut de celle-ci. Or c’est précisément cette perspective qui est la cible des critiques de Patočka, qui écrit à cet égard que :
« Le corps relève du domaine des possibilités propres […]. Le corps est existentialement l'ensemble des possibilités que nous ne choisissons pas, mais dans lesquelles nous nous insérons, des possibilités pour lesquelles nous ne sommes pas libres, mais que nous devons être. Cela ne signifie pas qu'elles n'aient pas le caractère de l'existence, c'est-à-dire de ce qui m'est imposé dans son unicité et que je dois assumer et réaliser. Mais c'est seulement sur leur fondement que sont ouvertes les possibilités “libres”[14]. »
Saisi depuis la possibilité qu’il incarne, le corps apparaît comme ce que je dois prendre en charge : ce qui apparaît d’abord comme des limitations de fait – que j’ai deux mains et cinq doigts, que je peux manier les choses, que mon champ visuel est toujours structuré selon une figure et un fond, que je dois me nourrir et boire – s’avèrent en effet des possibilités de mon être pour autant que je les assume. Le corps est certes à définir comme un pouvoir sur les choses – la main peut manier un outil – mais il s’agit d’une possibilité qui ne résulte pas d’un choix radical quant à notre propre manière d’être, il est donc à strictement parler « l’ensemble de possibilité que nous ne choisissons pas ». L’assomption de ce pouvoir non libre qu’est le corps, est la condition indispensable pour le déploiement des possibilités libres. Les possibilités libres, qui désignent la manière patočkienne de reprendre le thématique heideggérienne de l’authenticité, la quête d’une compréhension de soi à partir de soi, doivent « prendre [leur] source dans un organisme qui toujours déjà sait faire, qui toujours déjà obéit d’une certain manière, qui est à même de réaliser un élan vers les choses[15] ». Le corps et l’existence se trouvent ainsi déterminés dans ce qu’elles ont de plus propre à partir du pouvoir spécifique qu’ils mettent en jeu : un pouvoir qui me traverse et que je dois assumer, une possibilité libre mais toujours référée à ce socle vital qu’est l’organisme.
Cela nous permet de préciser davantage le sens de la critique que Patočka adresse à Heidegger : ne pas avoir pris en compte le corps dans son analyse de l’existence humaine, ne pas lui avoir conféré un statut existential, ne relève pas d’une omission régionale, sans effet sur le projet global de l’ontologie fondamentale, mais a pour conséquence un appauvrissement du concept de possible que celle-ci met en jeu, et qui n’est pas capable d’intégrer les « possibilités que nous ne choisissons pas » et qu’il nous faut tout simplement assumer. L’effet dernier de cette optique est donc d’établir une équivalence entre possibilité et liberté, et de refuser d’accorder à une possibilité que je ne projette pas, mais que je dois seulement prendre en charge, le plein statut de pouvoir. Une citation de Patočka que nous donnons in extenso est éclairante à cet égard :
« Heidegger déduit le concept de situation de celui d’existence. L’existence est essentiellement être dans le monde, c'est-à-dire être quelque part ; le rapport à soi contient déjà quelque chose comme l’auto-localisation. Heidegger interprète ce rapport de l’existence au monde comme chute dans le monde. […] Ici notre conception diffère radicalement. La relation des humains au monde n’est pas négative, mais plutôt positive, elle n’est pas une perte de soi, mais plutôt la condition de possibilité de se trouver soi-même. Ce qui est propre à l’analyse heideggérienne est la place restreinte accordée aux phénomènes concrets, tels que la corporéité. Toute l’analyse de Heidegger se situe dans la dimension de la lutte morale des humains pour leur autonomie[16]. »
Quels sont les répercussions de cette polémique sur le phénomène que nous avons pris comme guide, à savoir celui de l’orientation ? Cherchant à décrire les conditions selon lesquelles ce phénomène est à même de recevoir une clarification, Patočka est amené à établir la positivité qui est inhérente à l’appartenance au monde : si Heidegger souligne bien que le monde, comme totalité des renvois, est indispensable à la compréhension de soi du Dasein, il fait de la localisation parmi les choses un phénomène privatif, que le projet de l’authenticité vise à battre en brèche. Je ne peux me découvrir parmi les choses, que pour autant que je prenne le modèle de la chose comme déterminant pour ma compréhension de moi-même, ce qui équivaut pour Heidegger à une fuite devant ma possibilité fondamentale, celle de me comprendre à partir de moi-même. Si le phénomène de l’orientation peut être décrit dans le cadre théorique de l’ontologie fondamentale, il sera ou bien appauvri ou bien il recevra un sens purement métaphorique.
Heidegger souligne certes dans ses analyses de l’ustensilité que tout outil (Zeug) renvoie à une région (Gegend), où il a sa place et que savoir manier les outils implique, indissociablement, pouvoir discerner le système de renvois qui les articule. Mais plusieurs limitations interviennent dans ce cadre : ce n’est pas le Dasein comme tel qui s’oriente, mais seulement en tant qu’il est un manipulans, ou plus précisément, suivant notre exemple, en tant que menuisier. Il n’est pas non plus anodin que la région que Heidegger prend pour modèle, celle qui fournit le sol phénoménal pour l’interprétation de l’orientation, soit liée à un type particulier d’activité, à savoir le travail[17]. Ceci représente pour Patočka une limitation irrémédiable de l’analyse heideggérienne :
Avec Sein und Zeit nous saisissons bien où se placent les « choses » dont on a souci à la maison et sur les lieux de travail, mais nous n’en apprenons pas pour autant d’où tire son origine l’opposition entre « à la maison » et « à l’atelier » ou au « travail ». Il y a des raisons de se demander si, ontologiquement parlant, le foyer familial et l’atelier ou le bureau se trouvent à la même page. Que le premier soit avant tout le lieu de la sollicitude envers des êtres humains, alors que le second est celui de la manipulation des choses, des pragmata, ce fait n’a-t-il pas un fondement assez profond pour exiger d’être pris en considération[18] ?
Faire apparaître le privilège que Heidegger accorde au travail conduit à reconnaître le caractère régional des pragmata, et donc aussi de la compréhension qui en est l’origine : elle ne peut pas s’appliquer aux registre de la sollicitude mais uniquement à celui de la manipulation, elle ne peut pas être prise comme modèle pour saisir le tout de l’existence humaine.
En outre, on pourrait remarquer que, pour Heidegger, ce n’est pas dans le monde comme tel que l’orientation ait lieu, mais en dernier lieu, dans la région d’une certaine activité (qu’il soit ou non légitime de la prendre pour modèle de l’ensemble). Certes, le monde peut être déterminé comme la région de toutes les régions. Mais dès lors qu’on transpose le modèle régional de l’orientation à la totalité, il perd la neutralité qu’il possédait auparavant. Trouver ses repères dans le monde, c’est finalement se comprendre soi-même à partir du monde, c’est donc accomplir une chute dans le monde. Heidegger ménage certes une place pour une orientation plus radicale, qui m’engage en tant que Dasein en me rapportant au zénith de ma possibilité fondamentale – unique, certaine et indépassable, celle de ne plus être Dasein – mais envisager l’orientation selon cette dimension reste une pure métaphore. Pour rester à ce niveau métaphorique, on pourrait ajouter que si le devancement (Vorlaufen) est à même de me donner le nord de mon existence, il ne me permet pas d’en extraire les autres points cardinaux, et me laisse ainsi suspendu.
Les impasses que nous avons repérées dans la tentative de transcrire le phénomène de l’orientation dans les coordonnées de l’ontologie fondamentale nous permettent de distinguer en creux les conditions nécessaires pour son élucidation. L’examen critique de Heidegger nous a conduit à exiger : i) que la localisation dans le monde reçoive une signification positive ; ii) que le corps ne soit pas interprété comme un substrat déjà donné, mais comme un pouvoir qu’il nous faut assumer. Tenterons d’éclairer davantage ces points.
Nous l’avons indiqué, dire « où je suis », c’est immédiatement opérer une séparation entre le lieu où je me trouve et le reste du monde. Pourtant, comme ma manière d’habiter le monde n’est pas celle d’un simple séjour – comme je ne suis pas semblable à un touriste dont la seule activité est de voir le monde –, mais a le caractère d’un faire, celui-ci consomme une perte dans les choses, à savoir la perte de ma place centrale : « Je me suis toujours déjà oublié moi-même en tant qu’apparition et centre, je me suis en quelque sorte excédé moi-même dès lors que je vis le monde et j’en fais l’expérience[19]. » En tant que faire, je ne suis pas auprès de moi-même, mais là-bas auprès de la chose que je suis en train de manier et qui m’absorbe, ou dans l’action dans laquelle je m’investis. Répondre à la question « où suis-je ? » revient ici à dire ce que je suis en train de faire, ce qui renvoie à son tour au contexte qui définit mon agir. Où résident les différences entre une telle description est celles proposées par Heidegger ? Elles sont à trouver, il nous semble, dans une caractérisation dynamique de l’existence : celle-ci ne s’épuise pas dans la compréhension de soi qu’elle met en jeu, mais elle s’accomplit comme mouvement, plus précisément comme un mouvement qui possède une courbure : c’est là que réside la positivité de l’insertion dans le monde. Ainsi, Patočka écrit :
« l’élan qui nous porte vers le monde, notre ouverture au monde, conduit ainsi à de nouvelles formations matérielles, à de nouvelles objectités qui à leur tour rendent possible une guise nouvelle de notre propre vie, un nouvel approfondissement de nous-mêmes. En nous jetant dans les choses, en nous y ancrant, en appréhendant et en créant de nouvelles synthèses objectives, nous nous appréhendons, nous nous ouvrons et nous nous modifions nous-mêmes. Telle est la courbe du mouvement de notre propre existence[20] ».
La raison décisive pour laquelle Patočka attribue à la localisation dans le monde une signification positive tient à son caractère dynamique : avant de désigner le lieu que j’occupe, la localisation désigne le mouvement par lequel je l’investis : plutôt qu’à la maison, la localisation renvoie à ma manière de l’habiter. Une telle solution permet d’écarter deux écueils contraires, mais secrètement solidaires. Elle nous permet d’abord de rejeter une manière de restituer l’orientation qui la réduit à une forme de compréhension : s’orienter dans le monde ce n’est pas simplement reconnaître des systèmes de renvois, mais accomplir un mouvement vers eux, se ménager une place parmi eux. Pourtant il s’agit bien d’une localisation, d’un mouvement par lequel un lieu est investi, et non pas d’une simple fixation : si je devenais une simple présence, une chose parmi les choses, je n’aurais aucune possibilité de m’en détacher, et la possibilité même de l’orientation serait compromise. L’aspect dynamique de la localisation permet précisément d’outrepasser ces obstacles : un être mobile, plus précisément un être qui se meut lui-même, qui peut se mouvoir, est dans le monde, sans que son appartenance ait le caractère d’une simple présence. Parce qu’il n’est pas fixé, il assume dans le monde une distance par rapport aux étants simplement présents, sans que cela donne lieu à une position de survol. Ceci conduit alors à reconnaître que :
« chacun de nos “mouvements physiques” fait en réalité partie de ce mouvement total, omni-englobant, que nous sommes – car nos mouvements sont essentiellement des mouvements du “corps subjectif” ou, du moins, dont le sens porte la marque indélébile de ce corps. De même, toute donnée s'intègre à une “orientation” qui, étant d'essence corporelle, peut être désignée comme mouvement[21] ».
Pour éclairer davantage le statut du mouvement de localisation, Patočka fait référence à un concept qui atteste le poids de la lecture de Maine de Biran, celui de « force voyante ». Ainsi, il écrit reprenant une formule biranienne :
« Le moi n’est pas quelque chose qui donne des ordres ; il est lui-même d’ores et déjà mouvement. Peut-être le mouvement originaire n’est-il pas le changement de lieu des choses, mais bien plutôt cet élan dynamique, qui fait que l’existence est toujours déjà hors de soi, qu’elle s’est excédée en direction des choses, qu’elle est devenue une force voyante. Le mouvement originaire ne serait pas alors dans l’espace, mais vers l’espace, et le mouvement du corps propre qui modifie les choses, le mouvement qui sait faire, serait une spécification de ce mouvement vers l’espace[22]. »
Répondre à la question « où suis-je » passe alors par la mise en évidence du mouvement de localisation dans lequel je suis engagé. Dire où je suis revient à indiquer ce que je suis en train de faire, comme nous l’avons indiqué précédemment, à condition seulement de comprendre ce faire non pas comme un rapport dans lequel je suis de plain pied avec les choses, mais plutôt comme un mouvement vers elles.
Il nous faut maintenant indiquer les conséquences au sujet du corps qui découlent de la détermination de l’existence comme mouvement de localisation et du refus d’accorder au corps un statut substantiel. Dans le même cadre biranien, la corporéité est déterminée dans le sillage de la caractérisation du moi comme force : « la corporéité du moi est tout d’abord, dans l’optique de notre expérience, la corporéité d’une force[23] ». Cela revient à dire que si tout mouvement est nécessairement corporel, le mouvement corporel n’est pourtant pas le mouvement originaire, mais renvoie plutôt à un mouvement de « pénétration dans le monde dont la possibilité est impliquée dans la force que résume le titre moi[24] ». Autrement dit, si toute possibilité de l’existence doit nécessairement avoir une traduction au niveau d’un pouvoir corporel (même à la pensée correspond une certaine posture), ce n’est pourtant pas en cartographiant les pouvoirs du corps qu’on pourrait rendre compte des possibles auxquelles l’existence peut se rapporter. Le corps n’est pas une entité close qu’on pourrait analyser séparément de l’existence qui l’investit : on ne saurait jamais ce que peut un corps (même dans ce qu’il a de plus élémentaire) si on se contente de l’investiguer en lui-même, sans prendre en compte le mouvement de l’existence qui l’investit, et avec qui il est à jamais solidaire.
Ovidiu Stanciu
Centre Georges
Chevrier, UMR 7366 CNRS-uB /
Bergische Universität
Wuppertal
(sous la direction de Pierre Rodrigo)
[1] Jan Patočka, « Leçons sur la corporéité » in Papiers phénoménologiques [désormais PP], trad. Erika Abrams, Grenoble, Millon, 1995.
Pour citer cet article :
Ovidiu Stanciu, « Le pouvoir du corps et le phénomène de l’orientation. Lecture des Leçons sur la corporéité de Jan Patočka », Revue TRANSVERSALES du Centre Georges Chevrier - 2 - mis en ligne le 12 mars 2014.
URL : http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/publications/transversales/Que_peut_le_corps/O_Stanciu.html
Auteur : Ovidiu Stanciu
Droits : © Tous droits réservés - Ce texte ne doit pas être reproduit (sauf pour usage strictement privé), traduit ou diffusé. Le principe de la courte citation doit être respecté.