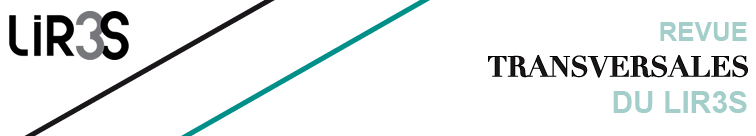
Apprendre à dessiner au XVIIIe siècle :
normes et limites de l’enseignement académique
J’ai connu un jeune homme plein de goût,
qui avant de jeter le moindre trait sur sa toile,
se mettait à genoux et disait :
« Mon dieu, délivrez-moi du modèle »[1].
C’est avec sa liberté de ton et sa plume corrosive que Denis Diderot (1713-1784), en 1766, argumente contre la valeur exemplaire et pédagogique de l’étude du modèle vivant pratiquée à l’Académie royale de peinture et de sculpture de Paris. Sa diatribe, contre l’enseignement académique, paraît dans la Correspondance littéraire, philosophique et critique. C’est dans ce périodique, à publication manuscrite limitée et confidentielle, que Diderot rédige ses critiques autour des Salons : ces expositions parisiennes où les artistes de l’Académie royale montrent leurs créations, en les soumettant au regard et au jugement du public. Le contenu, souvent acerbe, vilipende les artistes avec un humour mordant et passe au crible chacune de leurs œuvres exposées.
« Personne que vous, mon ami, ne lira ces papiers ; ainsi je puis écrire tout ce qu’il me plaît[2] », se dédouane Diderot lorsqu’il s’attaque aux normes pédagogiques qui régissent l’Académie. « En effet, dit-il, il est si rare aujourd’hui de voir un tableau d’un certain nombre de figures, sans y retrouver, par-ci par-là, quelques-unes de ces figures, positions, actions, attitudes académiques, qui déplaisent à la mort à un homme de goût, et qui ne peuvent en imposer qu’à ceux à qui la vérité est étrangère, accusez-en l’éternelle étude du modèle de l’école[3]. »
Quelles sont les raisons qui poussent les littérateurs, artistes et théoriciens de l’art à remettre en question l’étude du modèle vivant, qui constitue pourtant la norme et l’identité de l’enseignement académique ?
Pour comprendre cette distance prise, dès les années 1750, face à la pédagogie de l’Académie, il convient, dans un premier temps, de revenir sur l’histoire et les enjeux de cet établissement dont le modèle rayonna pourtant dans toutes les provinces françaises.
L’Académie : normes et idéologies
Créée en 1648, l’Académie a pour but de libéraliser le statut des artistes et de contribuer au rayonnement artistique de la France[4]. Elle se présente comme un regroupement d’artistes soucieux de s’affranchir de la communauté des peintres et sculpteurs de Paris également appelée « Maîtrise ». Regroupés sous l’égide de Charles Le Brun (1619-1690), les artistes de l’Académie de peinture et de sculpture revendiquent une distinction entre les « arts libéraux », dont ils se réclament et les « arts mécaniques » qui correspondent aux métiers de l’artisanat, tels qu’ébéniste, menuisier ou bronzier. Contrairement aux artisans, les académiciens exercent des « arts nobles », impliquant une réflexion et un geste créateurs. Leur apprentissage complexe et rigoureux exige une éducation et une érudition spécifiques[5], enrichies, tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles, par des Conférences. Présentées par des académiciens distingués, ces dernières correspondent aussi bien à des lectures de vie d’artistes, des réflexions sur la pratique de l’art ou des commentaires d’œuvres[6]. L’Académie établit en son sein une hiérarchisation des genres, qui classe les artistes moins selon leurs talents artistiques que par leurs capacités intellectuelles. Ainsi, au sommet de cette hiérarchie se trouve la peinture d’histoire, suivie du portrait, de la scène de genre, du paysage et enfin de la nature morte. Le peintre d’histoire se présente alors comme un familier et interprète, tel le poète ou l’historien, des récits historiques, bibliques et mythologiques.
Dans sa préface aux Conférences de l’Académie royale pendant l’année 1667, Félibien (1619-1695) expose les raisons de la primauté du peintre d’histoire dans la hiérarchisation des genres :
« comme la figure de l’homme est le plus parfait ouvrage de Dieu sur la terre, il est certain […] que celuy qui se rend l’imitateur de Dieu en peignant des figures humaines, est beaucoup plus excellent que tous les autres. […] il peut […] traiter l’histoire & la fable ; […] représenter de grandes actions comme les Historiens, ou des sujets agréables comme les Poëtes ; Et [monter] encore plus haut, […] par des compositions allégoriques, [c’est-à-dire] couvrir sous le voile de la fable les vertus des grands hommes, & les mystères les plus relevez[7] ».
Le programme pédagogique de l’Académie se focalise ainsi essentiellement sur la représentation de la figure humaine. L’établissement avait pour principale vocation de permettre aux peintres « de dessiner ou peindre et aux sculpteurs de modeler d’après un homme nud [placé dans une] attitude d’action & de vigueur[8] ». Les exercices obtenus à partir de ce modèle, « soit avec du crayon sur papier, soit en modelant avec de la terre ou de la cire se nomment des Académies[9] ». À priori, cette figure entière dessinée d’après le modèle ne doit pas servir à la composition d’un tableau, car elle a une fonction d’éducation de l’œil et d’apprentissage de la main ; elle se distingue des figures d’études, parfois nues, qui sont préparatoires à une composition peinte. Pour les théoriciens et amateurs du XVIIIe siècle, le plus beau, le plus noble des dessins reste celui consacré à l’Homme[10], création la plus parfaite de la nature, conçue à l’image de Dieu[11]. Cette idéologie fait office de norme dans l’apprentissage des Beaux-Arts. En effet, « La figure humaine enseigne tout, elle est la source des belles formes et de toutes les grâces[12] » et « rien ne fait mieux connaître la correction d’un maître que ces sortes de desseins, [car] ils prouvent […] sa capacité dans l’anatomie[13] ».
Le Règlement pour l’Établissement des Écoles académiques de Peinture et de Sculpture dans toutes les Villes du Royaume où elles seront jugées nécessaires, édicté à la suite des lettres patentes du 22 décembre 1676, autorise les provinces à ouvrir des écoles « placées sous la protection de l’Académie Royale[14] ». Mais les premiers établissements créés dans le sillage de la déclaration royale n’ont qu’une brève existence, et les initiatives bordelaise, lyonnaise et rémoise, faute de moyens, se soldent par des échecs[15]. Cependant, une seconde génération d’écoles de dessin provinciales se développe dès les années 1750. Ces institutions ne sont pas seulement centrées sur l’apprentissage des arts libéraux, et plusieurs d’entre elles proposent de former des artisans d’art[16] afin de développer le bon goût et de favoriser la création locale[17]. À l’ambition économique se superpose un discours social. En effet, ces établissements ont vocation à « fournir aux jeunes gens un préservatif contre l’oisiveté et les désordres […]. Le temps de la sortie des Collèges & des Écoles Ordinaires ; ce passage de l’enfance à la jeunesse est l’époque malheureuse de la dépravation[18] ».
L’Académie royale est gênée par la multiplication et l’expansion de ces établissements. Elle n’hésite pas à réaffirmer la supériorité de son enseignement en rappelant que les parties du dessein « qui tombent dans la mécanique et les corps de métiers, comme la menuiserie, la serrurerie, la charpenterie, etc., […] sont incompatibles avec les beaux-arts qu’elle professe ». Elle ne s’occupe « que du soin d’enseigner aux Élèves à bien dessiner ou modeler la figure[19] », exercice qui repose sur l’étude exclusive du modèle vivant dont elle seule détient le monopole. La déclaration royale de 1777 lui permet de se garantir ce privilège et de contrôler, par un système d’autorisation et d’affiliation, l’enseignement professé en province[20]. Si certaines villes se défient de Paris et assument leur indépendance, nombreux sont les établissements qui, désireux d’entretenir des classes de dessin d’après le modèle vivant, se placent sous la tutelle de l’Académie royale. Le souhait de bénéficier des bonnes grâces et du soutien matériel de la capitale engagent des villes comme Marseille, Tours, Orléans ou encore Valenciennes à soumettre la moindre de leurs décisions à l’Académie royale. Celle-ci, par l’entremise du marquis d’Angiviller (1730-1809), Directeur des Bâtiments du Roi, établit des règles et exerce une étroite surveillance sur les Règlements et les activités des écoles de province[21].
L’enseignement du dessin
« La science du dessin peut être acquise seulement après une longue pratique et beaucoup de concentration[22]. »
Cette phrase, extraite de la Méthode pour apprendre à dessiner sans maitre, publiée en 1755 chez Charles-Antoine Jombert (1712-1784), résume le long et laborieux apprentissage auquel se soumet tout élève intégrant un cursus artistique. L’enseignement du dessin est très progressif et codifié. Il dépend de nombreuses règles, de discours et de théories.
L’élève apprend tout d’abord à dessiner des lignes et des figures géométriques afin d’assouplir son poignet. Puis il se confronte à la copie de modèles dessinés ou gravés. Il commence par reproduire des fragments anatomiques comme des yeux, nez, mains ou pieds avant de dessiner une figure académique complète. « Les premiers dessins qu’on fait imiter aux jeunes élèves sont [alors] ordinairement […] ceux qu’un habile maître a fait lui-même d’après nature, soit pour son étude, soit avec le but de les faire servir de modèles à ceux qu’il instruit[23]. »
Les recueils de modèles, les livres de principes et les « livres à dessiner » foisonnent de modèles empruntés aux plus grands artistes modernes. Les étudiants, les pédagogues et les amateurs d’art y trouvaient des figures d’après Raphaël ou Michel-Ange ainsi que des académies composées d’après des peintres enseignant à l’Académie royale. Les estampes en manière de crayon tirée à l’unité remportent dès les années 1770, un vif succès auprès des écoles de dessin. Leur coût modique permet de répandre, dans les établissements les plus modestes, des modèles tirés d’après les académies des meilleurs professeurs de l’Académie royale[24].
Après avoir consacré environ une année à acquérir une première maîtrise du dessin, l’élève délaisse la copie des modèles dessinés et gravés pour se consacrer à l’étude de la statuaire qu’on appelle également la bosse. Cette étape intermédiaire entre l’étude d’après le dessin et le modèle vivant est fondamentale. Les moulages, étant privés de mouvement et de couleur, se présentent comme la transition parfaite entre « la copie » et « l’imitation »[25]. Ils offrent aux élèves la possibilité d’observer et de recommencer leurs essais autant de fois qu’ils le désirent. Les élèves apprennent à voir et à restituer les volumes du corps, « à connaître l’effet des ombres et des jours, à donner du relief aux parties et [à] se perfectionner dans le contour des figures[26] ». De plus, en dessinant d’après la bosse, l’élève se familiarise avec les muscles et les détails avant d’apprendre « à les connaître dans la nature ou ils sont souvent vivants & mobiles[27] ». En effet, la fixité des modèles en ronde-bosse offre la possibilité d’observer, d’imiter, de se corriger et de recommencer les essais à satiété[28].
Par ailleurs, l’étude de la statuaire antique permet de former le goût au vrai Beau. Les Anciens sont réputés pour leur parfaite connaissance anatomique[29], et « la perfection du dessin & du plus beau choix de la nature » ne pouvaient être atteints « que par une étude obstinée [des] Antiques[30] ». Nombre d’artistes établissent des conférences et traités sur la nécessité d’étudier conjointement l’antique et l’anatomie. La copie des grands classiques antiques est jugée indispensable car elle se présente comme un moyen de corriger la nature. Aussi, les établissements d’art disposent-ils de plâtres de statues, bas-reliefs et bustes se rapportant aux principaux chefs-d’œuvre grecs et romains[31].
Enfin, la dernière étape de l’enseignement est celle de la classe du modèle. Le professeur n’y admet que les élèves qui se sont suffisamment « perfectionnés en dessinant & en modelant d’après la bosse[32] ».
À ce stade, l’étude du dessin se complexifie ; il faut être capable de représenter « les différents mouvemens des muscles […] dans chaque partie du corps humain [avec] plus ou moins d’effort, suivant les actions fortes ou faibles que l’on veut représenter[33] ». L’étude des raccourcis anatomiques[34], du modelé et du clair-obscur sont également privilégiés[35].
Au début de chaque séance, le professeur définit l’attitude du modèle. « Poser le modèle, [était l’] un des principaux devoirs du professeur[36]. » Placé sur une table pivotante ou un piédestal éclairé par le haut, le modèle peut aussi bien être posé assis, debout ou couché. L’ensemble des postures étudiées permet à l’élève de se constituer un répertoire de formes et d’actions auquel il peut recourir tout au long de sa carrière.
Tout comme l’Académie royale, les écoles de dessin incitent les élèves à étudier l’anatomie. « En effet, quand on commence à dessiner d’après nature, on n’aperçoit presqu’aucun muscle, [aussi] avant d’apprendre le dessein, on doit avoir quelque légère teinture de l’Anatomie[37]. » L’anatomie permet à l’étudiant de comprendre et de reconnaître les actions du corps humain et les insertions des muscles[38]. Elle aide ainsi à la compréhension de l’Antique et de la Nature[39]. Roger de Piles (1635-1709) évoque d’ailleurs l’anatomie comme « le véritable fondement du dessein ». Il voit en cette science « la base solide de la vérité et de la correction des contours[40] ». Cette étude est indispensable, car « si l’Artiste ne conçoit pas ce qu’il voit, il ne fçaura jamais le copier fidèlement. Les fautes se multiplieront & n’en seront que plus grossières, malgré les soins & les précautions qu’il apportera à son ouvrage. Il se trouvera dans le même cas qu’un copiste qui transcrit d’après une langue qu’il n’entend pas ou d’un Traducteur qui veut passer dans sa langue des matières qu’il ignore[41] ».
Culture versus nature : comment étudier et représenter le modèle ?
On a vu que « La perfection du dessin & du plus beau choix de la nature » ne peuvent être atteints « que par une étude obstinée [des] Antiques[42] », dont les proportions, jugées parfaites, font l’objet d’une abondante littérature. La copie des grands antiques est jugée indispensable car elle présente un moyen sûr de corriger les défectuosités de la nature. Aussi les établissements d’art disposent-ils de nombreux modèles en plâtre. Si la copie des grands classiques antiques fait usage de règle et de norme académiques, c’est également parce qu’elle se présente comme un moyen sûr de corriger les défectuosités de la Nature.
Certains théoriciens et artistes vouent une admiration totale et aveugle aux antiques. Les réflexions du Bernin (1598-1680,) lors de sa visite à l’Académie de Paris en septembre 1665, ont certainement un impact déterminant sur ce qu’on peut appeler le « culte de l’antique et du beau idéal ». C’est avec un mépris à peine voilé que l’artiste italien s’exprime sur les méthodes pédagogiques de l’Académie française : « C’est perdre [les élèves] que de les mettre à dessiner au commencement d’après nature, laquelle presque toujours est faible et mesquine, […] ils ne pourront [alors] jamais produire rien qui ait du beau et du grand air[43]. » Le Bernin prône non pas la restitution du corps tel qu’il est, mais plutôt tel qu’il devrait être. Il exhorte l’Académie française à s’attacher à l’étude des productions des artistes de l’Antiquité qui surent réunir, dans une même œuvre, les beautés éparses que l’on trouve dans la Nature, comme Zeuxis avec les filles de Crotone. Les plus belles statues antiques ne sont, en effet, belles que parce qu’elles représentent la Nature du meilleur choix. Pour les partisans du « mouvement antiquisant », il faut réformer la Nature sur l’Antique. L’obsession de retrouver la beauté et la perfection grecques s’enracine profondément et durablement dans les mentalités : seule l’étude systématique de l’Antique doit permettre aux artistes d’aborder la vraie beauté et de restituer une anatomie harmonieuse.
Pourtant, certains artistes et théoriciens considèrent avec défiance la déférence aveugle que certains de leurs pairs portaient aux antiques. Comme le commente ironiquement Donat Nonnotte – professeur de l’Académie de dessin de Lyon –, « Le froid des marbres antiques a passé dans les veines de quelques-uns de ses adorateurs[44]. »
Les débats sur la préférence à donner à l’étude de l’antique ou à celle de la nature continuent d’opposer les artistes et les académiciens jusqu’au terme du XVIIIe siècle. La lecture de Conférences, telles que celles du comte de Caylus (1692-1765) ou encore de Claude-François Desportes (1695-1774), suffit à prouver que l’antique reste encore, pour certains, une référence et une règle inébranlables. Tandis que d’autres comme Michel-François Dandré-Bardon (1700-1785) ou encore Charles-Nicolas Cochin (1715-1790) rappellent dans leurs conférences que l’antique doit seulement servir de guide ; la nature restant le but principal de l’artiste[45].
En effet, la pédagogie académique est vivement critiquée par des théoriciens et des artistes, qui en dénoncent l’aspect factice et asséchant.
Le recours répétitif à des estampes peut réduire l’enseignement à un simple exercice de copie[46]. L’élève prend alors le risque de ne connaître de la nature que ce qu’il a appris par l’intermédiaire des dessins et des gravures. Car, s’il faut « s’assujetir à copier beaucoup d’estampes […] ou mieux encore des desseins, on doit seulement observer de ne point imiter trop servilement […] parce que cela donneroit une manière de dessiner sèche & maigre[47] ». Par ailleurs, la copie de maîtres risque de donner au jeune dessinateur un style maniéré dont il aura du mal à se défaire[48]. La manière est alors définie comme un vice et correspond à « tout ce qui s’éloigne de la nature, toute convention apprise ou imaginée, qui n’a pas le vrai pour base, soit qu’elle vienne de l’imitation des maîtres ou de nos propres erreurs[49] ».
De même, si l’antique occupe une place prépondérante dans l’apprentissage des futurs artistes, son étude prolongée est regardée avec méfiance. L’exercice d’après la bosse ne doit servir que de phase préparatoire à celle de la nature[50]. Des auteurs comme Diderot, Watelet ou Cochin mettent en garde, au nom du réalisme et de la nature[51], contre cette pratique, susceptible d’engendrer « la manière [52] », et de donner au praticien « un goût sec et froid dont il pourrait se faire une habitude [53] ».
Diderot stigmatise avec aigreur la portée formatrice de l’exercice académique : « Et ces sept années passées à l’Académie à dessiner d’après le modèle, les croyez-vous bien employées […] ? C’est que c’est là, pendant ces sept pénibles et cruelles années, qu’on prend la manière dans le dessin. Toutes ces positions académiques, contraintes, apprêtées, arrangées ; toutes ces actions froidement et gauchement exprimées par un pauvre diable [….] gagé […] pour se déshabiller et se faire mannequiner par un professeur, qu’ont-elles de commun avec les positions et les actions de la nature ? » Les emmaillotements, cordes et autres accessoires de pose, nuisant au libre développement du corps, obligent le modèle à se maintenir dans des attitudes affectées et artificielles. Cette pratique est fortement vilipendée dans la seconde moitié du XVIIIe siècle[54].
Cependant, la plus virulente critique émane des artistes eux-mêmes. Comme le rapporte Jean Siméon Chardin (1699-1779) :
« on nous met à l’âge de sept à huit ans le porte-crayon à la main. Nous commençons à dessiner d’après l’exemple des yeux, des bouches, des nez, des oreilles, ensuite des pieds et des mains. Nous avons eu longtemps le dos courbé sur le portefeuille, lorsqu’on nous place devant l’Hercule ou le Torse et vous n’avez pas été témoin des larmes que ce Satyre, ce Gladiateur, cette Vénus de Médicis ont fait couler. […] Après avoir séchés des journées et passés des nuits à la lampe, devant la nature immobile et inanimée, on nous présente la nature vivante ; et tout à coup le travail de toutes les années précédentes semble se réduire à rien : on ne fut pas plus emprunté la première fois qu’on prit le crayon. Il faut apprendre à l’œil à regarder la nature ; et combien ne l’ont jamais vue et ne la verront jamais ! C’est le supplice de notre vie[55] ».
« Les Académies répandent l’instruction, conservent les vrais principes, & combattent es le mauvais goût […], mais elles ne donnent ni le génie ni la sublimité[56]. » Ce constat amer, présenté par Cochin, a des relents d’échec. Dans ses trois Discours prononcés en 1777 devant l’Académie royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen, il propose un enseignement moins contraignant[57]. L’étude de la bosse devait être limitée, car elle n’est en rien comparable avec le dessin d’après un modèle vivant. Si l’essentiel était de « toujours consulter la nature », il faut favoriser la pratique du coloris au même titre que celle du dessin. De plus, l’exercice académique ne saurait être efficace sans le recours à plusieurs modèles d’âge et de caractère différents. Cette diversité serait d’un grand intérêt pour les élèves car le « beau de réunion[58] », ou la recomposition parfaite de la nature, n’est réellement opérant que par l’assemblage de multiples beautés[59]. L’esprit encyclopédique, dont le but était de trouver une cause à tout effet, s’applique alors à ébranler les fondements traditionnels de l’enseignement artistique[60].
Présentée par les textes normatifs comme l’acheminement le plus sûr vers le bon goût, la formation par les académies dessinées, si décriée dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, contribua pourtant aux qualités et savoir-faire des peintres de la génération révolutionnaire et de l’Empire, de Jacques-Louis David (1748-1825) à Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867), en passant par Pierre-Paul Prud’hon (1758-1823). Ceux-ci perpétuèrent cet enseignement dans les règlements de l’École des Beaux-Arts au XIXe siècle, et l’académie allait se confondre avec l’académisme…
Nelly
Vi-Tong
Centre Georges Chevrier
UMR 7366 uB/CNRS
(Sous la
direction d’Olivier Bonfait)
[1] D. Diderot, Essais sur la peinture, Paris, Buisson, 1795, p. 8-9.
Pour citer cet article :
Nelly Vi-Tong, « Apprendre à dessiner au XVIIIe siècle : normes et limites de l’enseignement académique », Revue TRANSVERSALES du Centre Georges Chevrier - 7 - mis en ligne le 23 novembre 2015.
URL : http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/publications/transversales/Normes_et_Individu/N_Vi_Tong.html
Auteur : Nelly Vi-Tong
Droits : © Tous droits réservés - Ce texte ne doit pas être reproduit (sauf pour usage strictement privé), traduit ou diffusé. Le principe de la courte citation doit être respecté.