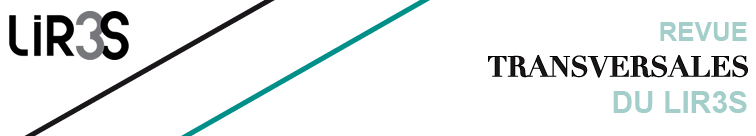
Les repris de justice dans les procès de Bohémiens au XVIIIe siècle
Introduction
La question de la récidive se pose particulièrement dans les procès de Bohémiens et le propos de cet article est d’en analyser les causes et les manifestations.
Le mode de vie des Bohémiens, dont on peut observer les grands traits dans les archives judiciaires par le biais d’éléments récurrents, fait qu'ils relèvent d’une catégorie administrative élargie. D’une part ils tombent sous le coup de la législation les réprimant spécialement dès le XVIe siècle et qui prend en compte la qualité de Bohémien, mais aussi l’attroupement, notamment armé. D’autre part, ils sont soumis à l’abondante législation réprimant plus généralement la mendicité et le vagabondage.
Un rappel sur les évolutions de cette législation s’impose ici. Pour les théologiens et juristes des XIIe et XIIIe siècles, le vagabond ne se distingue pas du pauvre : l’un et l’autre sont hommes de Dieu et leur faire aumône est un acte pieux. Au moment de l’arrivée des Bohémiens en Europe occidentale – aux XIVe et XVe siècles – une période de régression économique engendre la multiplication des pauvres sur les chemins et vers les villes. Ces dernières d’abord, puis les autorités monarchiques ensuite, notamment en France et en Angleterre, cherchent à les renvoyer dans leurs paroisses d’origine car le vagabondage est considéré comme source de délinquance. Au XVIe siècle, les villes prennent en charge l’entraide et s’efforcent donc d’interdire la charité individuelle : « […] on commence à distinguer les mendiants même valides des vagabonds à qui on impose les premières mesures de contrainte. Légalement le vagabond est un suspect et le vagabondage une circonstance aggravante[1] ». À la fin du XVIe siècle, les juristes demandent la pénalisation du vagabondage en tant que délit spécifique puni de peines arbitraires[2]. La politique suivie en France aux XVIIe et XVIIIe siècles est un prolongement de ces idées.
Les pauvres mendiants sont d’abord différenciés des vagabonds sans aveu : alors que les premiers sont « membres vivans de Jésus-Christ, et non pas […] membres inutils à l’État » et relèvent de l’Hôpital, les seconds relèvent de la police car sont des criminels[3]. Puis les mendiants valides deviennent, au même titre que les vagabonds jusque là, des criminels[4]. C’est la déclaration royale du 12 octobre 1686, portant peine des galères contre les mendiants valides, qui criminalise et laïcise la mendicité des valides. Dès lors, une confusion progressive se produit entre mendiants valides et vagabonds, deux notions auparavant distinctes. Enfin, au XVIIIe siècle, la déclaration de 1724 ne voit le vagabondage qu’à travers la mendicité qu’elle condamne absolument. La déclaration de 1764 quant à elle, ne concerne que les vagabonds et gens sans aveu, termes qui avaient disparus des textes depuis 1701[5].
À la lumière des textes du XVIIIe siècle, on voit bien que la répression des Bohémiens, fondée sur une législation spéciale, va tendre en fait à se fondre dans une répression commune avec les mendiants, vagabonds, etc., contribuant à marginaliser toutes ces catégories.
Enfin, s’ils sont déjà sanctionnés sur ces fondements, les Bohémiens relèvent aussi de la législation criminelle. En d’autres termes, d’autres délits peuvent conduire les Bohémiens en justice, notamment les vols.
La récidive doit maintenant être définie. Elle se caractérise par la commission d’une nouvelle infraction après une condamnation pénale définitive, non susceptible de recours. C’est par définition le cas dans les procès de Bohémiens car ils sont jugés prévôtalement et en dernier ressort[6]. La récidive constitue une circonstance aggravante. Alors que le droit coutumier médiéval n’envisage que la récidive spéciale, c’est-à-dire la réitération du même délit, la doctrine va au XVIe siècle considérer la récidive générale, celle-ci étant caractérisée par le fait que l’infraction jugée peut être différente de celle déjà commise. Cela aboutit à l’idée du délinquant d’habitude dont le vagabond est un exemple-type.
Instruire les procès de Bohémiens et les juger fait partie des attributions de la justice prévôtale[7]. Les prévôts des maréchaux doivent contrôler la catégorie mouvante des soldats, déserteurs, vagabonds, Bohémiens, récidivistes. « Non seulement les prévôts [sont] formellement compétents pour juger les récidivistes déjà condamnés au bannissement par un tribunal ordinaire, mais on peut dire plus généralement que le “gibier des prévôts”, par son déracinement extrême, [est] frappé d’une sorte de présomption de récidive (même en l’absence de marque) [8]. »
L’étude des Bohémiens repris de justice est un moyen de suivre ces individus et d’esquisser leur itinéraire par le biais de leurs interrogatoires. Cela permet également de se rendre compte de leur insertion au sein de groupements mobiles et à géométrie variable. Dans cette optique, les procès étudiés ici sont ceux instruits contre des Bohémiens au sens strict, c’est-à-dire ceux où la qualité de Bohémiens est explicitement mentionnée dans la procédure. Notre étude se concentre de surcroît sur les Bohémiens plusieurs fois repris de justice.
Après avoir présenté la législation sous le coup de laquelle tombent les Bohémiens, nous aborderons la question des moyens d’identification des repris de justice. L’étude des profils et des itinéraires empruntés par ceux-ci nous renseignera ensuite largement sur certains traits d’une réalité anthropologique et de sa permanence. Enfin, il nous faudra, après l’avoir constatée, interpréter l’importance des cas de récidive dans les procédures criminelles instruites contre les Bohémiens.
La législation en vigueur à l’encontre des Bohémiens
Il est nécessaire d’examiner ici brièvement les ordonnances édictées en Lorraine, mais aussi en France, du fait des enclaves françaises des Trois-Évêchés[9] en Lorraine. Au XVIIIe siècle, la souveraineté du duc de Lorraine s’exerce sur ses États, alors que celle du roi de France s’exerce sur les Trois-Évêchés. Deux législations sont donc en vigueur en Lorraine, jusqu’en 1766. Suite à la mort de Stanislas Leszczynski – ancien roi de Pologne et dernier duc de Lorraine – la Lorraine est annexée à la France.
En règle générale, les nouvelles dispositions renvoient à des textes antérieurs au moyen de rappels fréquents de la législation déjà en vigueur. Par ailleurs, précisons d’emblée que différents domaines de police sont couverts par les dispositions législatives dans le champ desquelles entrent les Bohémiens : sûreté publique, santé publique, ordre public, etc.
Les textes à l’encontre des Bohémiens communément visés dans les procès du XVIIIe siècle sont par conséquent assez nombreux. Citons tout d’abord la déclaration du 11 juillet 1682 pour la France, et donc en vigueur dans les Trois-Évêchés. En ce qui concerne la Lorraine, ce sont les ordonnances du 14 février 1700 et du 24 mai 1717, l’ordonnance du 17 mars 1720, et l’édit du 28 décembre 1723.
Selon la déclaration du 11 juillet 1682, l’exécution des anciennes ordonnances doit se manifester par l’arrestation de tous les Bohèmes ou Égyptiens – hommes, femmes et enfants – du royaume. Les hommes seront envoyés aux galères à perpétuité, et dans un souci d’appuyer la répression, l’ordonnance prévoit la séparation et la dispersion définitive des familles. Les femmes et filles « trouvées menant la vie bohémienne » auront la tête rasée et les enfants trop jeunes pour servir aux galères seront envoyés dans les hôpitaux les plus proches. Pour les femmes récidivistes, c’est-à-dire continuant « de vivre en bohémiennes », il est prévu qu’elles soient fustigées et bannies du royaume sans autre forme de procès. Ce que nous avons pu observer, c’est que la peine des galères semble bien être la manifestation d’une politique française puisqu’elle apparaît surtout dans les textes français et est majoritairement prononcée dans les territoires sous juridiction française.
Deux ans après la prise de possession de ses États, le duc de Lorraine Léopold Ier édicte, le 14 février 1700, une ordonnance qui concerne le port d’armes et les vagabonds, Égyptiens, Bohémiens et mendiants. « Ceux qui se disent Égyptiens, ou Bohémiens et autres gens de pareille qualité[10] » doivent incessamment quitter les États du duc de Lorraine à peine à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de la publication du texte, d’être – eux et leurs femmes – fustigés par l’exécuteur en vertu d’une sentence judiciaire. Et en cas de récidive, ils seront fustigés, marqués et bannis. Les sentences seront exécutées en dernier ressort et sans appel. La maréchaussée doit les poursuivre, les faire arrêter et condamner, et les sujets lorrains se voient expressément interdire de leur donner retraite sous peine d’être punis comme complices.
L’ordonnance du mois de mai 1717 « contre les vagabonds, mandians valides, tant étrangers que ceux du pays » réglemente également la maréchaussée et l’aumône publique. Elle enjoint aux pauvres étrangers, vagabonds et Bohémiens – hommes et femmes – de sortir incessamment des duchés de Lorraine et de Bar avec défense à eux d’y rentrer et de s’y attrouper. Après quinze jours à compter de la publication de l’ordonnance, ceux qui s’y trouveront doivent être arrêtés par la maréchaussée ou par les habitants des villes et villages qu’ils traverseront pour être conduits dans les prisons du bailliage le plus proche. Ils y seront alors jugés prévôtalement et en dernier ressort condamnés au fouet, et pour ceux qui seront armés, au fouet et à la marque. En cas de récidive, ils seront punis de mort. À nouveau, il est interdit aux sujets lorrains de les abriter[11].
L’ordonnance « pour les pauvres » du 17 mars 1720 vise précisément les pauvres étrangers. Or, nous avons vu que l’ordonnance de mai 1717 considère indifféremment les « pauvres étrangers, vagabons, & Bohemiens ». Malgré les dispositions antérieures prises pour que les « mandians, vagabonds, ou étrangers » cessent de parcourir le pays, il s’en trouve qui entrent en Lorraine munis de certificats, et qui y rôdent à la faveur de ces documents. Désormais, ceux obligés de traverser la Lorraine devront présenter aux maires et officiers du premier lieu où ils passeront les certificats des lieux de leur résidence ordinaire, où devront figurer la mention de leur raison d’entrer en Lorraine, leur destination et la route pour y arriver. À ces conditions seulement, ils pourront bénéficier de l’aumône dans les lieux de leur passage. Les maires ou officiers lorrains des lieux de leur entrée devront aussi leur délivrer des certificats. Dans le cas où ils ne présenteraient pas ces documents lors des contrôles effectués par les archers[12] au cours de leurs tournées, ils seraient passibles d’emprisonnement dans l’attente de leur procès.
L’ordonnance du 28 décembre 1723 reprend dans ses grandes lignes le texte de 1717. Les Bohémiens, vagabonds, gens sans aveu et pauvres étrangers, ou les sujets en contravention avec les mesures précédentes, seront condamnés au fouet s’ils ont été arrêtés sans armes, ou au fouet et à la marque s’ils sont en possession d’armes offensives[13]. On les conduira hors de la Lorraine et du Barrois dans les deux cas, et toute récidive sera punie de mort.
Il est intéressant de noter que d’un point de vue sociologique, on peut voir une certaine symétrie entre les termes de la législation et les évolutions de la physionomie des groupes bohémiens. En 1682, c’est la protection par la noblesse de grandes compagnies bohémiennes qui préoccupe la royauté. En 1700, les vagabonds armés sont source d’inquiétude dans les campagnes. En 1717 et après, les Bohémiens apparaissent comme des vagabonds armés ou des pauvres étrangers. Cette évolution est directement liée à la dispersion des grandes compagnies bohémiennes – pouvant compter une centaine d’individus se déplaçant ensemble – que la déclaration de 1682 a privées du patronage de l’aristocratie[14]. À partir de la fin du XVIIe siècle, les Bohémiens circulent par petits groupes de deux à trois dizaines de personnes au plus.
Quant aux sanctions encourues par les Bohémiens ne se conformant pas à la législation en vigueur, il s’agit essentiellement des punitions corporelles – la fustigation et la marque – assorties du bannissement. La marque, châtiment corporel en soi, constitue en outre « une sorte de “casier judiciaire” avant la lettre[15] » en tant que moyen de repérer les récidivistes.
L’identification des récidivistes
Le premier moyen de repérer les repris de justice consiste donc en l’examen du corps des accusés à la recherche de marques éventuelles. Cet examen est mentionné dans les procédures comme la « visite » effectuée par le chirurgien juré aux rapports. Requise par le ministère public et ordonnée par un magistrat, elle intervient juste avant les interrogatoires préparatoires des accusés.
La méthode, très simple, est détaillée dans certaines procédures. L’accusé(e) est déshabillé(e) et le chirurgien frotte immédiatement et fortement ses omoplates avec une serviette bien chaude à la recherche d’impressions faites au fer chaud ou de cicatrices[16]. Le chirurgien n’arrive pas toujours à reconnaître les marques et ainsi déterminer la juridiction qui y a procédé. Tout au plus peut-il parfois indiquer qu’elles ont été faites à l’étranger. Il y a en effet une grande diversité des marques qu’on peut répartir en deux groupes. En premier lieu les formes : croix de Lorraine, fleur de lys, potence, marques rondes, etc. Et en second lieu les lettres : GAL, T, S, indiquant généralement la condamnation ou le délit commis.
L’examen par un chirurgien, systématique dans les procédures criminelles dépouillées, révèle ainsi la présence devant les juridictions lorraines d’une très grande proportion de Bohémiens déjà condamnés.
De façon plus ponctuelle, il arrive que les prévenus marqués soient reconnus par diverses personnes. Cela suppose des recherches voulues et ordonnées par un magistrat et c’est par exemple le cas des procureurs dans deux procédures de 1728 et 1740.
Dans la première, douze individus – six enfants, trois femmes et trois hommes – sont capturés les 29, 30, et 31 janvier 1728[17]. Ils sont écroués à Nancy le 31 janvier et le lendemain, le rapport du chirurgien[18] précise que les nommés Jean Laforêt, Jean Laroche et Jeanne Lafontaine sont marqués de fleurs de lys sur les épaules. Quant aux nommés Nicolas Laforêt, Anne Laroche et Catherine Laforêt, ils ne sont pas marqués. Le 4 février, un extrait des registres du greffe de la prévôté de Château-Salins est porté au dossier : il s’agit d’une sentence prévôtale du mois de mai 1725. Particulièrement zélé, le procureur en la maréchaussée de Lorraine et de Bar s’est fait expédier deux sentences rendues à Château-Salins, respectivement le 1er mai 1725[19] et le 5 novembre 1725, afin de vérifier si les individus détenus à Nancy ne font pas partie de la troupe de ceux qui avaient alors été condamnés. Face aux dénégations des accusés, le procureur ne s’en tient pas là et demande au prévôt de Château-Salins d’envoyer à Nancy leur sergent de police et concierge des prisons pour identifier les Bohémiens. Celui-ci vient examiner les prisonniers le 7 février 1728.
Il reconnaît Jean-Pierre Laforest, Nicolas Laforest (âgé d’environ seize ans), et un garçon de quatre ans surnommé « Harlequin » dans les deux procès. Il reconnaît également Catherine Lépine, nommée dans la sentence du 1er mai, et qui a déclaré dans son interrogatoire de 1728 s’appeler Catherine Laforest. Marie Laforest, ainsi nommée dans les deux sentences de 1725, est aussi reconnue, mais elle se présente à Nancy comme étant Anne Laroche. Enfin, Marie Laforest, âgée de dix ans, est aussi reconnue.
Le second exemple de recherches poussées aux fins d’identifier les repris de justice se trouve dans le procès instruit contre deux Bohémiennes au bailliage d’Allemagne en 1740, au cours duquel les quatre témoins entendus dans l’information[20] identifient une des Bohémiennes comme ayant déjà été jugée à Sarreguemines. Le premier témoin, greffier au bailliage d’Allemagne, rapporte qu’à la fin du mois de juillet 1737, la maréchaussée avait amené dans les prisons de Sarreguemines une femme et une fille bohémiennes accusées d’avoir volé des souliers à l’abbaye de Saint-Avold. La femme se nommait Magdelaine André et la fille Nanon De Laurier et les deux femmes avaient alors été condamnées à être fouettées et flétries d’un fer chaud à la marque de la croix de Lorraine. Lorsqu’elles ont été emprisonnées à Sarreguemines en 1740, le témoin les a observées et a reconnu la nommée Nanon Delaurier comme l’une des femmes condamnée en 1737. Il révèle aux magistrats qu’elle se nomme ainsi et qu’il l’a déjà vue dans ces mêmes prisons avec d’autres Bohémiennes avant qu’elle ne subisse le fouet et la marque. La prévenue prétend quant à elle ne pas connaître de Bohémiens en répliquant « qu’elle ne connoissoit pas ces races la ».
Les trois autres témoignages vont dans le même sens. Le deuxième témoin, interprète au bailliage d’Allemagne, venu voir les Bohémiennes, « croit en reconnoitre une par la parole, ne la remettant de visage parce qu’elle paroit maigrie » : elle se nommait Nanon Delaurier lors de sa première détention. Le troisième témoin, ancienne geôlière des prisons de Sarreguemines, reconnaît la plus jeune des deux Bohémiennes comme celle qui s’appelait, en 1737, Nanon Delaurier. La geôlière l’ayant reconnue et le lui ayant fait remarquer, l’accusée a dans un premier temps contesté, puis l’a priée d’une part de ne pas dévoiler son identité, et d’autre part d’interdire à son fils – le quatrième témoin et nouveau geôlier – d’en parler, parce « que c’etoit une mauvaise langue qui luy feroit du tort ». Ces propos trahissent l’intention de la Bohémienne d’intimider les témoins, en leur faisant comprendre que la révélation de leur part de son identité pourrait leur nuire.
Le geôlier des prisons de Sarreguemines est donc le quatrième et dernier témoin. Après avoir examiné la plus jeune des deux, il a remarqué, en voulant lui parler, qu’elle détournait le visage afin de ne pas être reconnue, ce qui lui a fait penser qu’il s’agissait bien de celle qui se faisait nommer Nanon Delaurier en 1737. La femme contestant cette identité, il lui fait alors savoir qu’elle doit être marquée. Elle lui répond avoir en effet été marquée pour fait de contrebande, mais pas à Sarreguemines. Ce mensonge manifeste – ainsi que la tentative d’intimidation des témoins – indique qu’elle craint probablement une plus grande sanction en cas de preuve établissant une précédente condamnation par les juges de ce siège.
Enfin, le maître des hautes œuvres à Sarreguemines est assigné à comparaître pour examiner la bohémienne et identifier la marque qu’elle porte. Il lui reconnaît sur l’épaule droite une marque en forme de croix de Lorraine, qui lui semble avoir été faite au moyen de son fer. En effet, lui apposant celui-ci à froid, il constate qu’il se superpose en tous points à la marque. Il croit même savoir que son père a marqué la bohémienne « parce qu’il marque ordinairement au haut de l’epeaule[21] ».
En ce qui concerne l’apposition de la marque, elle se fait en principe à l’issue d’une procédure judiciaire. C’est l’exécuteur de la haute justice qui procède à l’exécution des peines corporelles telles que la fustigation et le marquage au fer chaud. Il existe de rares exceptions, essentiellement dans le Saint Empire romain germanique, et qui semblent concerner spécifiquement les Bohémiens[22]. Dans certains cas, un exécuteur d’un type particulier semble investi de cette prérogative comme en atteste une petite série de procédures instruites au bailliage d’Allemagne au cours de l’année 1740. Une des deux prévenues, dans une procédure y étant instruite durant les mois de juin et juillet 1740[23], affirme que l’exécuteur de Darmstadt qu’elle nomme « Fleichmann[24] » « l’ayant attrapée [dans le pays d’« Obroulme »[25]] avec beaucoup de leurs gens lui avoit pris son extrait de mariage avec le peu d’effets qu’elle avoit pour lors, y ayant de cela environs neuf ans »[26].
Or, ce « Fleischmann », qui semble donc avoir été actif au moins entre 1731 et 1740, est également mentionné dans un autre procès instruit au bailliage d’Allemagne au mois d’août 1740. Trois des accusées ont été marquées « en pleine campagne » par cet exécuteur, c’est-à-dire selon toute vraisemblance en l’absence de procédure[27].
Malgré les marques, l’identification des repris de justice bohémiens n’est pas sans difficulté, surtout du fait de la confusion entretenue par les prévenus. On observe en effet fréquemment chez les Bohémiens, en Lorraine et dans d’autres provinces, d’une part des patronymes similaires[28] et d’autre part l’utilisation de procédés tels que l’emploi de plusieurs noms masquant les identités réelles ou du moins les travestissant. De ce fait, la part des récidivistes par rapport au nombre total des Bohémiens jugés pourrait être en réalité bien plus importante. De plus, si certains avouent leurs précédentes condamnations, il faut pour d’autres l’établissement d’une correspondance entre plusieurs juridictions, ce qui suppose des magistrats zélés et méthodiques. Enfin, c’est le recoupement de certaines informations concernant des prévenus – nom, âge, conjoint(e), parents, etc. – qui peut permettre de les considérer comme repris de justice ; il faut alors procéder au cas par cas.
« Profils » et itinéraires des récidivistes
Deux cas d’espèce – oserons-nous dire des cas d’école ? – seront ici envisagés. Arrêtons-nous tout d’abord sur le cas du nommé Nicolas Laroche, qui se présente également sous le nom d’Albert Laforêt et qui apparaît dans au moins quatre procédures.
En 1732, Nicolas La Roche et sa femme Rose La Croix sont capturés avec leur enfant, qui se nomme Marianne La Roche[29], et comparaissent devant les officiers du bailliage de Lunéville.
Un an plus tard, en 1733, le même Nicolas Laroche, déclare être âgé d’environ 22 ans, et être marié à la nommée Rose Lacroix, Bohémienne, décédée le 27 février 1733. Il nous renseigne sur son père, Nicolas Laroche, qui serait originaire du grand Caire en Égypte. Il est pour sa part Bohémien errant et vagabond depuis sa naissance, sans profession et natif d’Hayange près de Thionville. Il est porteur de certificats, à savoir l’acte de décès de sa femme[30] et l’extrait baptistaire de son fils[31]. Avant d’entrer en Lorraine, il a fréquenté la France, la Bourgogne, ainsi que les environs de Lyon. Repris de justice, il a été condamné à Lunéville deux ans plus tôt environ et à Remiremont vers 1731.
De fait, des pièces figurant au dossier attestent d’autres condamnations. D’une part une sentence prévôtale du 29 décembre 1731, rendue à la prévôté d’Arches et déclarant Nicolas Delaroche (ou Laroche) – ainsi qu’un autre homme et six femmes[32] – coupables de mener une vie errante et vagabonde. Les hommes avaient été condamnés à être battus, et trois femmes[33] à assister à l’exécution et tous avaient été bannis à perpétuité des États de Lorraine. D’autre part, une sentence rendue le 5 avril 1732 par les officiers de justice du bailliage des Vosges.
En 1734, Nicolas La Roche affirme dans son interrogatoire préparatoire se nommer Albert La Forêt. Il a du reste 22 ans, est natif d’Hayange et mène la vie de Bohémien, n’ayant aucune profession ni domicile. Habitué dès l’enfance à cette vie errante et vagabonde, il travaille de temps en temps quand il trouve de l’ouvrage et mendie quand il n’en a pas. Il a été repris de justice deux fois à Lunéville et sa seconde femme se nomme Catherine La Motte. Cette dernière présente sensiblement le même profil que son mari : âgée de 30 ans, elle a eu avec lui un enfant appelé François La Roche. Sans profession, ni domicile, elle est native des environs de Sarrelouis. Elle est Bohémienne de profession, menant la vie errante et vagabonde depuis son enfance et demandant l’aumône avec son petit garçon. Reprise de justice, elle avoue avoir été fouettée à Pont-à-Mousson[34].
L’intérêt d’un tel cas réside dans le fait que les informations issues des différents procès de Nicolas Laroche concernent tant ses origines que celles de son père, mais aussi et surtout son mode de vie en petit groupe familial, ses activités, etc. Cela nous renseigne donc au-delà de la simple identité d’une personne et dévoile de nombreux pans de la vie des Bohémiens, laissant apparaître la richesse des données pouvant être recueillies au fil des procédures criminelles.
Le second cas est une série de procès impliquant les nommés Jean Bernard, Marie-Barbe Maurice et leurs enfants – dont la nommée Catherine Bernard – jugés en 1740, 1747 et 1763. Au mois de juillet 1740, dix-sept Bohémiens sont arrêtés par la maréchaussée de Blâmont. Parmi eux, le ménage formé par la famille Bernard : Jean Bernard, Marie-Barbe Maurice, et leurs enfants Marguerite, Catherine et Jacob Bernard. Ils ont la garde d’un quatrième enfant lié à la famille[35]. Natif de Trêves, Jean Bernard est âgé d’environ 48 ans, cordonnier et sans demeure fixe, allant de village en village pour essayer de gagner sa vie. Il dit n’être venu qu’une seule fois à Nancy pour obtenir un passeport quelques jours avant son arrestation. Sa femme se nomme Marie-Barbe Maurice. Native de Docelles dans les Vosges – et non de Bohême ou d’Égypte –, elle s’est mariée en Allemagne. Elle est réputée Bohémienne, car sa mère est « de race égyptienne ».
Ce sont leurs enfants qui donnent le plus de renseignements sur leur parcours avant leur arrestation. Marguerite Bernard, âgée d’environ 19 ans, confie qu’elle a travaillé à faire des tuiles, et qu’elle suit ses parents. Lorsqu’elle a été arrêtée en compagnie de son père, sa mère, sa sœur, son frère et son cousin, ils avaient fréquenté plusieurs villes et villages, dont Fénétrange, Sarreguemines et Saint-Avold, avec le projet de se rendre en France pour s’y établir afin que son père travaille comme cordonnier. Auparavant, sa famille et elle étaient restées pendant deux ans en Lorraine, et avaient erré de village en village. Arrêtés suite à l’achat par son père d’un vieux cheval pour porter les bagages, ils avaient été relâchés quand il avait justifié l’achat et le paiement du cheval. Catherine Bernard, sa sœur âgée d’environ 15 ans, précise qu’ils étaient restés deux ans à faire des briques dans une tuilerie près de Saint-Avold. Quant à la durée de leurs séjours dans les villages, elle était ordinairement de huit jours : ils restaient tant qu’ils y trouvaient à travailler. En vertu du jugement prévôtal rendu le 23 juillet 1740, ils se voient enjoints soit de quitter les États de Lorraine dans un délai d’un mois, soit de s’y fixer une résidence[36].
Les Bernard sont repris de justice en 1747. Dans un premier temps, une femme qui se présente comme étant Charlotte Muller (ou Millerine) est arrêtée le 18 juillet 1747 en Lorraine allemande. Elle dit suivre son mari soldat et prétend avoir laissé son enfant à son père, qu’elle nomme Jean Muller et qui habiterait à Longeville près de Saint-Avold[37]. Elle a quitté son mari en garnison à Landau le 10 juillet afin de venir chercher son enfant pour ensuite rejoindre son mari. Partie seule, elle l’est restée tout au long de son parcours « jusques dans ce païs ». Questionnée au sujet de son itinéraire, elle dit ne pas avoir pris la route qui mène à Longeville. Si elle a ainsi emprunté un chemin détourné, c’est qu’elle avait peur qu’un vol de lard commis en route soit découvert et qu’elle soit soupçonnée et poursuivie. Au cours d’un nouvel interrogatoire, elle nomme ses deux parents, Jean Muller et Catherine Bichel. Ils vivraient tous deux depuis deux ans à Longeville d’où elle serait partie quinze jours plus tôt. Omettant – vraisemblablement à dessein – de signaler sa condamnation de 1740 et niant même être reprise de justice, elle affirme que cela fait deux ans qu’elle est en Lorraine, où elle est tantôt avec son mari, tantôt avec ses parents.
Or, il ressort de l’interrogatoire sur la sellette que cette femme est en réalité Catherine Bernard. Nous verrons que ses parents, ainsi que son frère et sa sœur, ont été capturés dans un second temps grâce aux recherches menées par la maréchaussée. Par jugement prévôtal rendu le 23 août, Catherine Bernard, se disant Charlotte Muller, est déclarée coupable de mener une vie errante et vagabonde et d’avoir commis divers vols[38]. Par conséquent, elle est condamnée à être fouettée et marquée au fer chaud à l’empreinte d’une croix de Lorraine sur l’épaule droite. Puis elle est bannie à perpétuité des États de Lorraine avec interdiction d’enfreindre son ban sous peine de mort[39].
Concomitamment à ce procès, d’autres Bohémiens sont arrêtés au cours de l’été 1747. Dans la procédure instruite contre Charlotte Muller, elle s’était avérée faire partie d’une « bande de vagabonds suspects » et était en outre suspectée d’avoir « exposé » ou « détruit » son enfant ; elle avait fait plusieurs déclarations selon lesquelles elle avait laissé son enfant à ses parents qui se trouvaient « accidentellement » à Longeville, mais qui devaient être au moment de son interrogatoire dans le duché de Deux-Ponts ou dans les environs. Les cavaliers de la brigade de Sarreguemines sont donc envoyés à la recherche de son enfant ou de ses parents.
Nous retrouvons dans ce groupe, arrêté sur des terres étrangères[40], Jean Bernard, sa femme et leurs enfants Jacob et Marguerite qui nous renseignent partiellement sur leur parcours entre 1740 et 1747. Il convient dans l’interprétation de ce type de données, de prendre en compte les contradictions ou les incohérences apparentes sans se laisser égarer. Pour ce faire, on peut trier les informations et considérer d’une part les itinéraires et lieux fréquentés par les accusés et d’autre part les éléments concernant l’état civil, davantage sujets à caution, ou du moins nécessitant un minimum de pratique des archives judiciaires permettant la mise en place d’une grille de lecture[41]. Pour en revenir à la famille Bernard, ils sont depuis plusieurs semaines aux alentours de Reinheim et Gersheim dans la Sarre, sans être venus en Lorraine depuis sept ans. Ils avaient alors demeuré environ deux ans à Longeville-lès-Saint-Avold à la tuilerie de « Bidengraff ». En contradiction avec les assertions de Jean Bernard, sa femme confie que cela ne fait que deux ou trois ans qu’elle n’est pas entrée en Lorraine[42]. Par ailleurs interrogé au sujet de Charlotte Muller, Jean Bernard dit avoir appris des cavaliers de maréchaussée qu’il y a une fille détenue à Sarreguemines nommée Gertrude Bernard. De plus, il ne connaît pas son gendre sous le nom que sa fille a donné et croit que son nom est Muller[43]. Et lorsqu’on lui demande pour quel autre motif que celui visant à brouiller les pistes et commettre des vols, sa fille – qu’il nomme pour sa part Jeanne Bernard – dissimule son nom et celui de sa famille, il croit savoir que c’est pour « se tirer plus facilement d’affaire[44] ».
Enfin, en 1763, sept Bohémiens sont capturés par la maréchaussée des Trois-Évêchés qui instruira le procès à Metz. Une des Bohémiennes arrêtée, nommée Gertrude Bernard, est selon toute vraisemblance la sœur de Catherine Bernard. Elle prétend n’avoir jamais été attroupée qu’avec son neveu, sa nièce, ainsi que sa mère, Marie Barbe Maurice, décédée sept ou huit mois plus tôt. Ils parcouraient ensemble l’Alsace et le pays de Phalsbourg, mais elle se défend de mener la vie de Bohémienne ou d’avoir fait quelque tort à personne. Au cours de leurs pérégrinations dans le pays avec ses parents, cinq passeports leur avaient été délivrés à Strasbourg, Lunéville et Phalsbourg[45]. Bien que les âges qu’elle a donnés jusque là correspondent – 15 ans en 1740 et 22 ans en 1747 – elle déclare avoir 26 ans en 1763. Mais cette fois, elle avoue être reprise de justice : elle-même, son père, sa mère, et sa sœur (nommée Marguerite) avaient été arrêtés environ quinze ans plus tôt par les cavaliers de la maréchaussée. Conduits à Sarreguemines où on leur avait fait leur procès pour parcourir le pays, ils avaient été relâchés sans subir aucune peine[46].
On se rend bien compte, notamment au regard de ces cas – et plus généralement au travers de l’étude des procès de Bohémiens – de la physionomie fluctuante des groupes qui se forment et se déplacent selon deux principales modalités. D’une part, essentiellement en fonction des liens familiaux au moyen du jeu des parentés et alliances, comme on vient de le voir. Nicolas Laroche déclare d’ailleurs en 1733 s’être joint à la troupe d’Égyptiens ou de Bohémiens qui a été arrêtée – soit quatorze personnes – parce qu’ils « sont de ses parents ». En l’occurrence, sa sœur[47] et son beau-frère[48] sont prisonniers avec lui.
D’autre part, en fonction de facteurs économiques ou professionnels tels que les perspectives d’activité ou les métiers exercés. Beaucoup de Bohémiens participent à des activités saisonnières localisées comme la moisson, la fenaison. Par ailleurs, il n’est pas rare que les femmes gravitent autour des villes de garnison où stationnent leurs maris soldats, sans pour autant cesser de se déplacer. C’est notamment le cas de Catherine Bernard en 1747.
Le cas de la famille Bernard est donc particulièrement représentatif des procès de Bohémiens en Lorraine, dans la mesure où il rend d’abord très bien compte des modalités de déplacement circonstanciées des Bohémiens. Il lève en outre le voile sur les procédés utilisés par les Bohémiens pour tenter de se soustraire aux poursuites judiciaires. Ils évitent les grands chemins, et rendent leur identification difficile en utilisant de multiples patronymes qu’ils peuvent donner de façon plus ou moins concertée. La confusion autour de la personne de Catherine Bernard, y compris au sein même de son groupe familial, en atteste. Enfin, on y voit des Bohémiens porteurs de passeports témoignant de liens ou du moins d’une certaine tolérance de la part des autorités municipales et des populations locales.
L’importance du nombre de récidives dans les procès de Bohémiens et sa signification
Plusieurs facteurs concourent encore au nombre important de récidives. La Lorraine se trouve dans une situation particulière du fait de sa position géographique frontalière et de l’enchevêtrement des juridictions dans la région[49]. Cela permet aux Bohémiens, qui circulent et franchissent les frontières, de profiter de la protection de la part de certaines autorités[50] ou d’affirmer ignorer de bonne foi sur quel territoire ils se trouvent.
Une dernière question se pose : pour quels faits les prévenus déjà condamnés sont repris de justice ? Cela soulève la question plus générale des délits commis par les Bohémiens, ou plutôt ceux déterminant les poursuites à leur encontre et le cas échéant, leur jugement. Dans les cas où les délits ne sont pas avérés ou prouvés, les accusés sont en conséquence renvoyés de l’accusation et mis en liberté.
Les principaux faits délictueux sont l’infraction aux ordonnances, le vagabondage, la vie errante et libertine, l’infraction ou la rupture de ban, et les vols. À cet égard, les procès instruits contre les Bohémiens montrent que les larcins concernent pour l’essentiel des produits de première nécessité – à savoir de la nourriture sous diverses formes, par exemple des poules vivantes, du lard, etc., ou du linge et des vêtements – et qu’ils sont le fait de la pauvreté ou de périodes de non-activité[51]. Si l’on met en parallèle les nouveaux délits et les anciennes condamnations, on s’aperçoit qu’ils concernent en général les mêmes infractions, excepté quelques cas comme par exemple la contrebande de tabac[52].
Nous avons vu la multiplicité des textes répressifs concernant les Bohémiens ou Égyptiens. Pour autant et certainement de ce fait, la législation n’est pas exempte d’ambiguïtés et les peines apparaissent inadaptées. La littérature savante de la seconde moitié du XVIIIe siècle se penche d’ailleurs sérieusement sur cette question[53]. Le bannissement, ainsi très fréquemment prononcé à l’encontre des Bohémiens, trahit le statut équivoque de la « nation bohémienne », puisque conçu comme une peine pour les sujets domiciliés, sa mise en œuvre s’apparente alors à une interdiction de séjour au sein d’un ressort territorial.
En cas de capture d’un groupe de Bohémiens, le bannissement est quoi qu’il en soit collectif et place surtout les Bohémiens en infraction constante. Se met ainsi en place un « cycle errance-bannissement[54] », qui confère aux archives judiciaires le statut de source privilégiée quant aux travaux de recherche sur les Bohémiens d’Ancien Régime.
Quoiqu’il en soit, compte tenu des considérations portant sur le bannissement, on voit immédiatement les limites que peut atteindre ce type de sanction pour une population aussi mobile et transitant au sein de diverses aires géographiques au gré de déplacements néanmoins assez bien jalonnés.
De surcroît, le bannissement peut être utilisé dans certains cas par les juges comme une peine plus équitable que les galères, ce qui n’est pas sans conséquence sur la récidive éventuelle, bien au contraire. Le risque de récidive est en effet très faible en cas de condamnation aux galères en raison du fort taux de mortalité qu’on y trouve. On peut considérer que « la condamnation “à vie” est une condamnation à mourir à terme […] La condamnation “à temps” est un pari sur l’existence gagné par les plus résistants et les plus heureux[55] ». En l’état actuel de nos dépouillements, nous avons recensé seulement six condamnations aux galères en Lorraine entre 1721 et 1786. Il convient de nuancer ce faible nombre par le fait que la législation ducale, à la différence de celle du roi de France, ne prévoit pas la peine des galères pour les Bohémiens.
Un mouvement global d’adoucissement de la justice pénale au XVIIIe siècle[56] peut toutefois expliquer au moins en partie le choix de l’application quasiment systématique des peines les moins sévères parmi celles encourues, voire de peines moins sévères que celles encourues. Force est de constater que les dispositions répressives ne sont pas strictement appliquées par les magistrats puisqu’en l’état de nos recherches, nous n’avons trouvé aucune condamnation à mort pour infraction de ban ou pour récidive, même multiple, en dépit du fait que cette peine est prévue par de nombreux textes normatifs. La mise en perspective des conclusions du ministère public et des sentences prononcées montre là encore clairement la clémence des juges.
En tout état de cause, les magistrats ont à faire face à une réalité subtile et nuancée contrastant avec les textes péremptoires. Car malgré tout, les Bohémiens tissent des liens avec les populations locales qu’ils fréquentent, comme en témoignent les certificats et passeports[57] dont ils sont souvent porteurs.
Jules Admant
Centre Georges Chevrier
UMR 7366 uB/CNRS
(Sous la direction de Benoît Garnot et Pierre Bodineau)
[1] B. Schnapper, « La répression du vagabondage et sa signification historique du XIVe au XVIIIe siècle », Revue historique de droit français et étranger, Paris, Sirey, 1989.
Pour citer cet article :
Jules Admant, « Les repris de justice dans les procès de Bohémiens au XVIIIe siècle », Revue TRANSVERSALES du Centre Georges Chevrier - 7 - mis en ligne le 23 novembre 2015.
URL : http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/publications/transversales/Normes_et_Individu/J_Admant.html
Auteur : Jules Admant>
Droits : © Tous droits réservés - Ce texte ne doit pas être reproduit (sauf pour usage strictement privé), traduit ou diffusé. Le principe de la courte citation doit être respecté.