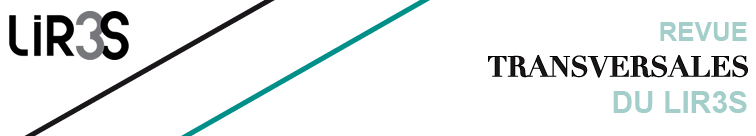
Espace
urbain, espace de vie.
Pratiques
artistiques autour de la cartographie de la ville
Le cadre urbain constitue aujourd’hui le contexte d’investigation privilégié par certains artistes contemporains choisissant le déplacement et la cartographie comme moyens d’expression. En intégrant le mouvement comme activité motrice et mentale, leurs réalisations interrogent le concept de l’espace urbain à travers ses cartes. Issue des différents gestes artistiques tels que l’errance ou la déambulation urbaine, mais aussi la collecte et l’écriture, la cartographie expérimentale résultant de ces pratiques côtoie les conventions de représentation et les nouvelles technologies du géo-référencement. Cet article propose de réunir quelques exemples du travail d’artistes contemporains intéressés par l’espace urbain et d’y distinguer les méthodes d’approche de la ville dans des perspectives singulières et non conventionnelles.
Les changements radicaux de l’art de la fin des années 1960 ont instauré notamment un nouveau traitement de la notion d’espace dans les pratiques artistiques. Désormais, son concept instauré non pas (ou pas seulement) au sein des œuvres se voit examiné par l’exploration conduite en dehors des ateliers et par le déplacement des artistes eux-mêmes[1]. En privilégiant la mise au point d’une relation individuelle avec le lieu, certaines de ces pratiques s’entremêlent aujourd’hui avec la vie personnelle de l’artiste, pour lequel la ville constitue à la fois le domicile et le terrain d’une exploration quotidienne. Ainsi, le travail de Dan Belasco Rogers, artiste d’origine anglaise, consiste à enregistrer depuis 2003, à l’aide de la technologie GPS[2], ses trajets quotidiens dans Berlin où il vit. Grâce au caractère automatique de la géolocalisation, tous ses déplacements sont pris en compte en temps réel. The Daily Practice Map Making, dont la durée s’élève à six ans, se compose d’une série de dessins cumulant des données rassemblées pendant toute la période concernée, présentant les étapes consécutives du projet, depuis la première qui résulte d’un an d’exploration de la ville. Les images font apparaître les parcours sous forme de tracés noirs sur fond blanc. Si la quantité de lignes, et donc la densité de ses représentations, est liée au nombre de voyages, toute la série témoigne d’une pénétration de l’espace, de plus en plus importante avec l’augmentation du temps. Puisqu’il est impossible de sortir des rues, des places, des espaces privés ou publics, la transcription du parcours, représente en effet les parties de la ville elle-même, en lui substituant des trajectoires et des traces, autour des axes et des grands ensembles d’aménagement.
S’emparant de la technologie GPS, devenue d’un usage populaire à partir des années 1990, le travail de Dan Belasco Rogers suscite pourtant une réflexion sur les enjeux qui caractérisent chaque transposition cartographique. L’opération consistant à errer dans l’espace urbain, autrement dit l’activité d’un passant dans la rue, doit être, afin de devenir lisible sur une carte, transformée par la transposition géométrique. Chaque élément du parcours effectué en points, reliés par des lignes, incarne la continuité spatio-temporelle de la démarche, mais la carte elle-même fait disparaître l’acte de marcher caché derrière une série de dessins abstraits. Ce pouvoir de métamorphose qui est au cœur du projet de Belasco fait ressortir de manière amplifiée la nature réductrice d’une quelconque représentation cartographique. Ici dépourvue de coordonnées géographiques, la carte de Berlin devient une image abstraite n’indiquant aucun lieu précis, sauf l’itinéraire qui nous mène d’un point inconnu à un autre. Si le travail de l’artiste réactualise ainsi notre façon de concevoir la spatialité à l’ère numérique du géoréférencement, il démontre également comment chaque cartographie transforme l’agir en lisibilité et, pour paraphraser Michel de Certeau, fait oublier l’acte qui l’a rendue possible[3].
Si les pratiques artistiques autour de la cartographie du territoire se caractérisent avant tout par leur dimension subjective, elles se manifestent au moment où le déplacement est représenté en dehors du système préalablement défini par les coordonnées géographiques. Allant à l’encontre de nouvelles méthodes de transcription, les artistes s’emparent de différents types de notation, afin de placer l’opération même de l’exploration au cœur de leur œuvre. Si chacun a une perception particulière des lieux qu’il traverse, selon l’état d’esprit du moment, selon la fréquence d’utilisation, un même endroit peut générer des images et des imaginaires radicalement différents chez deux personnes suivant le même chemin. Chacun aussi a ses manières de transcrire, dessiner, formuler les représentations mentales et les sensations survenues dans son espace de vie. L’artiste Mathias Poisson en emploie plusieurs, par sa pratique en tant que danseur et scénographe.
Dérivant d’une démarche empirique qui consiste à transcrire les promenades effectuées au sein du territoire urbain, ses cartes invitent à reconsidérer le déplacement selon les principes de la perception de l’espace à travers le corps en mouvement. Elles s’apparentent à des partitions, en faisant paraître les terrains perçus dans le dessin où l’architecture, la signalétique et le paysage naturel construisent l’espace ; l’ensemble est organisé par un rythme que suggèrent les différents moments du voyage. L’artiste tient également compte du relief, ainsi que de la divergence d’éléments et de perspectives dans lesquels les différents objets rencontrés lors de la promenade, apparaissent au marcheur. Son langage graphique retranscrit ainsi l’espace, en grossissant certains éléments perçus ou en en éliminant d’autres, en tenant compte des sensations et des formes perçues, telles qu’elles sont memorisées au cours d’un voyage.
Ayant effectué plusieurs cartes de promenades depuis 2006, Mathias Poisson a récemment fondé une Agence Touriste, qui propose d’inventer et de pratiquer un tourisme singulier, pour explorer des territoires méconnus comme les quartiers sans monuments, les périphéries de villes ou des lieux abandonnés. Puisque marcher dans la cité moderne, où tous les moyens de locomotion rapide sont constamment en promotion, permet de retrouver un regard plus attentif à la rue, cet acte porte également une dimension politique importante. C’est ainsi que l’artiste-marcheur n’est pas seulement le performer, mais qu’il se montre d’abord comme un individu, mobile par essence, dont les pérégrinations fondent ou du moins influencent fortement les réalisations. Et si le déplacement dans toute son ampleur engage également la dimension psychique et fantasmatique de la marche, l’artiste doit beaucoup, contrairement à un arpenteur de territoire, au personnage du flâneur baudelairien, qui choissit le nomadisme par son ouverture d’esprit et son orientation vers la vie urbaine et son rythme.
L’errance urbaine tente de faire apparaître la ville, à travers ses méandres et ses périphéries découverts au gré de parcours improvisés, et d’en produire de nouvelles cartographies, capables de briser l’image conventionnelle de la ville – une image de la métropole dont la tradition a réduit la complexité de l’espace urbain à une représentation homogène et géométrique. Si la tradition historique veut que les plans des villes soient toujours représentatifs, la convention présuppose l’emploi de la cartographie « exacte » et précise, apte à visualiser l’ensemble de l’espace ainsi donné à saisir dans sa totalité. Dans l’histoire de la cartographie, plus un plan urbain s’apparentait à une image synthétique du terriroire, proche d’une photographie à vol d’oiseau, plus il était précieux et représentait dignement la ville. Planisfera Roma possède a priori toutes ces caractéristiques. Elle résulte d’un voyage expérimental effectué pendant trois jours consécutifs, en octobre 1995, par les membres du groupe italien Stalker. La déambulation en ville a consisté à faire une boucle de 70 kilomètres et à donner naissance à une nouvelle carte de la capitale italienne. La ville elle-même y est signalée en jaune, les terrains vagues en bleu, tandis que le parcours accompli est indiqué par une ligne continue et des pointillés blancs. Mettant en évidence qu’une carte n’est pas le territoire, cette carte unique de Rome démontre comment l’usage des conventions de couleurs transforme l’image de l’espace représenté. L’imaginaire de l’eau fait apparaître la ville comme un territoire fluide et en perpétuel mouvement, parsemé d’archipels organisés. A l’inverse de la tradition qui présuppose qu’une image représentative mette en valeur l’espace urbain entièrement organisé et construit autour de grandes artères et de quartiers principaux, Planisfera Roma métamorphose la métropole en mer, sans coordonnées stables, où les terrains vagues composent, comme sur la carte du monde, la majeure partie du territoire représenté.
La cartographie de Rome souscrit ainsi au modèle des plans psychogéographiques des grandes cités, dont la pratique est inaugurée dans les années 1950 au sein du Situationnisme. Emanant à l’époque un peu comme la science-fiction de l’urbanisme, la psychogéographie, selon la théorie publiée en 1955 dans L’Internationale Situationniste n°2 de Guy Debord, a remis en question le caractère idéologique de la géographie urbaine, en lui reprochant de vouloir générer une conception du monde qui ne soit pas celle d’un individu[4]. Les situationnistes, qui publient en 1957 la carte détournée de Paris, réclamaient ainsi pour la première fois, la nécessité de réaménager la ville et s’intéressaient surtout à la manière dont ses habitants se l’appropriaient.
Le Guide psychogéographique de Paris faisait initialement partie d’une sélection de cinq plans réalisés par Debord pour la Première exposition de psychogéographie organisée à la galerie Taptoe à Bruxelles en février 1957. Ayant pour but de briser la convention de représentation officielle, l’artiste a littéralement découpé le plan de la ville édité en 1951 par Georges Peltier, lui-même inspiré par une autre image de Paris, le plan commandé par Michel-Etienne Turgot en 1734 et qui a servi à promouvoir l’image de Paris auprès des élites de du XVIIIe siècle. La carte-collage, portant le sous-titre Discours sur les passions de l’amour, orne aujourd’hui la couverture de nombreux livres sur le Situationnisme et fonctionne comme emblème du groupe. Elle divise Paris en dix-neuf « unités d’ambiance » urbaines, avec leurs défenses, les entrées et les sorties, reliés par les flèches, suggérant les pentes. La carte invite avant tout à explorer l’espace sans s’en tenir à son image, au profit d’une expérience directe, dans la ville elle-même.
Publiée également en 1957 dans la revue Internationale Situationniste (n° 2), la Théorie de la dérive fonctionne dans ce contexte comme une méthode qui, par son caractère ludique, s’oppose en tous points aux notions classiques du voyage et de la promenade, par le manque de destination préalable. C’est un véritable acte de l’errance urbaine, un mode de comportement expérimental, voire une technique du passage hâtif à travers des ambiances variées à l’intérieur de la ville, par lesquels les artistes s’opposent à la cartographie préalablement définie en incitant à suivre le rythme propre au territoire. Définissant ainsi l’espace urbain comme un terrain qui doit être étudié par le déplacement réel, à l’intérieur de la ville, le guide psychogéographique de Paris incarne l’opposition entre voyeur, observateur et marcheur qui, au lieu de se contenter d’observer, va se laisser porter par les différentes ambiances urbaines.
L’un des rares exemples d’essai psychogéographique, signé par un certain Abdelhafid Khatib, comporte quelques remarques sur le quartier des Halles à Paris. Khatib aligne une série d’observations banales comme : « Autour du square des Innoncents se maintient une population de clochards. L’ensemble de cette zone est déprimant . Au nord des Halles, Khatib découvre « une intense activité du commerce alimentaire de détail et une importante implantation administrative[5] ». Une autre tentative de Ralph Rumney d’effectuer un relevé psychogéographique de Venise n’a malheureusement pas apporté de véritables exemples d’application de la théorie. La décennie suivante se caractérisa par l’absence de propositions nouvelles et, en tant que telle, la psychogéographie fut vite oubliée au sein du mouvement situationniste. Elle constitue néanmoins aujourd’hui une partie de l’héritage réactivé depuis les années 1990 de l’autre côté de l’Atlantique.
Christian Nold, dont les projets numériques se déploient autour des grandes métropoles américaines, mais également européennes, doit beaucoup à l’approche psychogéographique du terrain urbain, notamment par la manière dont il y distingue les zones d’ambiances ayant une influence sur le comportement des habitants. Depuis 2007, le projet BioMapping met en place un dispositif GPS qui enregistre des localisations temporelles et spatiales en un Galvanic Skin Response (GSR) captant des données biométriques en évaluant la résistance électrique de la peau. Proche d’un détecteur de mensonges, ce dispositif restitue un certain état émotif, sans pouvoir distinguer les différents types d’émotions ressenties. Equipés d’un tel système, les participants des workshops parcourent les villes. Tout au long du parcours, les coordonneés GPS et les données affectives sont transmises toutes les 4 secondes à un serveur et s’inscrivent en temps réel sur une carte Google Earth[6]. Les déplacement sont représentés par des lignes, les émotions visualisées par des pics et colorées en fonction du ressenti. Si, en effet, la mise en œuvre de différentes technologies facilite la collecte de données, le véritable travail sur la psychogéographie caractérise la deuxième étape du projet, pendant laquelle les participants décrivent les sensations éprouvées lors de l’exploration en essayant d’en identifier les raisons.
Toutes ces données produisent ainsi une cartographie capable de représenter la ville à partir de critères autres que physiques ou visuels, puisqu’elles tentent d’intégrer l’aspect émotionnel de l’exploration. Si les premières expériences BioMapping s’appuient encore sur une cartographie conventionnelle qui prend la forme d’une carte Google Earth sur laquelle le parcours capté s’inscrit, les expériences plus récentes appelées Emotion Map éliminent toute carte préexistante. Le résultat est une hybridation entre subjectivité et espace physique. Cette articulation permet également de rendre visible l’espace urbain de plus en plus instable et changeant.
Prenant comme point de départ la définition d’une ville entendue comme terrain d’interactions et de relations humaines, les artistes tentent d’inventer de nouvelles cartographies urbaines capables de rendre cette complexité visible sur un support qui peut également évoluer dans le temps.
Le projet de Jake Barton, City of memory, qui existe aujourd’hui essentiellement sous forme numérique et accessible sur Internet, résulte d’une série de happenings intitulée Memory maps, créée en 2001. Sa première version, proposée à l’occasion d’un festival Folklife, a été installée dans un parc public à Washington D.C., accueillant environ un million des visiteurs participant à cet événement. Pendant la durée du festival, Barton a construit une sorte de tente, à l’intérieur de laquelle il a accroché plusieurs cartes topographiques représentant les différents quartiers de la ville de New York. Une fois entrés dans le dispositif, les visiteurs étaient invités à écrire des histoires liées aux endroits qu’ils reconnaissaient sur la carte. A l’aide de fiches, ils pouvaient ensuite intégrer leurs propres récits à l’image de la ville, permettant aux autres de lire ce qui leur était arrivé ou de leur rappeler des lieux particuliers à New York[7].
Suscitant à la fois le travail d’écriture, de lecture et un exercice de mémoire, Jake Barton a proposé de créer ce grand dispositif cartographique qui fonctionnait, pendant toute la durée du festival, comme une sorte de mémoire collective incarnée par ce lieu où chacun peut s’exprimer et partager ses expériences ou ses souvenirs. Les visiteurs pouvaient lier leurs histoires par des thèmes, en créant des « voisinages » sur la carte, tout cela étant accessible et visible par les autres. La carte collective, aujourd’hui disponible sur le serveur Internet, est constamment modifiée par l’interaction de récits et symbolise le processus de production d’espace urbain, qui consiste à tisser des liens avec la ville, à travers des expériences communes, des rencontres et des situations par lesquelles un territoire est accessible et transformé en espace de vie.
Les pratiques artistiques, qui visent aujourd’hui avant tout à s’opposer à la cartographie préalablement définie, propagent ainsi une forme d’exploration urbaine qui relève de différentes expériences quotidiennes. La relecture des plans urbains, opérée dans le cadre de tous ces projets, permet ainsi de les activer en tant que formes de création mentale, en les définissant comme des sources potentielles de souvenirs et de réflexion. Pour cette raison, la cartographie pratiquée par l’art contemporain s’avère plutôt dysfonctionnelle si l’on veut s’en servir pour s’orienter dans la ville réelle. La diversité des approches, ainsi que la participation active des habitants à l’enjeu de la création cartographique, enrichissent toutefois les œuvres en les transformant en actions sociales. A la pluralité des perspectives répondent aussi les œuvres plus personnelles invitant à retracer les traversées sensibles du territoire, pour rappeler qu’il est pluriel et reste toujours à découvrir.
Aleksandra
Stanczak
Centre
Georges Chevrier,
UMR 7366 CNRS-uB
(sous la direction de Bertrand Tillier)
[1] Thierry Davila, Marcher, créer. Déplacements, flâneries, dérives dans l’art de la fin du XXe siècle, Paris, Editions du Regard, 2002, p.16-17.
Pour citer cet article :
Aleksandra Stanczak, « Espace urbain, espace de vie. Pratiques artistiques autour de la cartographie de la ville », Revue TRANSVERSALES du Centre Georges Chevrier - 3 - mis en ligne le 12 mai 2014.
URL : http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/publications/transversales/Habiter_espace/A_Stanczak.html
Auteur : Aleksandra Stanczak
Droits : © Tous droits réservés - Ce texte ne doit pas être reproduit (sauf pour usage strictement privé), traduit ou diffusé. Le principe de la courte citation doit être respecté.