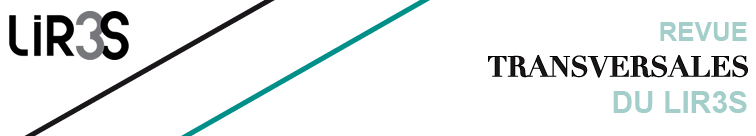
Où le distrait a-t-il
la tête ?
Étude de la figure du
distrait dans « Le Rire » de Bergson
Le Rire[1] d’Henri Bergson est publié en 1900, la même année que L’interprétation des rêves[2] de Freud. Le « moment 1900 », selon l’expression de Frédéric Worms[3], correspond à la manifestation de deux des ouvrages les plus emblématiques de deux penseurs qui vont considérablement marquer le siècle à venir. L’œuvre de Freud va avoir un retentissement considérable sur le XXe siècle et celui-ci va justement attendre l’année 1900 pour publier son ouvrage afin de montrer qu’il va ouvrir une nouvelle ère dans le domaine de la psychologie. Celui de Bergson va certes contribuer à sa « gloire » (François Azouvi a montré dans un ouvrage récent[4] qu’il est le premier philosophe à connaitre une renommée quasi mondiale) par sa simplicité et son caractère très accessible, alors que ce n’est pas le cas de L’interprétation des rêves dont la longueur, la technicité et l’aspect aride vont décourager les lecteurs d'abord séduits par le titre (l’éditeur de Freud lui demandera une sorte de résumé destiné à être lisible par le plus grand nombre, ce sera Le rêve et son interprétation[5] l’année suivante, texte dont la brièveté lui permettra de trouver un large public qui contribuera fortement au succès à venir de la psychanalyse). Il ne s’agit pas ici de comparer les doctrines des deux auteurs en général, malgré ce que cela pourrait avoir de passionnant et de fécond, notamment en ce qui concerne le rire et l’humour (thème qu’ils ont traité tous les deux dans des ouvrages séparés, ce qui montre bien l’importance qu’il convient selon eux d’accorder à ce thème) mais de parler d’abord de la manière dont une œuvre, par sa clarté et la banalité apparente de son thème, peut donner lieu à des mécompréhensions alors même qu’elle rencontre un large public. Car le succès du Rire va contribuer à rendre sa lecture très difficile dans le milieu universitaire, plus exactement à laisser croire que ce n’est pas un objet digne d’étude, en raison de sa forme très simple ainsi que de son sujet aussi anodin qu’inhabituel en philosophie. Parmi les principales critiques qui ont été faites à l’ouvrage, on retrouve le manque de profondeur philosophique, à cause justement de la simplicité du propos, de l’absence de termes techniques voire hermétiques, ainsi bien sûr que le caractère prosaïque de son objet (trop éloigné des « vraies » questions métaphysiques qui porteraient sur Dieu, l’âme, le sens de la vie…).
Il y a selon nous dans ces reproches, de manière implicite, une conception scolastique de la philosophie. Bergson montrera dans La pensée et le mouvant[6] que l’activité philosophique ne consiste pas à hériter de problèmes tout faits et donc d’objets a priori pour choisir entre des options toujours données à l’avance, mais à savoir créer le problème – en même temps que sa possible solution – à l’occasion de l’analyse spécifique, sui generis, d’une question quelconque, ce qui est possible quel que soit l’objet d’étude. Bergson montre que le rire est un problème philosophique qui peut être aussi important que Dieu ou l’homme si la philosophie se donne pour ultime objet d’analyse de répondre à la question de l’homme dans son rapport au monde.
Nous allons donc essayer de montrer que les reproches – disons, pour résumer, de superficialité – ne sont pas fondés, en nous appuyant sur la figure du distrait dans l’œuvre de Bergson. Le distrait provoque bien sûr le rire, et Bergson l’analyse justement dans cette optique, mais ce personnage central du comique montre aussi les limites du rire. Car le rire a un rôle qui se mesure à son effet normatif et prescriptif : il fonctionne comme un rappel à l’ordre. Si le rire s’applique avec raison à celui qui fait preuve de distraction, le distrait, par un effet en retour, montre les faiblesses et les insuffisances voire la cruauté du rire devant ce qui peut le dépasser : la singularité d’un individu qui a un comportement vraiment désintéressé donc en décalage avec la société, voire inapte à la vie sociale. C’est ce caractère ambivalent du rire que nous voudrions souligner à travers la figure du distrait.
Philosopher sur le rire
On a parfois critiqué le caractère désuet de l’ouvrage en le limitant à une formule emblématique et simple à retenir : « du mécanique plaqué sur du vivant ». En réalité, une lecture attentive révèle immédiatement, c’est-à-dire dès la préface, que la célèbre définition bergsonienne du comique n’est justement pas une « définition », du moins pas au sens où l’entendent d’ordinaire les philosophes, les psychologues ou les critiques, qui prétendent cerner la nature et les effets du comique.
Car Bergson ne procède pas ainsi. Il propose une méthode qui taille « sur mesure », qui suit les « lignes de faits » et étreint si bien son objet qu’elle serait à même de le réengendrer. Au lieu de chercher les propriétés communes aux effets comiques pour les enfermer dans une formule simple, ou, ce qui ne vaut guère mieux, de combiner ces propriétés au gré des circonstances et des contextes (le « dispositif comique », ses configurations et ses relations changeantes, tenant alors lieu de caractérisation pour un genre dont on a renoncé à définir l’essence), elle cherche les « procédés de fabrication du comique ». Bergson l’annonce dans sa préface : « [N]otre méthode, qui consiste à déterminer les procédés de fabrication du comique, tranche sur celle qui est généralement suivie, et qui vise à enfermer les effets comiques dans une formule très large et très simple[7]. » Et plus loin, dans le second paragraphe du premier chapitre : « Notre excuse, pour aborder le problème [du rire] à notre tour, est que nous ne viserons pas à enfermer la fantaisie comique dans une définition[8]. », page 28 enfin : « […] il serait chimérique de vouloir tirer tous les effets comiques d’une seule formule simple. La formule existe bien, en un certain sens ; mais elle ne se déroule pas régulièrement. Nous voulons dire que la déduction doit s’arrêter de loin en loin à quelques effets dominateurs, et que ces effets apparaissent chacun comme des modèles autour desquels se disposent, en cercle, de nouveaux effets qui leur ressemblent[9]. »
Lorsqu’une page plus loin apparaît pour la première fois (bien tardivement donc) l’énoncé fameux concernant le plaquage du mécanique sur le vivant, Bergson prend bien soin de préciser qu’il s’agit là d’une « image centrale d’où l’imagination rayonne dans des directions divergentes[10] ». Une image, donc, certainement pas une définition, ni même à vrai dire une formule. Tout au plus une impulsion, l’indication d’une direction ou d’une multiplicité de directions dans lesquelles il faudra tour à tour chercher les schémas ou modèles opératoires qui livreront une explication adéquate, pour parcourir ensuite tous les degrés du comique, du plus bas au plus haut, sans en annuler la variété.
Il faut dire en effet que le rire est un objet d’étude très sérieux et très complexe. Dès le début du livre, Bergson insiste sur le décalage entre cet apparent « petit problème » et « l’impertinent défi »[11] qu’il n’a cessé de lancer à la spéculation philosophique et aux plus grands penseurs. Si le rire provoqué à l’occasion du comique a de l’importance, c’est qu’il n’est pas gratuit et ne peut être réduit à un pur plaisir désintéressé. Il faut le traiter avec tout le respect que l’on doit à la vie dit l’auteur dès la 1ère page, et l’on sait que ce sera l’un des grands objets de sa recherche philosophique, et pas seulement avec l’ouvrage majeur à venir en 1907 L’évolution créatrice[12], et que ce sera aussi l’un des grands reproches qu’il fera aux philosophes : d’avoir généralement manqué la spécifité et la complexité du vital en s’en tenant à des cadres trop rigides issus de la seule intelligence. Il y a une finesse dans Le rire qui se lit déjà dans le style et les images adoptées par l’auteur, et qui suggère bien que cet objet, banal du point de vue de l’existence et atypique pour la spéculation, risque constamment de se dérober à l’analyse si nous ne fournissons pas l’effort particulier qu’il demande. Bergson sait très bien qu’expliquer la signification du rire n’est pas très amusant, et on peut même dire que lorsqu’on en comprend le sens « il n’y a pas de quoi rire » (comme le montrent les dernières lignes sur lesquelles nous reviendrons), mais en plus l’intelligence, en raison de son regard analytique et de sa destination pratique, constitue souvent un obstacle très puissant à la saisie de ces réalités simples dont le rire offre un excellent exemple.
Rire de la distraction : la fonction normative
Le personnage du distrait nous semble être une excellente porte d’entrée pour saisir la spécifité du mécanisme du rire en général et de l’ouvrage de Bergson en particulier.
Depuis les débuts de la philosophie, on sait que la distraction provoque le rire. Et l’on sait aussi que celle du philosophe provoque particulièrement le rire au point d’être devenue légendaire. Platon, dans le Théétète, rapporte l’anecdote selon laquelle Thalès regardait les étoiles lorsqu’il est tombé dans un puits, ce qui provoqua un immense éclat de rire chez une servante thrace qui assistait à la scène[13]. Aristophane va écrire Les Nuées[14] pour railler le philosophe, notamment son contemporain Socrate, inaugurant ainsi un lieu commun – qui aura une immense postérité – sur le penseur qui vit dans les nuages parce qu’il s’intéresse à des réalités intelligibles et métaphysiques, et n’arrive pas à prendre en compte ce qu’il a devant les yeux. Platon connaît tellement bien cette doxa que lorsque, dans l’allégorie de la caverne, le philosophe redescend dans la caverne, il est raillé et moqué par la foule des prisonniers alors même qu’il vient pour tenter de les aider. Cette situation illustre tout à fait la formule de Bergson dans Le Rire : « quiconque s’isole s’expose au ridicule[15] ». Car le rire provoqué par le distrait met en lumière la fantaisie comique telle que le penseur français va la mettre en lumière dès le début du livre : le rire a rapport à l’humain, il s’adresse à l’intelligence (plutôt qu’aux sentiments, il implique même une certaine absence d’empathie) et a une fonction sociale. La distraction va même apparaitre progressivement comme la cause fondamentale du rire : à travers les différentes formes de comique que Bergson analyse (le comique des formes et des mouvements dans le premier chapitre, puis le comique de situation et de mots et pour finir le comique de caractère), ce sont autant de manifestations d’une certaine distraction que le penseur met en lumière. Et si « toute distraction est comique[16] » comme il l’écrit au troisième chapitre, il semble bien que l’inverse soit vrai : tout comique est de distraction.
« Le comique des évènements peut se définir une distraction des choses, de même que le comique d’un caractère individuel tient toujours […] à une certaine distraction de la personne[17] » écrit Bergson et il ajoute un peu plus loin, que le comique de mots « souligne les distractions du langage lui-même[18] ». Les différentes espèces de comique sont autant de variantes sur le thème de la distraction.
Mais on peut se demander : qu’est-ce que la distraction peut bien avoir d’essentiellement comique ? Pourquoi constitue-t-elle l’objet privilégié, sinon exclusif, du rire ? C’est ici que les analyses de Bergson rejoignent les thèses métaphysiques et psychologiques de Matière et mémoire[19] publié quatre ans auparavant : Bergson y montrait que l’équilibre mental suppose que l’esprit soit en quelque sorte lesté par le corps et que la masse immense des souvenirs soit utilisée et contractée afin d’éclairer la situation présente. Ce phénomène par lequel la mémoire quitte ce qu’il appelle le « plan du rêve » et rejoint « le plan de l’action », est ce qui rend possible « l’attention à la vie »[20]. La santé psychologique n’est pas autre chose, mais elle représente un équilibre facile à troubler et qui doit sans cesse être retrouvé par un effort adéquat. C’est ce que Bergson nomme le « bon sens » : un sens pratique, une sorte d’entre-deux mouvant entre ces deux extrêmes que sont l’impulsivité d’une part (caractérisant celui qui ne vit que dans un présent stupide) et la rêverie (de celui qui ne vit que dans le passé et l’imaginaire).
Lorsque l’on quitte cet entre-deux, c’est alors que le rire se manifeste. Son utilité biologique et sociale se manifeste : le rire signale la perte de cette attention à la vie et met en évidence le fait qu’un mécanisme autonome s’est plaqué sur elle. En riant, le spectateur remet en quelque sorte dans le droit chemin du bon sens celui qui s’en éloigne. Il s’agit de faire en sorte, par le biais du rire, que le distrait ne le soit plus et qu’il se remettre à vivre et agir efficacement. Voilà pourquoi le rire porte avant tout sur la distraction pour Bergson. C’est comme si à travers lui la nature nous disait « Attention ! Ton comportement risque de te poser des problèmes en tant que vivant et en tant qu’animal social ! Il faut que tu changes de conduite rapidement ! » C’est bien d’abord d’un « réflexe vital et social » dont il s’agit, réflexe largement inconscient quant à son origine et sa signification chez la majeure partie des hommes. Et même si le rire est protéiforme, même s’il connait des degrés extrêmement variés et une diversité culturelle qui le rend très difficile à cerner, il ne fait aucun doute pour l’auteur que c’est l’inattention à la vie et en particulier à la vie sociale qui constitue son objet propre. C’est la société donc qui rit en nous (voir les p. 4-6), ce que Bergson appelle le « moi social » et qui rappelle chacun à son moi social. Bergson ne semble donc reprendre le célèbre adage latin selon lequel « castigat comoedia mores », qui fixe une finalité morale au rire, que pour subordonner cette finalité à une finalité sociale qui reste prédominante. Il ne s’agit pas tant de corriger le distrait pour le rendre plus vertueux que de le ramener à la norme du groupe dont il s’est écarté. Ce n’est pas la vertu d’Alceste qui le rend aussi risible mais c’est bien davantage son intransigeance et sa radicalité qui le poussent à devenir solitaire et trop atypique. Alceste se singularise trop pour ne pas être risible. Et c’est là que le rire trouve justement ses limites.
Ce que le distrait dévoile du rire
On s’étonne parfois de trouver les plus belles pages de Bergson sur l’art dans Le Rire. Elles se trouvent dans la dernière partie du livre lorsqu’il traite du comique de caractère[21]. Car celui-ci occupe une place tout à fait singulière dans le domaine de l’art : l’art vise en effet à déchirer les médiations que notre perception habituelle interpose entre le réel et nous-même (en nous ou hors de nous) et réussit à atteindre l’individualité des choses que nous ne pouvons sentir en temps normal, étant donné notre constitution biologique. Or la comédie de caractère, afin de provoquer le rire, s’en tient à des types généraux. Les personnes ne sont risibles en effet que si elles se conforment, réellement ou en apparence, à un cadre préexistant (l’avare, le pédant…) : par une sorte de distraction à l’égard d’elles-mêmes, elles se conforment à un genre ou un type qui peut s’appliquer à de nombreux individus. Comme le dit l’auteur : « il est comique de se laisser distraire de soi-même. Il est comique de venir s’insérer […] dans un cadre préexistant[22] ». Le personnage comique s’oublie lui-même, perd son bon sens et donc l’attention nécessaire – mais difficile – à soi et aux choses, et le rire est là pour tenter de lui faire retrouver ce sens pratique comme on l’a vu précédemment.
Mais, en même temps, vivre c’est justement s’en tenir à un certain niveau de généralité : la simplification et la généralisation sont non seulement utiles et suffisantes dans la pratique mais une trop grande attention à ce que les choses ont d’unique nous rendrait bien moins efficace et pourrait même nous être nuisible. Et c’est justement ce qui caractérise l’artiste : « une manière virginale de voir, d’entendre ou de penser » et donc une « pureté de perception qui implique une rupture avec la convention utile, un désintéressement inné […], une certaine immatérialité de vie »[23]. L’artiste est donc un distrait au sens courant du terme, peu à l’aise avec les conventions et les préoccupations quotidiennes (« ses ailes de géant l’empêchent de marcher » comme dit Baudelaire), c’est le contraire de l’homme d’action, de l’homme d’expérience, de l’homme d’affaires ou encore du politique. Bergson va même jusqu’à dire de ces personnes atypiques que sont les grands artistes (et cela vaut aussi pour les grands savants et les philosophes) qu’ils sont des distractions de la nature : celle-ci a en quelque sorte oublié de rattacher la perception à la saisie de l’utile. Dès lors, ces heureuses distractions de la nature sont privilégiées pour voir les choses telles qu’elles sont et ainsi être à même de les montrer au commun des mortels. Mais leur singularité, source d’un isolement plus ou moins important, les rend aussi risibles. Et c’est là où le rire montre justement ses insuffisances.
Face à des natures à ce point supérieures aux autres hommes, et indispensables à l’humanité, le rire s’en tient au plus superficiel en restant borné à sa finalité sociale. On peut bien sûr rire de ce que Socrate, Vermeer ou Newton, par exemple, ont d’atypique, mais cela risque de nous maintenir satisfaits dans la torpeur de nos habitudes intellectuelles, dans une sorte de bêtise crasse, satisfaite d’elle-même puisqu’elle a l’avantage du nombre. Ces natures singulières sont atypiques « par le haut », comme la morale ouverte des deux sources surpasse la zone mitoyenne de la morale sociale faite d’obligations et de normes intégrées à nos habitudes de vie en commun. Si elles nous dérangent, c’est de façon tout à fait légitime : en troublant nos repères habituels, ces individualités d’exception permettent de montrer ce que ces mêmes repères pouvaient avoir d’archaïques voire de sclérosés. Les grandes individualités nous invitent à dépasser les valeurs grégaires, et à nous dépasser nous-mêmes en renouant avec notre moi profond. C’est ainsi que « l’appel du héros moral », selon Les deux sources de la morale et de la religion[24] peut et doit trouver un écho au fond de chacun d’entre nous. Le rire, manifestant une sorte de contraction du moi social effrayé par ce qui pourrait se dévoiler d’imprévu « jusque chez le rieur lui-même », se tient ainsi dans une région médiane, médiocre au sens étymologique, et ne permet pas de saisir les plus grandes œuvres de l’esprit dans ce qui fait leur valeur ni les personnalités dans ce qu’elles peuvent avoir de plus singulier. De ce point de vue, il a une fonction similaire au langage telle que Bergson la théorise dans son œuvre : aussi utile dans le développement de l’espèce humaine, dont les principales caractéristiques sont l’intelligence et la sociabilité, qu’insuffisant et inadéquat pour saisir la réalité singulière des choses et des êtres. Sans doute est-ce la raison pour laquelle les dernières lignes du rire sont-elles emplies d’une certaine amertume (c’est le mot qui termine le livre). Cette tonalité pourrait surprendre aussi bien ceux qui s’attendent à ne trouver qu’un propos positif voire amusant sur un thème aussi plaisant, comme ceux qui n’attendaient qu’un propos superficiel sur ce thème anodin.
Lionel Astesiano
Centre
Georges Chevrier,
UMR7366
CNRS-uB
(Sous
la direction de Pierre Guenancia)
[1] H. Bergson, Le rire : essai sur la signification du comique, Paris, Quadrige/PUF, 2007.
Pour citer cet article :
Lionel Astesiano, « Où le distrait a-t-il la tête ? Étude de la figure
du distrait dans Le Rire de Bergson », Revue TRANSVERSALES du
Centre Georges Chevrier - 4 - mis en ligne le 12 novembre 2014.
URL : http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/publications/transversales/Fonctions_du_rire/L_Astesiano.html
Auteur : Lionel Astesiano
Droits : © Tous droits réservés - Ce texte ne doit pas être reproduit (sauf pour usage strictement privé), traduit ou diffusé. Le principe de la courte citation doit être respecté.