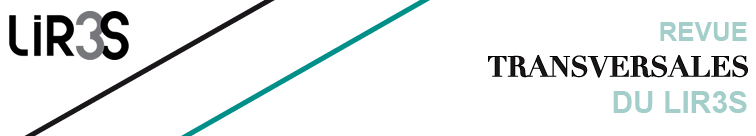
Usage(s) politique(s) de la parodie chez Eduardo Arroyo,
Equipo "Crónica" et les Malassis
Au cœur d'un jeu de référence et de citation, le rire parodique naît d'un décalage entre deux plans, d'un écart entre l'œuvre parodiée et sa parodie, entre l'identité du parodié et celle du parodiste. Pour être pleinement comprise, la parodie requiert la compétence de son public à effectuer une double lecture, qui s'appuie principalement sur la reconnaissance et l'identification de l'œuvre source. Ainsi, elle peut être vue comme une pratique élitiste, une forme d'exercice cultivé à l'adresse d'initiés, l'appartenance à une même communauté de références conditionnant la connivence entre l'artiste et son public. Par son fonctionnement, la parodie est rattachée, à raison, au grand ensemble de l'art réflexif et interréférentiel. En se faisant à la fois nouvelle création et regard sur l'œuvre d'un autre temps et d'un autre artiste, elle offre une réflexion sur l'art au sein d'un processus créatif. La parodie favorise le dévoilement : elle permet de porter un regard sur l'histoire de l'art, mais aussi sur le faire artistique. Entre intégration d'une œuvre ancienne et démarcation vis-à-vis de celle-ci, la parodie est aussi le lieu où se gèrent et se révèlent les influences et les filiations les plus complexes.
Le comique à l'œuvre dans la parodie peut dès lors apparaître comme proprement interne au champ de l'art : un comique naissant de l'art, portant sur l'art, et s'adressant à un public de connaisseurs. C'est cette dimension que convoque Linda Hutcheon[1] pour différencier la parodie et la satire – des modes qui font tous deux usage de l'ironie et sont régulièrement confondus et amalgamés. Alors que l'œuvre satirique vise à la dénonciation de normes sociales ou morales – s'accompagnant souvent d'une volonté de réforme ou de correction –, l'action de la parodie resterait « intramurale ». Hutcheon avance que la parodie « ne peut avoir pour cible qu'un texte ou des conventions littéraires[2] ». L'auteure justifie cette répartition entre cible extramurale de la satire et cible intramurale de la parodie par un examen étymologique. Le mot parodie vient du grec parôdia, formé à partir de para, qui signifie le long de, à côté de ou contre et de ôdé, le chant. L'action parodique s'appliquerait ainsi au « chant », un domaine exclusivement esthétique. Et cependant, force est de constater que de nombreux artistes exploitent la forme parodique à des fins extramurales, c'est-à-dire morales, sociales et politiques. Aussi nous appuyons-nous sur le travail de Daniel Sangsue[3], qui propose deux combinaisons possibles entre parodie et satire[4] : la « satire parodique » consiste en la transformation parodique d'une œuvre pour la railler, et la « parodie satirique »[5] en la transformation parodique d'une œuvre dans le but de faire la satire d'un objet extérieur à cette œuvre. Précisons que si cette distinction nous paraît essentielle, certaines œuvres peuvent user des deux modalités, et ainsi à nouveau brouiller ces délimitations terminologiques. Cette réserve étant émise, nous nous concentrerons dans cette courte étude sur la parodie satirique.
Le recours à des œuvres majeures de l'histoire de l'art pour faire la satire de tel ou tel événement est monnaie courante dans le dessin de presse[6]. Si cet emploi témoigne de l'impact et de l'efficacité de ces transformations d'images canoniques et patrimoniales, les exemples choisis s'en tiennent volontairement aux productions qui restent dans le champ clos de l'art au sens strict. Car c'est précisément la tension entre un art interréférentiel et réflexif et la portée éminemment politique qui lui est conférée qui nous intéresse ici. En quoi et pourquoi une pratique relevant a priori de « l'art sur l'art » peut-elle devenir une arme de choix aux mains d'artistes engagés politiquement et souhaitant s'attaquer – voire en découdre – avec certains aspects de leurs sociétés contemporaines ? « La satire est une leçon, la parodie est un jeu[7]. » S'appuyant sur la célèbre phrase de Vladimir Nabokov, Daniel Sangsue apporte d'emblée un élément de réponse : « Le satiriste qui recourt au jeu de la parodie donne une leçon tout en évitant les pesanteurs de la leçon, la parodie satirique lui permet de combiner leçon et jeu, de faire passer sa leçon sous le couvert du jeu[8]. »
L'utilisation de la parodie dans un but satirique n'est propre ni à un courant artistique, ni à une époque. La période qui s'étend de la fin des années 1960 au milieu des années 1970 en offre toutefois des développements particulièrement féconds. Les artistes appartenant à la Figuration narrative associent bien souvent leur verve politique à la transformation d'œuvres du patrimoine artistique : en témoigne les travaux parodiques et engagés d'Eduardo Arroyo, d'Equipo Crónica et de la coopérative des Malassis[9]. La contestation[10] est l'un des motifs essentiels de l'activité de ces artistes qui se regroupent notamment autour d'un Salon de la Jeune peinture[11] qui prend, à partir de 1965, un tour très politisé. Ils mettent en œuvre une figuration critique et réintroduisent la représentation de la durée narrative dans la peinture pour lutter contre un formalisme associé à l'idée de modernité, un « art pour l'art » qu'ils jugent obsolète. Ces « intrusions dans le champ de l'histoire[12] », pour reprendre les termes d'Henri Cueco, peuvent passer par le maniement et l'exploration d'images préexistantes[13]. Tout comme les artistes du Pop art, les peintres de la Figuration narrative puisent dans le fond des images reproduites, diffusées et disponibles dans la société de masse, qui appartiennent au domaine de la presse, de la bande dessinée, du cinéma ou de l'art muséal. Mais comme nous le verrons, leur travail de citation revêt, par l'affirmation de sa fonction hautement politique, une forme fort différente.
En 1965, à l'occasion d'une exposition organisée conjointement par les galeries parisiennes André Schoeller et Berhneim-Jeune[14], Jorge Semprun présente Eduardo Arroyo comme un démolisseur de mythes :
« Dans cette Espagne qui n'est pas un fait, mais un faire, certains, avec rage, avec insolence, par la parole, par la plume, par le pinceau – maniés comme un couteau, comme un marteau, comme un ciseau – ont entrepris de démolir les mythes. […] Parmi ces enragés, ces insolents, ces provocateurs, voici le peintre Arroyo[15]. »
Ces mythes de l'Espagne franquiste, Arroyo s'y attaque en parodiant les œuvres des grands maîtres du passé, El Greco, Vélasquez, Goya ou David. Dans cette « entreprise de démystification »[16], l'avant-garde du début du XXe siècle n'est pas en reste : après un violent attentat collectif contre la figure de Marcel Duchamp[17], Arroyo s'en prend à Joan Miró. En 1967, l'artiste présente quelques parodies à la 5e Biennale de Paris et à la galerie romaine II Fante di Spade, avant de présenter à la galerie André Weill[18], en 1969, une exposition complète intitulée « Miró refait ou les malheurs de la coexistence ». De telles parodies ne manquent pas d'irriter certains acteurs du surréalisme – en particulier José Pierre[19] – et d'être taxées de conservatisme, d'autant que la galerie Weill est connue pour son traditionalisme.
Tout comme Duchamp, Miró est aux yeux d'Arroyo un artiste dont la liberté ne peut être qu'illusoire, car elle s'exprime par un détachement du monde réel et des contraintes de l'histoire – vision partiale, qui plus est tout à fait discutable en regard de l'œuvre de Miró. Sans détour et sans nuance, sa peinture est assimilée à une conception bourgeoise de l'art, qui se complaît dans la valorisation d'un acte démiurgique pour légitimer son absence de contenu[20]. L'idée de « refaire » l'œuvre de Miró s'impose donc comme une nécessité : « J'ai décidé de la sortir de l'histoire de l'art pour la replacer dans l'histoire réelle, dans la vie même[21]. » Dans Espagne je te vois – dont le titre original España te miró s'amuse à jouer avec le nom du surréaliste – l'artiste transforme La Ferme, peinte par Miró en 1921-1922, soit plus de dix ans avant la guerre civile espagnole. La transformation est d'autant plus percutante qu'elle s'opère au sein d'une ressemblance frappante entre l'œuvre seconde et sa source. Arroyo s'applique à copier fidèlement la facture et la composition de la toile originale, mais substitue à certains éléments pastoraux des détails violents qui renvoient au fascisme. Des barreaux de prison apparaissent aux fenêtres, la poulie suspendue se change en potence et le vieux puits en casemate d'artillerie ; la hache posée au sol cède la place à un pistolet, le lézard à un couteau, l'escargot à une croix teutonique ; le petit chien devient ironiquement un Saint-Bernard, l'abreuvoir du poulailler est désormais couvert d'un drapeau nazi, les lettres « L'INTR » inscrites sur le journal sont remplacée par « ABC », allusion à un hebdomadaire officiel de l'Espagne franquiste. À l'exception du chien, les animaux – cheval, coq, chèvre, lapins, oiseaux – disparaissent. Le sol est, par endroits, parsemé d'ossements et de crânes. Le rouge est dominant dans l'œuvre d'Arroyo : évoquant le sang, il remplace l'eau, remplit divers récipients et recouvre le sol. Au rouge s'alterne le jaune, la toile se parant ainsi des couleurs du drapeau espagnol. À une Espagne rêvée se confronte l'Espagne réelle, touchée par le fléau du fascisme.
La transformation parodique prend ici le visage d'une violente politisation. Dans un entretien de 2007, Arroyo concède à ses interviewers que Miró n'est pas un « personnage épouvantable » vendu au régime de Franco : « Miró c'est innocent[22]. » Mais, c'est précisément cette « innocence » à laquelle souhaite s'attaquer l'artiste, parce qu'elle trahit la mission qui doit être, à ses yeux, celle du peintre. Miró et sa peinture servent ainsi de prétexte à une opposition à l'héritage de l'avant-garde historique ainsi qu'à l'affirmation de ce qui est, pour Arroyo, la plus haute aspiration de la peinture : « Le changement et la transformation de la société[23]. »
Cette aspiration est partagée par le groupe valencien Equipo Crónica, composé en 1964 des trois artistes Juan Antonio Toledo, Manuel Valdès et Rafael Solbes, puis dès 1965 uniquement de Valdès et Solbes, jusqu'à la mort de ce dernier en 1981. Sa production a pour ambition de « faire éclater le champ clos de l'art par une réflexion sur les problèmes de la réalité sociale, locale et politique[24] ». Tout comme Arroyo, les peintres de ce groupe participent aux manifestations parisiennes de la Figuration narrative. Leur production est entièrement consacrée à une dénonciation acerbe du franquisme, et ce jusqu'à la fin du régime en 1977. Les forces dirigeantes espagnoles réalisent alors une forme de resémantisation du patrimoine culturel espagnol, dans un but essentiellement nationaliste. C'est dans ce contexte spécifique que la peinture d'Equipo Crónica se construit autour du détournement parodique d'images préexistantes. Pour la série au titre évocateur La Récupération (1967-1969), le groupe s'empare des œuvres qui dépeignent l'aristocratie espagnole, œuvres particulièrement sujettes aux réemplois nationalistes. Les personnages peints par les artistes du Siècle d'or espagnol, principalement El Greco et Vélasquez, et par Goya, sont projetés dans des intérieurs des années 1960, devant des étalages de supermarché, dans des usines ou encore dans des bureaux d'entreprises. Sous les pinceaux d'Equipo Crónica, ils deviennent les représentants d'une classe dominante, désignée comme partie prenante dans le développement de la société de consommation et comme actrice de répression sociale.
En 1969, les artistes réalisent une série entière consacrée à Guernica (1937) de Picasso. Cette toile, alors fortement investie, incarne à elle seule la résistance au régime. La série répond à une rumeur qui circule en 1969 : la toile, jusqu'alors conservée au MOMA de New York, serait sur le point de revenir sur le sol espagnol, pour être placée dans un musée national[25]. Cette rumeur est à nouveau l'occasion pour les artistes d'Equipo Crónica de se questionner sur la récupération des œuvres d'art par le pouvoir : Comment l'état franquiste peut-il s'approprier et exposer une toile qui dénonce précisément les atrocités de la guerre civile ? Dans une œuvre de la série, le groupe imagine la scène d'un banquet, présidé par un moine dominicain dont les traits ressemblent à ceux de Franco, où les restes du tableau de Picasso sont servis comme repas. Dans une autre, intitulée L'Intrus, la toile originale est parasitée par un chevalier de comics. L'épée en main, il s'élance et tranche visiblement tout ce qui se présente sur son passage. Cet usage d'une imagerie de comics se distingue fortement de celui à l'œuvre chez les artistes Pop américains. Le chevalier en question n'est autre qu'el Guerrero del Antifaz, héros inventé par Manolo Gago en 1943. Les valeurs sous-tendues dans cette bande-dessinée, très appréciée sous le franquisme, sont celles de l'esprit guerrier et nationaliste motivé par la chrétienté. À l'époque des rois catholiques, el Guerero participe à la Reconquista et se bat contre les Maures, pour la réunification espagnole. L'incongruité de la rencontre entre cette esthétique de comics et la peinture de Picasso, et entre ce personnage incarnant l'exaltation guerrière et la dénonciation du massacre que porte Guernica, n'a d'égal que l'absurdité de la récupération institutionnelle de la toile en pleine Espagne franquiste. La parodie est pour Equipo Crónica un moyen de révéler le pouvoir des images et le risque encouru par leur manipulation.
Née sous l'impulsion des travaux collectifs du Salon de la Jeune peinture, la coopérative des Malassis est officiellement créée en 1970. Son noyau dur est constitué des peintres Henri Cueco, Lucien Fleury, Jean-Claude Latil, Michel Parré et Gérard Tisserand. L'art collectif, ici de surcroît organisé en coopérative, peut apparaître comme un geste contestataire, qui se joue en marge des circuits de l'art établi[26]. À la différence d'Equipo Crónica, la peinture produite par les Malassis n'est pas faite d'aplats de couleurs unies, qui rappellent l'image imprimée. S'y développe pourtant progressivement une même recherche : celle de l'effacement de tout aspect subjectif et expressif de la touche, tant valorisé par l'abstraction gestuelle et lyrique comme témoignage de la singularité de l'artiste. Cette « tentative de dépersonnalisation du geste artistique[27] », pour reprendre les termes d'Itzhak Goldberg, semble aller de pair avec un engagement politique fort.
Comme le formule Jean-Louis Pradel, la peinture des Malassis « aime à “prendre la parole”[28] ». En 1974-1975, cette parole gagne l'espace public : à la demande des communes d'Échirolles et de Grenoble, les artistes réalisent un vaste décor pictural composé de plusieurs panneaux qui couvrent, sur plus de 2000 m2, la façade du centre commercial Grand'Place. Onze variations sur le Radeau de la Méduse ou la Dérive de la société, allie une parodie du Radeau de la Méduse de Géricault (1818-1819) à une satire qui vise la société de consommation, dont le centre commercial est le temple. Dans l'un des panneaux, le radeau est transformé en côtelette bien saignante et rutilante, et vogue à présent sur une mer de frites, le tout sur un fond rose acidulé. Dans un autre, des boîtes de conserve s'accumulent avec, en guise d'étiquette, une copie verdâtre de la toile originale. Le bras du naufragé brandissant un tissu, désormais torchon de cuisine rouge et blanc à rayures, semble vouloir s'échapper d'une boîte entrouverte.
L'allusion à la « malbouffe » renvoie avec cynisme au cannibalisme auquel les naufragés du radeau original ont dû recourir pour survivre. L'engloutissement des personnages, et par là-même celui de la peinture de Géricault[29], est une allégorie de l'engloutissement que subissent les êtres face à l'avènement d'une société de masse impitoyable. Le motif de la boîte de conserve est sans doute un clin d'œil au Campbell's Soup Cans de Warhol (1962). Son emploi peut dès lors être interprété comme le signe d'une démarcation vis-à-vis du Pop art, cette boîte étant chez les Malassis le support d'une dénonciation sans équivoque de la société de consommation et de ses excès.
Les Malassis sont adeptes de la parodie, la réutilisation d'images préexistantes leur permettant de provoquer une prise de distance critique. Ils élisent ici pour source une peinture d'histoire qui, comme le souligne Noëmi Blumenkranz, est « riche en implications extrêmement importantes pour eux[30] ». La toile de Géricault témoigne en effet de l'engagement d'un artiste face à son actualité[31], engagement que les Malassis entendent perpétuer : la peinture d'histoire sort de l'espace confiné du musée pour s'exprimer, dans une version actualisée, au sein de l'espace public. La convocation d'une œuvre célèbre du patrimoine artistique français a aussi pour effet d'interpeler le spectateur. Mais loin de tout hommage respectueux, l'œuvre du peintre romantique est pour le moins maltraitée. Les artistes déploient autour d'elle des décors aux couleurs criardes, qui cultivent volontairement un mauvais goût agressif. La citation de Géricault ne constitue nullement l'appel à une haute autorité artistique faisant figure de modèle sacré pour la peinture à venir. Le Radeau de la Méduse n'échappe pas à la déconstruction qu'opère le regard critique des Malassis, comme le montre ce propos :
« Nous devrions être des supports de rêve et, prenant une côtelette d'agneau par ci, un plat de nouilles par là, un radeau de la Méduse ailleurs, nous devrions par nos images vous faire entrer dans un monde merveilleux : celui de l'ART. Mais hélas ! La côtelette d'agneau nous renvoie au prix de la viande hachée, le radeau de la Méduse au Paquebot France, et le plat de nouilles à la Société Libérale Avancée[32]. »
La satire parodique à l'œuvre chez les Malassis, Arroyo ou Equipo Crónica, s'accompagne d'une démystification de l'art et du génie artistique qui s'adonne à l'introspection, jugée aveuglante. La réflexivité du genre parodique sert ainsi un démantèlement des images, dans le but d'une prise de conscience politique. La parodie satirique est un art politique qui se double d'une réflexion sur l'acte artistique lui-même. En mobilisant les œuvres sacrées des musées pour une action politique, les parodistes se battent avec leurs armes, celles de l'art. Il s'agit d'être « salauds avec la peinture[33] », comme le dit Henri Cueco au sujet des Malassis. Formule à double tranchant, car « être salauds avec la peinture », c'est être salauds par les moyens qu'offre la peinture, mais c'est aussi être salauds contre elle.
Juliette
Bertron
Centre
Georges Chevrier,
UMR7366
CNRS-uB
(sous
la direction de Bertrand Tillier)
[1] Linda Hutcheon, « Ironie, satire, parodie, une approche pragmatique de l'ironie », Poétique, n° 46, Paris, Ed. du Seuil, 1981, p. 140-155.
Pour citer cet article :
Juliette Bertron, « Usage(s) politique(s) de la parodie chez Eduardo Arroyo, Equipo “Cronica” et les Malassis », Revue TRANSVERSALES du Centre Georges Chevrier - 4 - mis en ligne le 12 novembre 2014.
URL : http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/publications/Transversales/Fonctions_du_rire/J_Bertron.html
Auteur : Juliette Bertron
Droits : © Tous droits réservés - Ce texte ne doit pas être reproduit (sauf pour usage strictement privé), traduit ou diffusé. Le principe de la courte citation doit être respecté.