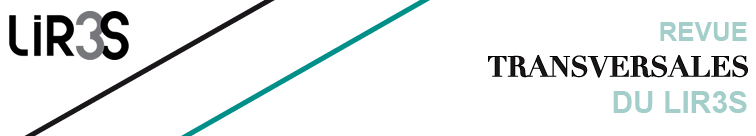
Levi et Pascal sur la question de l’humanité
Le
sentiment de notre existence dépend pour une bonne part
du regard
que les autres portent sur nous :
aussi peut-on qualifier de non humaine l’expérience
de qui a vécu des jours où l’homme a été
un objet aux yeux de l’homme[1].
Dans son récit Si c’est un homme, où Primo Levi raconte ses expériences au sein du camp de concentration à Auschwitz, le thème de l’anéantissement de l’homme se présente comme un fil conducteur. En effet, le milieu hostile du camp de travail (appelé « Arbeidslager ») ne fait pas que menacer l’humanité de ses habitants : toute distinction d’ordre moral ou social semble y avoir disparu. Ainsi, le plus grand nombre des habitants du camp fait preuve d’une indifférence radicale face à leur condition : ils se résignent à l’existence de bêtes ou d’automates à laquelle les Allemands les ont destinés. Or, certaines personnes refusent de consentir à leur condition et résistent au caractère inhumain de l’univers dans lequel ils se trouvent. Leur attitude se fait remarquer par un fort désir de maintenir leur dignité humaine.
Nombre d’études secondaires ont déjà été faites sur certains thèmes spécifiques liés à la notion de l’humanité dans l’œuvre de Levi, comme par exemple le statut du témoin[2] ou la question de l’identité juive[3]. Le but de cette étude, d’ailleurs, ne consiste pas dans une analyse littéraire de Si c’est un homme à partir d’un thème spécifique. En revanche, nous envisageons de mettre la thématique de l’humanité chez Levi en rapport avec la pensée anthropologique d’un philosophe du XVIIe siècle, à savoir Blaise Pascal[4]. Dans son œuvre Les Pensées, Pascal semble à première vue partager le pessimisme de Levi concernant la condition humaine. Ainsi, ce philosophe du XVIIe siècle présente l’homme comme un être misérable et perdu dans un univers contingent et arbitraire. Or, il faut se garder de tomber trop vite dans des comparaisons superficielles qui méconnaissent le contexte radicalement différent des deux auteurs. Nous n’avons donc pas l’intention de juxtaposer aveuglément certains thèmes anthropologiques de Levi et de Pascal. Par contre, nous visons à démontrer que la vision de Levi sur l’humanité, telle qu’elle se révèle dans l’attitude des prisonniers qui refusent de se résigner à leur condition, doit être considérée comme une continuation de certaines idées cruciales provenant d’un fragment très connu des Pensées, à savoir Infini Rien. Dans ce fragment, précisément, Pascal évoque un dialogue où un joueur invite son interlocuteur à parier sur l’existence de Dieu. En fin de compte, il ne s’agira pas simplement d’un jeu, dans lequel le pari est destiné à remplacer les preuves rationnelles de l’existence de Dieu. L’enjeu véritable de ce dialogue ne concerne pas le pari sur Dieu en tant que tel, mais correspond par contre à un choix radical touchant l’existence humaine même où l’homme se trouve obligé de prendre parti face à sa condition. La question sera de savoir dans quelle mesure cette interprétation du pari de Pascal peut nous aider à expliquer l’attitude propre à ces quelques prisonniers qui, malgré le caractère inhumain du camp et de ses habitants, réussissent malgré tout à exprimer encore une dignité humaine.
Dans un premier temps, nous considérerons ce que Levi entend par la notion d'humanité et surtout de la non-humanité des habitants du camp de concentration. D’abord, nous regarderons de plus près les personnages qui font preuve d’une indifférence radicale face à leur condition et qui selon Levi ont déjà perdu leur humanité. Puis, nous nous concentrerons sur certains personnages qui refusent de consentir à l’existence qui leur est imposée par les allemands. Dans un deuxième temps, nous expliquerons brièvement ce que le philosophe Blaise Pascal entend par la condition humaine afin de considérer le cadre anthropologique dans lequel il faut situer le fragment Infini Rien. La troisième partie sera consacrée à un rapprochement entre Pascal et Levi à partir de leurs visions de la question de l’humanité.
Si c’est un homme : Levi et la question de l’humanité
« Détruire un homme est difficile, presque autant que le créer : cela n’a été ni aisé ni rapide, mais vous y êtes arrivés, Allemands[5]. »
Est-il possible de parler de dignité humaine au sein d’un univers où toute notion d’humanité s’avère nécessairement détruite ? Levi décrit la condition des prisonniers au camp de travail en évoquant l’image « d’une même machine grise[6] » qui rassemble en elle une masse de personnes devenues incapables de vouloir et de penser. Les membres de cette masse impersonnelle sont des êtres dépourvus de tout ce qui les singularise, y compris leur nom :
« Qu’on imagine maintenant un homme privé non seulement des êtres qu’il aime, mais de sa maison, de ses habitudes, de ses vêtements, de tout enfin, littéralement de tout ce qu’il possède : ce sera un homme vide, réduit à la souffrance et au besoin, dénué de tout discernement, oublieux de toute dignité : car il n’est pas rare, quand on a tout perdu, de se perdre soi-même ; ce sera un homme dont on pourra décider de la vie ou de la mort le cœur léger, sans aucune considération d’ordre humain, si ce n’est, tout au plus, le critère d’utilité[7]. »
Le fragment ci-dessus nous révèle la raison pour laquelle les Allemands avaient l’intention de réduire leurs prisonniers au statut de bêtes ou d’automates. Ils s’imaginaient notamment qu’il était plus facile de tuer un être anonyme et indifférent que de détruire un individu digne en tant qu’être humain.
Tout comme ses compagnons d’infortune, Levi se voit lui-même transformer : un homme libre et sensible devient un être anonyme, soumis à une existence vide et conditionnée. Plusieurs fois, il fut enclin à se résigner à sa condition et à adopter la même attitude d’indifférence propre à tant d’autres prisonniers. Pour un des exemples les plus frappants de cette attitude d’indifférence, l’on peut renvoyer au caractère « Null Achtzehn ». Aux yeux de Levi, ce personnage apparaît comme l’incarnation même du vide (il le compare aux dépouilles d’insectes), n’étant plus qu’un robot qui se conforme aveuglément et indifféremment aux ordres de ses supérieurs. « S’il était envoyé à la mort », écrit Levi, « il est fort probable qu’il y irait avec la même indifférence »[8].
Jusqu’ici, nous avons insisté sur le caractère conditionné et inhumain de l’existence propre aux prisonniers en tant qu’individus. Or cette perte d’humanité s’impose en outre au niveau de la relation à autrui. La « société » qui surgit au camp de travail ressortit à un calcul permanent de l’intérêt personnel, ce qui provoque nécessairement une haine mutuelle de la part de tous ses membres. En ce qui concerne les relations hiérarchiques entre les officiers allemands et les prisonniers, il s’agit d’un rapport à autrui marqué d’une humiliation permanente : le prisonnier est essentiellement considéré comme un objet ou un instrument aux yeux de ses supérieurs. Levi évoque dans ce contexte l’acte humiliant du personnage Alex, qui se permettait, dans sa qualité de supérieur, de traiter Levi comme une bête ou un objet sans aucune valeur :
« Entre-temps, je suis arrivé à sa hauteur : sans haine et sans sarcasme, Alex s’essuie la paume et le dos de la main sur mon épaule pour se nettoyer ; et il serait tout surpris, Alex, la brute innocente, si quelqu’un venait lui dire que c’est sur un tel acte qu’aujourd’hui je le juge, lui et Pannwitz, et tous ses nombreux semblables, grands et petits, à Auschwitz et partout ailleurs[9]. »
Alex était un de ces nombreux officiers allemands faisant preuve d’un orgueil déplacé, tous faisant comme s’ils avaient droit à une grandeur divine. Pour Levi, la vanité énorme de ces personnages s’exprime à travers leurs projets absurdes : l’accompagnement des mélodies allemandes pendant la marche des prisonniers, l’invention d’un examen de chimie, mais surtout : l’usine de carbure dans laquelle nombre de prisonniers ont dû travailler et ont perdu la vie. Cette usine, dont Levi comparait la Tour du Carbure à la tour de Babel, n’a jamais produit un kilo de caoutchouc, le produit auquel elle était destinée.
« La Tour du Carbure, qui s’élève au centre de la Buna et dont le sommet est rarement visible au milieu du brouillard, c’est nous qui l’avons construite. Ses briques ont été appelées Ziegel, mattoni, tegula, cegli, kamenny, bricks, téglak, et c’est la haine qui les a cimentées ; la haine et la discorde, comme la Tour de Babel, et c’est le nom que nous lui avons donné : Bableturm, Bobelturm. En elle nous haïssons le rêve de grandeur insensée de nos maîtres, leur mépris de Dieu, et des hommes, de nous autres hommes. […] Ainsi qu’on le verra, de l’usine de la Buna, sur laquelle les Allemands s’acharnèrent pendant quatre ans et dans laquelle une innombrable quantité d’entre nous souffrirent et moururent, il ne sortit jamais un seul kilo de caoutchouc synthétique[10]. »
La haine et la discorde ne s’imposent d’ailleurs pas uniquement au niveau des relations hiérarchiques ayant lieu entre les supérieurs et les prisonniers. En outre, les relations entre les égaux, c’est-à-dire les prisonniers eux-mêmes, se caractérisent par l'hypocrisie et la discorde. Bon nombre de personnages regardent ainsi leur compagnon d'infortune d’une façon calculée et intéressée : ‘l’autre’ apparait à leurs yeux comme un objet rentable ou favorable à l’égard de leur propre intérêt. Un des personnages faisant preuve d'une telle attitude calculée, c’est Henri. Son hypocrisie énorme se manifeste à travers sa stratégie de feindre les émotions d’amitié ou de pitié envers ses semblables afin de gagner des hommes pour lui-même : « Il lui parle brièvement, en employant le langage approprié, et “le type” est conquis : il écoute avec une sympathie croissante, s’attendrit sur le sort du malheureux jeune homme, et est déjà en passe de devenir rentable[11] ».
En fin de compte, il s’avère que toutes les relations entre les kapos, les SS, les prisonniers, au sein du camp sont dépourvues de toute notion d’humanité. D’où la constatation assez désespérante de la part de Levi à propos de la non-humanité des personnages de son récit :
« Les personnages de ce récit ne sont pas des hommes. Leur humanité est morte, ou eux-mêmes l’ont ensevelie sous l’offense subie ou infligée à autrui. Les SS féroces et stupides, les Kapos, les politiques, les criminels, les prominents grands et petits, et jusqu’aux Häftlinge, masse asservie et indifférenciée, tous les échelons de la hiérarchie dénaturée instaurée par les Allemands sont paradoxalement unis par une même désolation intérieure[12]. »
Malgré le pessimisme de Levi touchant la question de l’humanité, certains personnages de son récit ont maintenu leur dignité humaine au cœur de l’environnement inhumain du camp[13]. Tous ces personnages se distinguent par un trait commun, à savoir leur refus de se résigner à la condition indifférente et anonyme qui leur est imposée par les Allemands. Même si l’arbitraire et la contingence propres aux sélections du camp excluent toute garantie de survie, ces personnes n’appartiennent pas à ce monde de négation qu’est l’Arbeidslager. Tout en se conformant aux rituels et aux règles imposés par les allemands, ces personnages-modèles se gardent de tomber dans l’indifférence radicale qui caractérise les autres prisonniers obéissant aveuglément aux règles du camp. Afin d’illustrer leur façon de maintenir leur dignité humaine, je transcris les paroles du personnage Steinlauf, qui incite Levi à se laver dans les latrines, malgré le caractère apparemment vain et absurde de ce rituel :
« Nous sommes des esclaves, certes, privés de tout droit, en butte à toutes les humiliations, voués à une mort presque certaine, mais il nous reste encore une ressource et nous devons la défendre avec acharnement parce que c’est la dernière : refuser notre consentement. Aussi est-ce pour nous un devoir envers nous-mêmes que de nous laver le visage sans savon, dans de l’eau sale, et de nous essuyer avec notre veste[14]. »
Les paroles de Steinlauf nous révèlent une vérité nécessaire pour survivre au camp : malgré le caractère radicalement inhumain des circonstances, l’homme sait encore disposer de lui-même pour maintenir sa dignité. Steinlauf insiste sur le fait que chacun dispose de la liberté de ne pas consentir à la condition d’indifférence qui lui est imposée par les allemands. Cette liberté ne consiste d’ailleurs pas à se rebeller explicitement contre les règles imposées par les allemands. Bien au contraire, tout comme les autres prisonniers, Steinlauf exécute fidèlement les rituels propres au camp. Or, il n’obéit pas de façon aveugle ou automatique : sa façon d’exécuter les rituels comprend par contre une résistance secrète contre leur caractère vain et insignifiant. Contrairement à ceux qui se lavent aux latrines de façon aveugle et indifférente, Steinlauf accorde à ce rituel une signification propre : malgré le caractère absurde de l’acte de se laver dans de l’eau sale et froide, il fait comme si ce rituel lui permet d’exprimer sa dignité humaine et le préserve de tomber dans une condition d’indifférence.
Dans la suite de notre analyse, nous mettrons cette attitude propre à Steinlauf, notamment celle de vouloir vivre et de refuser son consentement, en rapport avec une Pensée fondamentale de Blaise Pascal, qui est celle du pari. Bien que la notion du ‘pari’ se situe premièrement dans un cadre théologique (il s’agit apparemment de parier sur l’existence de Dieu), j’en dégagerai une interprétation anthropologique qui nous aidera à comprendre le sens que Levi accorde à l’idée de l’humain au milieu d’un état de misère insurmontable. Avant de nous arrêter à l’analyse même du fragment Infini rien, il nous faut expliquer ce que Pascal entend dans ses Pensées par la condition humaine.
La condition humaine pour Pascal
« Qu’on s’imagine un nombre d’hommes dans les chaînes, et tous condamnés à la mort, dont les uns étant chaque jour égorgés à la vue des autres, ceux qui restent voient leur propre condition dans celle de leurs semblables, et, se regardent l’un l’autre avec douleur et sans espérance, attendent à leur tour[15]. »
Selon un certain nombre de commentateurs des Pensées, Pascal s’est servi de cette image des prisonniers afin d’exprimer sa vision sur la condition de l’homme[16]. Curieusement, ce fragment semble évoquer des circonstances semblables à celles des prisonniers du camp à Auschwitz qui, eux aussi, sont confrontés sans cesse à la mort de leur prochain. Or, il faut se garder de rapprocher trop vite les deux auteurs, vu la différence radicale des deux contextes, tant sur le plan social que théologique : la misère propre à la condition humaine chez Pascal a une origine toute autre que celle de Levi.
Pour sa définition pessimiste de la condition de l’homme, Pascal s’est inspiré, tout comme bien d’autres moralistes du XVIIe siècle, de la doctrine janséniste-augustinienne du péché originel[17]. Selon cette tradition théologique, il existe depuis la Chute un abîme infranchissable entre Dieu et l’homme : Adam s’était détourné de Dieu et a mis l’humanité entière dans un état déchu et désespéré. L’homme était radicalement abandonné à lui-même, vivant dans un univers qui ne lui accorde aucune garantie de bonheur ou de vérité. En d’autres mots : l’être humain s’y présente comme un damné, jeté dans un univers qui l’ignore[18]. Or, un certain groupe d’élus semble être sauvé de cette condition désespérée parce qu’ils ont reçu la grâce divine. Ce don de grâce, d’ailleurs, dépasse infiniment les mérites humains : depuis la Chute d’Adam et la séparation radicale entre l’homme et Dieu, l’homme est devenu incapable d’arriver à la foi par ses propres moyens. Aux yeux de Pascal, c’est d’une façon radicalement arbitraire que Dieu accorde sa grâce à l’humanité.
Malgré sa condition de misère et de désespoir, l’homme tend incessamment à acquérir une certaine grandeur qui lui permet de s’élever au-dessus du reste de l’humanité. À travers toutes sortes d’activités (appelées les « divertissements »), il cherche plus précisément à se créer un moi imaginaire. En d’autres termes : sa volonté ne cherche qu’à satisfaire un amour propre infini et à embellir ce moi illusoire afin de paraître grand, parfait et digne d’amour et d’estime. Par cette création d’un moi imaginaire, l’homme oublie son véritable « soi », à savoir sa condition de misère qu’il partage avec le reste de l’humanité. En d’autres termes : il refuse de cultiver la pensée de sa véritable condition en cachant sa misère derrière une image créée de soi-même.
Telle forme de tromperie de soi mène à son tour aux conséquences néfastes sur le plan social. La société, telle qu’elle est décrite par Pascal, semble notamment consister dans un ensemble de moi imaginaires qui ne cherchent qu’à satisfaire leurs désirs de grandeur et de dignité, ce qui se traduit nécessairement par une attitude de haine et d’envie mutuelles. C’est dans ce sens qu’il faut entendre la notion de « moi haïssable » : le moi hait son prochain, justement parce que celui-là refuse de le reconnaître dans sa grandeur imaginaire. En effet, pour l’auteur des Pensées, le « vilain fond » d’une société consiste dans le fait que « tous les hommes se haïssent naturellement l’un et l’autre[19] ». Afin d’éviter un état continu de guerre, ces moi cachent leur haine et leur mépris derrière une apparence d’honnêteté à travers laquelle ils feignent d’entretenir des relations de respect et d’estime avec autrui. Ainsi, toute relation interhumaine cache toujours une haine mutuelle entre deux moi refusant de reconnaître l’autre dans sa véritable dignité humaine.
Malgré son pessimisme touchant la société et la condition humaine en général, Pascal accorde néanmoins une signification positive à la notion de l’humanité. Dans le fragment Infini Rien, il fait mention de la possibilité pour l’humanité de mener une existence avec dignité.
Infini… rien : le pari sur Dieu ou sur l’existence humaine ?
Le titre du fragment Infini Rien renvoie à la relation de disproportion entre d’une part l’esprit humain fini et d’autre part la réalité infiniment incompréhensible de Dieu. Dans la première partie du fragment, Pascal indique que l’essence ainsi que l’existence de l’Être infini de Dieu sont inaccessibles à la raison humaine, celle-ci tenant ses principes du domaine fini du corps humain[20]. Étant par conséquent incapable de fournir une preuve rationnelle de l’existence de Dieu au moyen de la raison, le joueur invite alors son interlocuteur à un jeu de pari : « Dieu est ou Il n’est pas, de quel côté pencherons-nous ?[21] » Cette question s’avère à première vue assez choquante, Dieu étant réduit à l’objet d’un simple jeu de croix ou pile. La réplique de l’interlocuteur suggère qu’il est plutôt juste « de ne point parier[22] ». Or, la réponse du joueur révèle que le pari ne concerne pas tant Dieu que l’existence humaine, celle-ci considérée comme un jeu où il faut prendre nécessairement parti : « Il faut parier. Cela n’est pas volontaire, vous êtes embarqué[23]. » Ensuite, le joueur entame une série d’arguments qui sont tous destinés à convaincre son interlocuteur de la valeur et des avantages d’une vie consacrée à l’existence de Dieu. Finalement, l’argumentation aboutit naturellement à la conclusion que l’acte de parier sur une vie chrétienne constitue la chance la plus sûre pour atteindre une vie pleine de vérité et de bonheur[24]. Contre toute attente, la réponse de l’interlocuteur s’avère négative : malgré le fait qu’il reconnaît rationnellement les avantages de la vie chrétienne, il est confronté à son impuissance de choisir une telle existence : « je suis fait de telle sorte que je ne puis croire[25] ». Cette réponse de la part du non-croyant nous révèle une vérité assez angoissante concernant l’état propre à l’être humain : l’on est incapable d’accéder à la foi par ses propres forces, le destin de sa condition n’étant qu’un effet du hasard. Il n’y a que la grâce divine, accordée de façon arbitraire à un nombre limité d’élus, qui puisse sauver l’être humain de son état misérable. Cette conclusion trahit sans doute un pessimisme radical concernant la condition humaine : L’homme apparaît comme étant condamné à une misère insurmontable, étant livré à l’arbitraire de la grâce divine pour être sauvé. Or, dans la deuxième partie du fragment, Pascal fait mention d’une solution provisoire : « apprenez de ceux qui ont été liés comme vous et qui parient maintenant tout leur bien […] suivez la manière par où ils ont commencé. C’est en faisant tout comme s’ils croyaient, en prenant de l’eau bénite, en faisant dire des messes, etc. Naturellement même cela vous fera croire et vous abêtira[26] ».
La stratégie que Pascal propose est celle de faire « comme si » on est chrétien, en ayant recours à l’imitation de ceux qui ont reçu la foi par la grâce. Cette stratégie d’imiter les chrétiens-modèles n’inclut d’ailleurs aucune garantie de vérité ou de bonheur, le don de grâce ne tenant pas compte de mérites humains. Or, le fait de s’accoutumer peu à peu à la vie chrétienne, en exécutant les rituels propres à la religion, semble valoir infiniment plus qu’une existence sujette à toutes sortes de désirs terrestres : « Or, quel mal vous arrivera-t-il en prenant ce parti ? Vous serez fidèle, honnête, humble, reconnaissant, bienfaisant, ami, sincère, véritable […]. À la vérité, vous ne serez point dans les plaisirs empestés, dans la gloire, dans les délices[27]. »
En d’autres mots : en s’adaptant aux coutumes de la religion chrétienne et en imitant les modèles des chrétiens, l’on fait naître en soi une attitude morale et ouverte envers autrui. C’est précisément le mode de vie qui détache l’homme de l’esclavage des passions et des désirs de gloire ou de grandeur.
Conclusion : Pascal et Levi sur les modèles de l’humanité
Reste enfin à savoir dans quelle mesure ces idées pascaliennes regardant le pari, la coutume et l’imitation peuvent être mises en rapport avec l’idée de l’humanité telle qu’elle apparaît dans le récit Si c’est un homme. Ce qui rapproche les deux auteurs, c’est précisément l’importance qu’ils accordent à la dignité humaine et à la notion du modèle.
Ainsi, les personnages qui s’efforcent de maintenir leur dignité humaine au sein du camp de travail (comme par exemple Steinlauf) pourraient être considérés comme une sorte de joueurs pascaliens : dans un univers radicalement inhumain, ils réussissent à se présenter comme des hommes dignes de respect. Ce défi semble énorme et presque insurmontable, vu l’arbitraire absolu qui décide de leur destin. « Je regardai autour de moi », écrit Levi, « et me demandai combien, parmi cette misérable poussière humaine, seraient frappés par le destin »[28]. Il semble que certains échappent à cette poussière humaine, en résistant contre le non-sens et l’indifférence propre au camp de travail. Tout comme les autres prisonniers, ils exécutent les rituels vains qui leur ont été imposés par les allemands. Or, leur façon de s’ajuster aux règles du camp n’est pas celle d’une obéissance aveugle, mais témoigne d’un désir profond de maintenir leur dignité et de résister au non-sens exprimé par ces règles.
Pour Levi, ce sont précisément ces personnages qui constituent les vrais modèles de l’humanité : ils vivent « comme si » leur humanité est demeurée intacte, en exécutant certains rituels apparemment vains et ridicules (se laver dans de l’eau sale et froide), mais nécessaires pour ne pas perdre les dernières traces de civilisation et de dignité humaine. En adoptant telle manière de vivre, ils incitent leurs compagnons d’infortune à prendre la même attitude. Tel semble être le seul moyen pour maintenir l’humanité à travers toutes les menaces d’inhumanité au sein du camp d’Auschwitz. Citons par exemple la description de Levi de son ami Alberto : « Je vois en lui le rare exemple de l’homme fort et doux, contre qui viennent s’émousser les armes de la nuit[29] » ou bien de Lorenzo : « Mais Lorenzo était un homme : son humanité était pure et intacte, il n’appartenait pas à ce monde de négation. C’est à Lorenzo que je dois de n’avoir pas oublié que moi aussi j’étais un homme[30]. » Le fait d’adopter un mode de vie semblable à celui des personnages comme Alberto, Steinlauf ou Lorenzo constitue la seule condition pour ne pas appartenir à cet univers qui a pour règle : « Hier ist kein Warum[31]. »
Curieusement, cette idée occupe une place centrale dans le fragment Infini Rien de Pascal où il s’agit d’exécuter les coutumes propre à la religion chrétienne et de faire comme si on fait partie de cette communauté qui a reçu la grâce divine. Le fait même de s’ajuster à ces coutumes révèle une volonté profonde d’exister en tant qu’humain, même si son existence est sans cesse menacée par le non-sens et le manque de dignité. Dans ce contexte, Pascal a recours au verbe « s’abêtir » : l’homme regagne sa dignité en menant une vie soumise et consacrée à une réalité qui le dépasse infiniment. Afin de retrouver son humanité, il faut refuser de consentir à la vanité et à l’insignifiance de sa condition. Ce refus ne consiste d’ailleurs pas dans une résistance explicite contre toutes les règles imposées, mais consiste à adopter une certaine attitude conforme à sa situation. Telle attitude correspond d’une part à une reconnaissance de son impuissance face à l’arbitraire de sa condition, mais d’autre part à un désir de vivre humainement malgré l’inhumanité de l’état dans lequel on se trouve. Ce désir de vivre constitue le seul remède contre la résignation aveugle à l’existence anonyme propre aux autres prisonniers qui sont devenus entièrement indifférents à leur condition.
À la fin de son récit, Levi permet au lecteur de croire que la forme de l’humanité l’a emporté sur l’inhumanité du camp. Au moment où les officiers allemands étaient partis, les prisonniers commençaient à partager le pain entre eux. Quelques jours avant, ce geste aurait été impensable : la distribution du pain ne faisait alors qu’encourager le désir égoïste de satisfaire son propre intérêt. Ainsi, dans le cas où l’on offrait du pain à son prochain, on le faisait dans l’intention calculée de recevoir quelque récompense. En effet la vie économique qui avait cours auparavant dans le camp était entièrement marquée par de tels actes calculés et intéressés. Or, le geste « humain » qui s’effectue après que les Allemands avaient quitté le camp, était le signe que la relation à autrui n’était alors plus de l’ordre d’un calcul, mais qu’elle devenait ou redevenait un rapport authentique où l’autre était conçu dans son humanité :
« La loi du Lager disait : “mange ton pain, et si tu peux celui de ton voisin” ; elle ignorait la gratitude. C’était bien le signe que le Lager était mort. Ce fut là le premier geste humain échangé entre nous. Et c’est avec ce geste, me semble-t-il, que naquit en nous le lent processus par lequel, nous qui n’étions pas morts, nous avons cessé d’être des Häftlinge pour apprendre à redevenir des hommes[32]. »
Hanna Vandenbussche
Centre Georges Chevrier
UMR 7366 uB/CNRS
(Sous la direction de Pierre Guenancia
et Roland Breeur)
[1] P. Levi, Si c’est un homme. Traduit de l’italien par Martine Schruoffeneger, Paris, Éditions Julliard, 1987, p. 270.
Pour citer cet article :
Hanna Vandenbussche, « Levi et Pascal sur la question de l’humanité », Revue TRANSVERSALES du Centre Georges Chevrier - 8 - mis en ligne le 28 avril 2016.
URL : http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/publications/transversales/Entre_confrontation_reconnaissance_rejet/H_Vandenbuss
che.html
Auteur : Hanna Vandenbussche
Droits : © Tous droits réservés - Ce texte ne doit pas être reproduit (sauf pour usage strictement privé), traduit ou diffusé. Le principe de la courte citation doit être respecté.