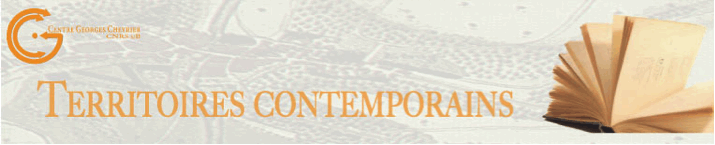
Festivals de cinéma et politiques culturelles dans l'Europe de la guerre froide : diversité des enjeux et des acteurs
De la sortie de la Seconde Guerre
mondiale au tournant des années 1960, toute une première série de festivals vit
le jour en Europe, aussi bien à l'ouest qu'à l'est du continent, autour de
manifestations artistiques diverses (théâtre, musique, danse...). Il est
important pour l'histoire des relations culturelles internationales de cette
période d'étudier une telle dynamique en cherchant, au-delà de simples
monographies, à repérer les interactions entre festivals – que ce soit
les effets d'opposition, de concurrence ou de dialogue, mais aussi de
circulations, y compris de part et d'autre du rideau de fer
[1]
. Cette contribution
souhaiterait revenir plus précisément sur la diversité des acteurs, publics,
privés, officiels et officieux, mobilisés dans le développement du phénomène
festivalier, étudié ici dans le domaine du cinéma.
Véritables tribunes où le film
est tout à la fois objet d’art, vecteur idéologique mais aussi produit
industriel, les festival internationaux de cinéma permettent en effet de se
pencher plus largement sur la question de la place de la culture et des politiques
culturelles en Europe du temps de la guerre froide
[2]
. L'importance des
enjeux politiques, mais aussi économiques et commerciaux de ces festivals dans
le contexte spécifique de fortes tensions diplomatiques internationales sera
plus précisément au cœur de cette étude, sans oublier la dimension artistique
et créative. L’histoire de la première vague de naissances de festivals
jusqu'au tournant des années 1960 révèle combien perspectives locales,
nationales et internationales, voire transnationales, se croisent, dans un jeu
d’échelles spatiales et temporelles (Jacques Revel) qui a pour ambition
d'éviter une histoire trop monolithique des débuts de la guerre froide et des
confrontations culturelles en Europe. De même, une lecture trop étatique des
politiques menées dans le domaine des festivals de cinéma ne saurait rendre
compte de l'influence de certains milieux professionnels à l'exemple des
producteurs, européens ou non, sur la naissance et l'évolution des principaux
festivals internationaux de la période.
Les festivals internationaux de cinéma et le renouveau culturel européen
après 1945
De la Libération jusqu’à la fin des années 1950,
l'Europe tente de relancer ses activités et sa production culturelles. La forme
festivalière s'avère correspondre à de tels objectifs, répondant clairement à
des mécanismes obéissant d’une part aux enjeux politiques nationaux et
internationaux des débuts de guerre froide, mais aussi, d’autre part, à une
logique de concurrence économique internationale où les Etats jouèrent un rôle
non négligeable, sans pour autant être les seuls initiateurs. En témoignent le
champ du cinéma et la première vague de création de festivals.
Ce fut, on le sait, dans un contexte de tensions
diplomatiques très vives, en réaction au festival de Venise, la Mostra créée
sous le régime fasciste en 1932, et devenue la vitrine de la politique
culturelle de l'Axe Rome-Berlin, que s’imposa dès 1938 l’idée de créer en
France un festival qui deviendrait le lieu d'expression des démocraties et de
leurs productions cinématographiques
[3]
. Ce sont les
pouvoirs publics français qui lancèrent ce projet de « festival des
démocraties », coordonné par l'Association française d'action artistique
(AFAA) rattachée au secrétariat d'Etat aux Beaux-Arts et au ministère des Affaires
étrangères et dirigée par Philippe Erlanger à partir de 1938. La ville de
Cannes, haut lieu du tourisme international, notamment anglo-saxon, et située
dans une région traditionnelle de production cinématographique (notamment à
Nice), devait accueillir le futur festival en septembre 1939
[4]
. Les soutiens
locaux et régionaux, très favorables à l'organisation d'un tel événement qui ne
pouvait que profiter à la vie économique, furent importants et la ville
concurrente, Biarritz, fut finalement éliminée.
Guerre oblige, il fallut cependant attendre le 20 septembre 1946 pour voir
s’ouvrir le premier festival de Cannes. Dès novembre 1944 le projet avait été
relancé, avec le soutien toujours actif de l'Etat et du ministère des Affaires
étrangères. Philippe Erlanger reprit en effet ses fonctions au sein de l'AFAA,
toujours sous tutelle du Quai d'Orsay, et le projet de festival fit partie de
ses priorités. Détail non négligeable, Suzanne Borel, l'une de ses proches
collaboratrices et première femme diplomate française
[5]
, épousa en décembre
1945 Georges Bidault, qui fut lui-même ministre des Affaires étrangères de
septembre 1944 à juin 1948. Le festival disposait ainsi à divers titres de
soutiens d'importance au sein de l'Etat français. Autre organisme jouant un
rôle essentiel, le Centre national de la cinématographie, créé à la suite de la
loi du 25 octobre 1946 qui plaça le nouvel organisme professionnel sous la
tutelle du ministère de l'Information. Il finança très largement le festival de
Cannes.
Certes, l'enjeu n'était plus de combattre la propagande fasciste italienne,
mais le jeune festival français trouva un nouveau défi à relever dans la
volonté de relancer l’économie cinématographique et la vie cultuelle en Europe.
En 1966, à l'occasion des 20 ans du festival, Philippe Erlanger rappelait ainsi
l'objectif premier du festival, « faire de la Côte d'Azur le Hollywood
européen ». Il regrettait cependant, que, faute de moyens, il n’ait pas
été possible de « dépasser le stade du projet, pour le plus grand profit
de Cinecitta »
[6]
. Certes, le
cinéma américain devint la référence constante après 1945 pour les
organisateurs de Cannes, mais l'Italie, ses studios de Cincecitta, et Venise représenta
longtemps la concurrence immédiate. A la suite d'un compromis avec Cannes, Venise
organisa ainsi un festival de transition fin août-début septembre 1946 avant de
reprendre véritablement en 1947. La Mostra aurait même souhaité que les deux
festivals aient lieu en alternance un an sur deux. En 1951 un compromis fut
enfin trouvé, après de longues négociations entre les différentes parties
concernées : Cannes s'ouvrit au printemps, pour se distinguer de Venise
qui resta fin août
[7]
. On voit ici la
mise en place d'un partage des rôles à l'échelle internationale.
Juste avant Cannes, en août 1946, avait eu lieu plus à l’est, en
Tchécoslovaquie, le véritable premier festival international de cinéma en
Europe depuis 1945, dans deux villes d'eau, Marianske Lazne et Karlovy Vary,
qui avaient le précieux avantage, dans un pays encore non reconstruit, de
disposer de suffisamment de logements et de chambres d'hôtel pour les invités
et participants
[8]
. La volonté
d’offrir une large tribune à la production cinématographique tchécoslovaque
nationalisée en 1945 avait encouragé le jeune gouvernement démocratique à créer
cet événement, lui aussi étatique, comme Cannes. Au cours de l’année 1947 les
tensions de plus en plus fortes entre les Alliés aboutirent cependant aux
débuts de la guerre froide et à la division de l’Europe. En février1948, le
coup d'Etat de Prague amena au pouvoir les communistes. Un an plus tard, le
festival, qui se tenait désormais à Karlovy Vary uniquement, se vit formaté
selon les exigences idéologiques officielles : il devait désormais servir
de vitrine non plus tant à une production culturelle et cinématographique
nationale, mais à l’ensemble du bloc de l’Est. « Pour un nouvel individu,
pour un monde plus parfait » puis « Vers des relations plus sincères
entre les peuples, et une amitié durable entre les nations » furent les
nouvelles devises du festival, dont le contrôle par l'Etat se trouva confirmé.
Le festival de Locarno qui vit le jour ce même été 1946, le 23 août, obéit,
lui, à une autre logique que Cannes ou Karlovy Vary
[9]
. Pour ses fondateurs,
dont Vinicio Beretta, né en 1920 à Lugano, rédacteur et critique
cinématographique, journaliste à la radio suisse italienne, la manifestation
était tournée plutôt vers le cinéma italien et un public italien. La proximité
géographique et linguistique du comtat du Tessin avec l'Italie couplée à la
volonté de rendre hommage à la production néo-réaliste de l'époque expliquent
cette direction première prise par Locarno, qui se distinguait ainsi des autres
festivals créés au même moment par des Etats soucieux de mettre en scène leur
production nationale, pour des raisons politiques et commerciales. L'été s'avère
la période favorite de ces premiers festivals, signe de l'importance
touristique liée à leur création : en août 1947 le festival de cinéma
d'Edimbourg vit ainsi le jour à son tour, dans le cadre plus large du Festival
international de la ville. Là aussi ce fut non pas une initiative étatique,
mais des cinéphiles et une association, la Edinburgh Film Guild, créée
en 1930, en concurrence avec celle de Londres, qui fut à l'origine de la
manifestation, consacrée alors à la promulgation et à la diffusion des films
documentaires, britanniques, mais pas uniquement
[10]
. Il s'agissait de
rendre hommage notamment à l'œuvre de John Grierson notamment ou de Paul Rotha,
encore associés à la mobilisation du temps de la guerre. Dès 1950 cependant la
programmation s'ouvrit à la fiction et par conséquent à un public plus
large : la production documentaire n'était désormais plus suffisante pour
nourrir une programmation annuelle de qualité
[11]
.
Dans ces deux derniers cas, la forme festivalière visait ainsi à offrir une
tribune, la plus attractive possible, et une chance de diffusion internationale
à une certaine production cinématographique, dans une perspective non étatique.
La dimension artistique du festival de cinéma se trouvait ici au cœur même du
projet originel.
Les festivals dans les politiques
culturelles de guerre froide
En 1951, la naissance du festival de Berlin-Ouest offrit à son tour
l'exemple d'une manifestation créée sur l'impulsion d'acteurs publiques et
privés locaux, mais également d'acteurs étrangers et avant tout soucieux de
positionner le festival au sein de l'Europe de la guerre froide. L'enjeu
diplomatique prit le pas sur l'enjeu artistique.
Ce fut en effet avant tout sous l'influence d'un contexte diplomatique
international de plus en plus tendu qu'eut lieu en juin 1951 la première
édition de la Berlinale dans une volonté commune d’empêcher l’isolement
politique et économique de Berlin-Ouest, symbole de l’Allemagne divisée. Il
fallait pour cela garder à tout prix des contacts avec la scène culturelle
internationale.
[12]
Les autorités
municipales ne pouvaient en effet que constater combien la ville avait perdu
son statut de capitale internationale du cinéma dont elle bénéficiait dans
l'entre-deux-guerres et que l'économie cinématographique allemande se trouvait
dans une crise profonde
[13]
. Or au sein de
l'Administration des forces d'occupations américaines, Oscar Martay, l'officier
chargé du cinéma, décida de soutenir activement les salles de cinéma et la
production cinématographique ouest-allemande et réussit à réunir les fonds
nécessaires pour lancer le festival, avec l'appui de producteurs américains
conscients de l'enjeu politique et commercial que représentait la RFA
[14]
. Au printemps
1950 un journaliste ouest-allemand, Manfred Barthel, proposa en effet
d'organiser à Berlin-Ouest, sur le modèle de Cannes, une « Olympiade du
film », en référence explicite à « celles de Venise, Locarno,
Bruxelles ».
[15]
La date de juin
fut retenue pour que la Berlinale ait lieu avant d’autres festivals prévus à
Cologne ou à Munich : la concurrence nationale était en effet très vive
dans un pays divisé et occupé où était en train de se redéployer la géographie
culturelle d'une région à l'autre. Le gouvernement fédéral de Bonn ne fut
d'ailleurs pas à l'origine de ce projet dont il se méfia dans un premier temps.
Au niveau international, l'enjeu était de ne pas avoir lieu à une date trop
proche de Venise, qui se déroulait, comme on l'a vu, fin août-début septembre.
Il fallait en outre se positionner par rapport à l'Est et à la RDA et notamment
faire contrepoids au Festival mondial de la jeunesse qui était prévu à
Berlin-Est pour l’été 1951. Enjeux locaux, nationaux et internationaux se
mêlèrent ainsi pour présider à la naissance d'un festival étroitement lié aux
politiques culturelles des Européens de l'Ouest et des Etats-Unis au cœur des
tensions de guerre froide.
Dernier de cette première vague de naissances de festivals internationaux
de cinéma en Europe après 1945, le festival de Moscou fut relancé en août 1959
par les dirigeants soviétiques
[16]
. Un premier
festival avait eu lieu, mais à une seule reprise, en 1935
[17]
. Organisée par le
ministère de la Culture et par l'Union des cinéastes, la manifestation
s'inscrivait clairement dans la politique culturelle de l'Etat soviétique,
soucieux, après la mort de Staline, de renouer des relations avec l'Ouest. Dans
cette période dite du dégel, la production culturelle y compris
cinématographique, alors en plein essor et renouveau, justifiait pleinement la
mise en place d'une telle vitrine internationale dans la capitale soviétique
[18]
. Réalisateurs,
producteurs, acteurs, journalistes et critiques cinématographiques de l'Ouest
comme de l'Est furent invités à Moscou et Nikita Khourchtchev lui-même ouvrit
le festival sous le signe de la « Lutte pour la paix » dans un
discours tenu devant 15 000 personnes réunies dans un stade de la ville. Mise
en scène idéologique et ouverture internationale allèrent de pair pour cette
première édition.
Dans le complexe système d’instrumentalisation de l’image du temps de la
guerre froide
[19]
, les festivals
internationaux apparaissent ainsi comme des rouages importants au sein des
relations diplomatiques et des politiques étatiques culturelles à l'Ouest comme
à l'Est. La politique des invitations et de la programmation des différents
festivals l'illustre clairement. Ainsi, exemple bien connu, à Cannes, seuls
pouvaient être invités les pays reconnus diplomatiquement par Paris
[20]
. Le règlement
interdisait en outre tout film pouvant « atteindre au sentiment
national » d'un pays invité – formule floue et qui se traduisit par
des incidents diplomatiques comme l'interdiction de projeter en 1956 le film
documentaire d'Alain Resnais, Nuit et brouillard, en sélection
officielle – sous prétexte de refuser de risquer de blesser les
représentants de la RFA. Projeté hors programme il connut cependant le succès
que l'on sait
[21]
. Par le jeu de
concurrence et d'écho entre festivals, il eut en outre sa revanche à Karlovy
Vary en 1957 où il gagna le grand prix du documentaire. Le maire de
Berlin-Ouest Willy Brandt organisa de son côté une projection hors compétition,
mais à l'occasion de la Berlinale. A la suite de cet événement, le règlement de
Cannes fut en partie modifié, même si ce fut en 1972 seulement que le Comité
d'organisation se déclara le seul décideur concernant la liste des films
invités, et non plus le Quai d'Orsay ni les gouvernements ou pays invités. La
Berlinale, elle, n'invita des représentants des pays communistes qu'à partir de
1974, suite à de longues négociations. Le caractère international des festivals
de la période se trouvait de fait fortement relativisé par ces contraintes
diplomatiques fortes
[22]
.
Les producteurs, arbitres des
politiques festivalières ?
Les rapports de force entre l'Est et l'Ouest, mais aussi au sein de chaque
bloc, reposèrent également, durant
la période qui nous concerne, sur des questions économiques, elles-mêmes bien
entendu étroitement liées aux enjeux politiques de guerre froide. Les
politiques culturelles en œuvre au sein des festivals internationaux de cinéma
ne firent ici nullement exception. Les Etats se virent ici concurrencés, voire
relayés, par d'autres acteurs. En témoigne le rôle joué par les producteurs au
sein des relations et circulations internationales dans le domaine des
festivals de cinéma
[24]
.
Il n'est ainsi pas anodin que ce fût à l'occasion du festival de Venise en
août 1950 que se tint le premier « Congrès international des Producteurs
cinématographiques » de la Fédération internationale des associations de
producteurs de films (FIAPF)
[25]
. L'enjeu était
clair : réunir différentes associations de producteurs « tant en
raison de la crise mondiale que de la nécessité pressante de mettre au point
les rapports entre producteurs et collaborateurs de création, et ceci dans
chaque pays respectifs aussi bien que sur le plan international
[26]
». La
politique suivie par la Fédération en ce début des années 1950 souhaitait
ainsi mettre en place une
« économie générale du cinéma basée sur des accords internationaux ».
Il s'agissait bel et bien de mettre en place un nouvel ordre international dans
le domaine du cinéma – avec pour modèle le travail de l'UNESCO notamment,
qui, en retour, voulait symboliser une circulation culturelle internationale.
Les festivals apparaissaient comme des relais essentiels de ce projet, à la
fois comme lieux de sociabilité (où l'on pouvait se réunir, échanger,
débattre), mais aussi comme lieux de distribution et de commercialisation des
films.
De fait, le festival de Cannes inaugura, à la différence de Venise par
exemple, sa première « Exposition- marché du film » dès septembre
1950, en parallèle à la compétition officielle, avant de lancer en 1959 le
Marché du Film à proprement parler, qui réunit dans un même lieu les
professionnels français et étrangers
[27]
. Cette dimension
économique du cinéma et son intégration au festival fut revendiquée par Favre
le Bret, délégué général du festival, qui se félicita de la présence ainsi des
producteurs et professionnels du domaine à Cannes, en écho à Philippe Erlanger.
Selon ce dernier, Cannes, en 1966, avait prouvé une fois encore qu'il restait
« pratiquement le seul grand rendez-vous du cinéma mondial. L'exemple de
Venise [était] là pour prouver à quoi il serait réduit s'il n'était plus qu'une
sorte de ciné-club
[28]
». Le
jugement porté par Philippe Erlanger sur la Mostra ne saurait néanmoins faire
oublier la présence dès les débuts du festival italien, qui ne fut nullement
une initiative gouvernementale au départ, des producteurs y compris américains
[29]
. De fait, la
politique festivalière menée en Europe ne dépendit pas que d'acteurs européens.
Les débuts de la guerre froide
influencèrent fortement la politique menée par la FIAPF dont l'équilibre
interne connut un important changement. A l'occasion de l'Assemblée générale de
septembre 1951 les producteurs américains entrèrent en effet au sein de la
Fédération. Ils y étaient représentés par un acteur aussi bien économique que
diplomatique de première importance : l'Association Américaine des
producteurs et distributeurs de Films (Motion Picture Producers and
Distributors of America, MPPDA). Cette adhésion fit de la Fédération celle
« de la production cinématographique du Monde Libre », selon les
termes des journalistes du Film Français
[30]
. Sur les 22 pays
représentés en 1951, on en comptait 13 européens – en plus de la Turquie,
d'Israël, de l'Egypte, de l'Inde, du Pakistan, du Japon, et du Mexique ou de
l'Argentine – sans oublier
les Etats-Unis. Aucun pays d'Europe de l'Est n'y était représenté.
La MPPDA, créée en 1922, était
rapidement devenue un acteur à part entière de la politique culturelle
extérieure des Etats-Unis : « la seule entreprise des Etats-Unis qui
négocie directement avec les gouvernements étrangers » selon Jack Valenti
qui en prit la tête en 1966. De 1945 à 1963, ce fut de fait Eric Johnston qui
la présida. Or il ne s'agissait nullement d'un homme issu du sérail des
professionnels du cinéma. Républicain, Eric Johnston avait été auparavant
président de la Chambre de commerce des Etats-Unis. De 1953 à 1956 Eisenhower
lui demanda de négocier un accord entre Israël et la Jordanie sur le partage
des eaux de la vallée du Jourdain. En homme très proche donc des plus hautes
instances politiques, il fut désigné notamment pour ses capacités de
négociation, malgré des positions politiques très claires : le 2 novembre
1947, il fut à l'origine de la liste noire à Hollywood dans le contexte de la
commission contre les activités antiaméricaines. Et en 1951, il décida donc
d'engager la MPAA dans la FIAPF. D'une fédération internationale, la FIAPF
devint une arme dans le contrôle par les Etats-Unis de la politique culturelle
menée en Europe dans le domaine cinématographique.
La FIAPF décida d’établir une
hiérarchie entre les festivals, qui furent divisés entre quatre catégories,
pour tenter de limiter leur expansion
[31]
. Il s’agissait ainsi
de réguler la concurrence entre les festivals, mais aussi leur répartition géographique
et stratégique. La catégorie A comprenait les plus grands festivals, répondant
aux critères politiques et économiques suivants : envoyer les invitations
par voie diplomatique, programmer des films encore inédits en Europe, organiser
une compétition internationale avec un jury international. La FIAPF disposa
ainsi d'un instrument pour contrôler l'expansion géopolitique des festivals de
part et d'autre du rideau de fer, dans la seule optique du « Monde
libre ». Le festival de Moscou en subit les conséquences : le Kremlin
dut tenir compte de la FIAPF, dominée par les pays de l’Ouest, et sans qui le
festival ne pouvait espérer accueillir les stars et les films occidentaux, et
qui décréta qu’un seul festival de fiction pourrait prétendre à la catégorie A
à l’Est. Or depuis 1956 Karlovy Vary détenait ce privilège. C’est pourquoi
Moscou dut imposer, comme seule solution, à Karlovy Vary d’avoir lieu en
alternance avec lui, tous les deux ans, et de se partager ainsi le prestigieux
statut de festival A
[32]
.
Ce compromis témoigne des
tensions internes provoquées par l'offensive culturelle de la guerre froide au
sein même de chaque bloc, et aussi de l’impact d’acteurs non étatiques comme la
FIAPF sur les politiques culturelles nationales. En outre, loin de démontrer le
caractère imperméable des relations entre l'Est et l'Ouest du continent, le
succès de la politique de contrôle exercée par la FIAPF témoigne bel et bien des effets de dépendance des
politiques festivalières de part et d'autre du rideau de fer et au sein d'un
même bloc.
A travers l'étude de la
période allant de la sortie de la Seconde guerre mondiale au tournant des
années 1960, et qui a vu naître les principaux festivals internationaux de
cinéma en Europe, est apparue toute la complexité d'une dynamique festivalière
mêlant une grande diversité d'acteurs répondant à des enjeux multiples. Les
politiques culturelles menées au niveau local (municipal notamment), régional,
national et international, étatiques ou non, se croisent, voire s'opposent,
d'un festival à l'autre. Toutes cependant souhaitent ainsi pouvoir s'inscrire,
par le biais de la forme festivalière, dans un mouvement de circulations et
d'échanges internationaux, et éviter tout provincialisme culturel, que ce soit
vis-à-vis des voisins européens, ou des Etats-Unis.
Les festivals semblent ainsi
être aux yeux de leurs initiateurs les manifestations les mieux adaptées pour
rendre compte des diverses fonctions du cinéma – artistique, politique et
économique. Espaces de mise en scène et de représentation étatiques
officielles, espaces de sociabilité entre professionnels, ouvert ou non à un
large public, espaces de diffusion et de commercialisation, ils s'avèrent de
fait des lieux d’observation de première importance pour cerner les multiples
aspects des politiques culturelles du temps de la guerre froide, et l’interaction de leurs acteurs.
Caroline Moine
[1]
Voir Moine
Caroline, « Les festivals internationaux de cinéma, lieux de rencontre et
de confrontation dans l'Europe de la guerre froide », dans Dulphy Anne,
Frank Robert, Matard-Bonucci Marie-Anne et Ory Pascal [dir.], Les relations
culturelles internationales au XXe siècle, Peter Lang, Bruxelles, 2010, p. 299-306. Pour citer cet article :
|