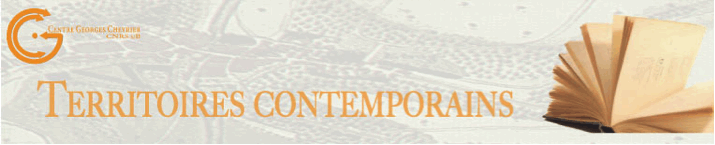
Observer les publics des festivals. Approche stratégique et renouvellement sociologique Si la naissance des grandes institutions culturelles, de la fin du XIXe siècle au début du XXe, est le fruit des changements qui ont affecté l’ordre politique, les festivals ont plutôt émergé depuis la sphère privée. Leur public, tel qu’il est dépeint dans la rare littérature qui en restitue l’histoire, avait tous les traits d’un monde à part, comme le collectif d’une grande famille et non celui, plus hétérogène, d’une société. A l’exception d’Avignon, la question des publics n’a pas été, historiquement, une préoccupation essentielle des festivals. Leur philosophie privative, tout comme leur statut d’exception événementielle, les aura tenus éloignés des perspectives de démocratisation culturelle, avant que leur nombre ne cesse de grandir au cours des années 1970. Avec cet essor, les festivals ont cessé d’être une exception dans le champ des politiques culturelles, pour en être l’un des instruments majeurs. En théorie, le festival est un événement singulier associant un lieu, une programmation, des rituels et l’ambition d’acquérir une renommée. En cela, les publics des festivals constituent une microsociété qui se forme et se déforme suivant un calendrier bien précis. En outre, chaque festival possède un dispositif original qui s’inscrit dans un contexte historique, territorial, institutionnel et culturel singulier. C’est sans doute en raison de ce dispositif que de nombreux travaux se sont consacrés à une seule institution. Cette approche, qui survalorise l’originalité putative de chaque événement, nous prive d’une vision globale des festivaliers. Nous avons privilégié la démarche inverse[2], en prenant en considération un nombre élevé de festivals, représentant une large palette d’esthétiques différentes. Après avoir mentionné les principaux aspects techniques de notre analyse, nous en donnerons quelques uns des résultats, d’abord, en précisant la sociologie des festivaliers et les modalités de fréquentation des événements, ensuite, en soulignant l’impact de certaines variables sur la physionomie des publics. D’ores et déjà, mentionnons que le fort renouvellement qui caractérise ces publics constitue l’un des principaux enseignements de notre étude. L’enquête a porté sur 49 festivals répartis sur tout le territoire, et s’est déroulée tout au long de l’année 2008. Les questionnaires ont été distribués à un minimum de 3 spectacles, représentatifs de la programmation de chaque festival. Au total nous avons recueilli, saisi et traité 23 344 questionnaires sur 207 spectacles. Ceux-ci se divisent en 6 catégories : musiques anciennes et baroques (20%) ; musique classique (33%) ; musique contemporaine 12%) ; jazz, chansons, variétés (10%) ; musiques actuelles et du monde (15%) ; danse contemporaine (10%). Tableau 1. Structure de l’échantillon
Pourquoi s'interroger sur les publics des festivals ? Deux réponses complémentaires au profit d'une troisième…Les publics des festivals sont intéressants à deux titres. Le premier est qu’il s’agit d’un instrument, comme nous l’avons dit, qui est sorti d’une certaine spécificité vis-à-vis des politiques culturelles, pour en devenir un instrument majeur. À ce titre, il renvoie à des stratégies qui s’inscrivent, ainsi que nous allons le voir, dans le cadre des politiques de démocratisation. La deuxième raison de cet intérêt, que ne recoupe pas tout à fait la première, est que les festivals et leurs partenaires considèrent aussi les publics comme une ressource capitale, à la fois en termes d’économie organisationnelle, mais surtout en matière de retombées économiques. Ce sont les deux points que nous allons développer dans cette première partie.
Compte tenu de l’importance de l’aide publique dans le secteur, les missions des festivals intègrent une partie des exigences des politiques culturelles : démocratisation, mobilité des publics, action en faveur des publics empêchés, sans parler du soutien à l’emploi culturel et artistique, ou en matière d’aide à la création. En matière de public, 3 stratégies apparaissent de manière récurrente : fidéliser ; renouveler ; accueillir des publics spécifiques. La stratégie de fidélisation des spectateurs repose sur deux piliers : une certaine convivialité pour favoriser l’immersion et la spécificité d’un festival ; et des formules d’abonnements attractives pour développer l’assiduité des spectateurs et les inciter à la découverte. L’efficacité de ces actions reste difficile à évaluer compte tenu du fort renouvellement et de la volatilité qui caractérisent la participation festivalière. Pour être efficace, cette stratégie doit arbitrer en permanence entre le soin apporté aux spectateurs fidèles et la conquête de « nouveaux fidèles ». La stratégie de renouvellement du public agit sur quatre leviers : les tarifs, le service d’information et de réservation, la programmation, et la décentralisation des spectacles. Si la tarification influence l’assiduité et le renouvellement, l’impact de la gratuité s’avère contreproductif, et bénéficie davantage aux spectateurs les plus familiers du festival. Si les médias ne jouent qu’un rôle mineur dans la motivation des spectateurs, ils contribuent incontestablement à asseoir la notoriété d’un festival. En outre, le développement d’Internet rend aujourd’hui ce média incontournable dans l’offre de services de tout festival, y compris pour pénétrer les réseaux sociaux. L’impact de la diversification de la programmation est d’autant plus délicat à analyser qu’il divise les directeurs autour de la question de la cohérence artistique. Enfin, si la décentralisation de spectacles a sans doute contribué à renouveler les publics des festivals, l’institutionnalisation de cette pratique a aujourd’hui fidélisé son public. Les stratégies de développement de publics spécifiques (scolaires, handicapés, personnes relevant d’un suivi social particulier…) exigent des moyens importants et une action dont la durée dépasse celle du festival. Plus rares, ces stratégies recouvrent des modalités diverses : master classes, stages, rencontres avec des artistes, programmes d’éducation artistique, formation aux métiers du spectacle… Au-delà des limites imposées par les moyens humains et financiers, les difficultés majeures que rencontrent les festivals sont d’ordre conjoncturel. La durée limitée des festivals ne leur offre pas la possibilité de déployer des dispositifs pérennes d’accompagnement des publics même si certains parviennent à développer une action culturelle à l’année. En outre, si toutes ces actions collectives aspirent à faire émerger une pratique individuelle de spectateur, leur impact reste difficile à mesurer. Bien sûr, toutes ces stratégies se déclinent différemment suivant la volonté des équipes et les moyens dont elles disposent. Or, la professionnalisation des équipes festivalières demeure limitée, et leur dépendance à l’égard du bénévolat encore importante. En dépit de leur généralisation, les stratégies de publics restent donc encore un chantier ouvert.
Notre étude a pu également quantifier les retombées directes et indirectes des festivals. En laissant le soin aux personnes interrogées d’indiquer la nature et le volume de leurs dépenses (billetterie, restauration, hébergement et achats divers), nous avons pu estimer les retombées indirectes. Nous avons ensuite évalué les retombées directes à partir des dépenses des festivals en matière d’administration, de frais techniques, de communication, de transport et d’hébergement, ou de dépenses artistiques. Nous n’avons pas souhaité aborder les retombées induites, dans la mesure où les ratios généralement utilisés pour ce type de calcul s’avèrent trop aléatoires et peu fiables. Au final, 1 € de subvention publique génère, en moyenne, 6,6 € de retombées totales. Toutefois, et compte tenu de l’importance des contrastes entre événements, ce résultat ne peut sérieusement tenir lieu de critère de soutien public à tel ou tel festival. Un examen ultérieur montre d’ailleurs que la mise en regard du classement de nos festivals en termes de retombées économiques, d’une part, et en évaluation artistique, d’autre part, conduit à deux constats. Le premier est attendu : la « valeur économique » d’un festival n’est pas en cohérence avec sa « valeur artistique ». Le second constat est que les deux critères, qui ne sont pas cohérents, ne sont pas pourtant inversement proportionnels. Autrement dit, ce n’est pas parce qu’un festival produit beaucoup de retombées économiques qu’il est « nécessairement » moins bien évalué du point de vue artistique ; et réciproquement : un festival produisant peu de retombées économiques n’est pas automatiquement un événement de haute valeur artistique [3]. Si l’on s’intéresse de façon croissante aux publics des festivals, c’est donc parce qu’ils sont devenus des instruments stratégiques du double point de vue des politiques publiques et du développement économique. Mais cet intérêt en croise nécessairement un autre, qui concerne la contribution d’une telle étude à la connaissance des publics de la culture. Avec un échantillon aussi massif que celui que nous avons pu réunir, il était en effet possible de mettre en perspective nos observations et celles conduites depuis plus de trois décennies désormais sur les pratiques culturelles des Français[4]. C’est ce que nous allons faire dans la seconde partie. Les festivaliers : sociologie, pratiques, renouvellementMême si les caractéristiques sociodémographiques des festivaliers connaissent de nombreuses variations suivant les festivals et les spectacles, il est possible d’en dresser un portrait global. Sans surprise, la sociologie des festivaliers rappelle celles des pratiques culturelles des Français : une majorité de femmes (59,7%) et une domination des fractions supérieures les mieux formées de la population (58% de cadres et de professions intellectuelles ; 71,6% de diplômés de l’enseignement supérieur). En revanche, et contre certains présupposés, ce sont les actifs qui dominent (53,6%). Les retraités arrivent en deuxième position (31,7%), suivis des étudiants et des élèves (9,0%). L’âge moyen se situe autour de 50 ans. En surreprésentant les populations disposant d’un capital culturel supérieur, ces résultats confirment le caractère inégal de l’accès à la culture. Cependant, de fortes différences émergent entre festivals dont certains offrent un profil radicalement opposé à cette tendance générale. Plus que jamais, c’est donc au pluriel qu’il faut parler des publics de festivals.
L’observation des différentes modalités de la fréquentation des festivals fait voler en éclat l’image d’Epinal du festivalier, hyper-spécialiste, venu de loin et qui participe rituellement à une pléiade de spectacles de son goût. Tout d’abord, la sortie au festival n’est pas systématiquement installée dans un rituel puisque 39% des spectateurs viennent pour la première fois. Ensuite, avec une moyenne de 1,5 spectacle, l’intensité de la pratique festivalière reste modeste, et c’est la participation ponctuelle qui domine (39%). Cette sortie s’effectue essentiellement en couple (40%) ou entre amis (28%). Plus rare, la sortie en famille (17%) n’en est pas moins présente. En outre, si la connaissance préalable des œuvres ou des artistes programmés est majoritaire (72%), elle doit aussi faire avec une proportion non négligeable (28%) de spectateurs qui viennent assister à un spectacle dont ils ignorent tout. Cette part de spectateurs curieux nuance l’image du connaisseur qui pointerait derrière chaque festivalier. Mais, ils ne sont pas non plus ces consommateurs « omnivores » établis pour la durée de l’événement. Seuls 5% des spectateurs correspondent à ce profil. Il n’en demeure pas moins que la sortie au festival s’inscrit bien dans un système plus vaste de pratiques culturelles : 70% des festivaliers interrogés sont allés plus d’une fois au cours de l’année à une exposition, visiter un musée ou un monument historique, voir un film ou écouter un concert. Ils sont également 47,2% à être allés plus d’une fois au théâtre. Enfin, si les profils de goûts des festivaliers sont tranchés, certaines esthétiques opèrent des ponts entre spectateurs. Au prix d’une certaine hétérogénéité, musique classique, musique du monde et jazz fonctionnent ainsi comme des « carrefours de goûts ». Pour terminer, il faut souligner la proximité géographique du public puisque 70% des festivaliers habitent la région d’implantation du festival (30% la ville, 24% le département et 16% le reste de la région).
Les festivals de notre échantillon appartiennent à des genres musicaux et chorégraphiques différents. Certains d’entre eux proposent même une pluralité d’esthétiques qui peut aller du classique aux musiques actuelles en passant par le jazz ou la musique contemporaine. Cette diversité n’est pas sans incidence sur le type de public rassemblé. En premier lieu, on constate que certaines esthétiques renouvellent plus que les autres, notamment les musiques actuelles (63% de nouveaux), les musiques du monde (49%) et le jazz (46%). A l’opposé, celles qui renouvellent le moins sont aussi celles qui fidélisent davantage les festivaliers. En deuxième lieu, et conformément à la diversité de l’offre, il existe une pluralité de parcours. Deux logiques se distinguent notamment : une logique « exclusive » (où prime le caractère ponctuel, voire exceptionnel des sorties) pour les concerts de jazz, de musiques du monde, de musiques actuelles et de chanson ; et une logique « intensive » (plus de 15% de la programmation) pour les concerts de musiques savantes. Par ailleurs, l’impact des sociabilités n’est pas négligeable sur ces parcours. Si la sortie en couple s’impose, les spectacles de musiques actuelles et de musiques du monde se distinguent une nouvelle fois en favorisant la sortie entre amis. Les musiques du monde attirent également une proportion plus importante de familles. L’accompagnement est une question cruciale pour comprendre les carrières de festivaliers, notamment parce que cette dimension « sociale » de la sortie rivalise avec les considérations esthétiques. De ce point de vue, la programmation en elle-même n’explique par toutes les variations des modalités sociales de la participation festivalière. En troisième lieu, notre étude fait état d’une diversification du recrutement social des publics suivant les esthétiques. L’indicateur du diplôme distingue trois groupes : un groupe moyen composé des musiques classique, contemporaine et de la chanson ; un groupe plus ouvert aux personnes moins formées avec les musiques actuelles et les musiques du monde ; un groupe plus élitiste avec le jazz, le baroque et la danse. De leur côté, les catégories socioprofessionnelles nous informent que les classes populaires et moyennes sont majoritaires dans les concerts de musiques actuelles et de musiques du monde, et dans une moindre mesure, de chanson. La musique contemporaine fait office de genre médian où la répartition des classes sociales suit la répartition moyenne. Enfin, la danse, le baroque et le classique représentent les trois principales esthétiques où prédominent les publics issus des classes supérieures. Notons toutefois que, même dans ces cas, les classes moyennes sont également bien présentes.
Aujourd’hui la tarification pèse beaucoup dans la stratégie des festivals (cf. encadré). Si le prix moyen d’une place plein tarif se situe autour de 23 €, les grilles tarifaires des festivals restent très contrastées. Les spectacles gratuits ne représentent qu’une part minoritaire de l’offre (14%) dont l’impact doit être mesuré au regard des différents dispositifs dans lesquels elle s’inscrit. Soit, il s’agit d’une pratique récurrente et institutionnalisée ; soit il s’agit d’une pratique plus ponctuelle. Ces deux « situations de gratuité » n’ont pas le même impact. Dans le premier cas, elle construit un public d’habitués, dans le second, elle permet une certaine ouverture. Au final, si la gratuité ne s’impose pas comme un instrument universel de renouvellement des publics (mais parfois comme une « prime aux habitués »), elle contribue le plus souvent à un élargissement social de la fréquentation en favorisant l’accès aux classes populaires. En ce qui concerne les spectacles payants, il faut évoquer l’impact symbolique du prix. Dans la mesure où les artistes et les œuvres jouent un rôle déterminant dans la motivation des spectateurs, le prix agit de manière complexe sur la participation et le renouvellement des publics. On constate d’abord que les tarifs les plus abordables permettent aux moins connaisseurs d’assister à un festival pour la première fois. Mais pour les connaisseurs ou les fans, on voit aussi que le prix n’est pas un frein. Ce constat est toutefois à mettre en regard du profil sociodémographique des festivaliers. Le prix constitue davantage une barrière pour les foyers les moins favorisés tandis qu’il n’est pas limitatif pour les foyers les plus aisés. Toutefois, nous constatons un seuil au-delà duquel ne se retrouve qu’une minorité des publics : plus de 15% de la programmation et plus de 2 spectacles suivis.
Tout comme la tarification, la démultiplication des lieux de spectacles fait désormais partie des outils stratégiques des festivals avec la double ambition d’élargir l’audience et d’asseoir le rayonnement territorial de la manifestation. Au final, la diversité des situations empêche de produire des constats tranchés sur l’impact de cette politique. En effet, si une décentralisation récente attire davantage de nouveaux spectateurs, une décentralisation institutionnalisée, inscrite dans une offre récurrente, finit par capter un public d’habitués. Sur l’ensemble de l’échantillon, on constate une certaine indifférenciation du profil des publics par rapport à cette variable. Pas plus jeune ni plus local que la moyenne, le public des spectacles décentralisés semblerait anéantir la thèse d’un renouvellement des audiences par le fait d’aller à la conquête du public là où il se trouve. En réalité, à l’instar de la gratuité, tout dépend de la « situation de décentralisation » : lorsque le concert décentralisé est une première, il draine un nouveau public en masse. Lorsqu’il est rituel, il a produit son cercle d’habitués. Par ailleurs, n’oublions pas qu’une part non négligeable des publics de passage (nouveaux par excellence) est attirée par le « lieu phare » (souvent patrimonial) du festival.
Avec un taux de 39%, le renouvellement des publics de festival est un résultat majeur qui s’oppose à l’idée d’une réservation des événements et des équipements artistiques au profit des mêmes habitués. Toutefois, il n’était pas évident que ce renouvellement soit synonyme d’élargissement social ou générationnel (cf. tableau 2). En ce qui concerne l’âge, on constate un net rajeunissement des spectateurs toutes esthétiques confondues. Le rajeunissement le plus prononcé concerne la danse (alors que sa moyenne d’âge est légèrement supérieure à celle des musiques actuelles) tandis qu’avec une base plus jeune, le rajeunissement des publics de musiques actuelles est équivalent à celui des musiques savantes. Cette neutralisation du genre de spectacle se retrouve en ce qui concerne le renouvellement des publics. Toutes esthétiques confondues, il est plus soutenu chez les classes moyennes et populaires (et notamment chez les employés) tandis que l’essentiel des habitués se recrute parmi les classes supérieures. Même si les écarts restent modestes, le renouvellement s’accompagne donc d’un certain élargissement social du public. Par ailleurs, les modalités de pratiques des nouveaux venus sont également différentes, on y trouve davantage de spectateurs qui viennent entre amis, pour un seul spectacle, et pour écouter un artiste ou une œuvre qu’ils ne connaissent pas toujours à l’avance. Enfin, ces nouveaux festivaliers rassemblent davantage d’hommes, d’actifs aux revenus modestes, et d’étudiants. Tableau 2. Impact différencié du renouvellement sur plusieurs variables
A l’image de l’ensemble de nos résultats, la nature de ce renouvellement interroge les constats traditionnellement admis sur les publics de la culture. Les nouveaux venus témoignent de pratiques et de profils sociologiques relativement distincts des habitués. Par conséquent, même si les fractions de la population les mieux dotées en capital culturel dominent, le public des festivals est moins homogène qu’on pourrait le croire. Il laisse place à une relative diversité de trajectoires, de pratiques et de goûts, et peut donc aussi donner lieu à toute une palette d’instruments de politique culturelle. Aurélien Djakouane & Emmanuel Négrier [1] Ce texte
reprend, en y ajoutant quelques illustrations, une version publiée
antérieurement sous la forme d’un focus dans P. Poirrier [dir.], Politiques et
pratiques de la Culture, Paris, La Documentation Française, 2010
Pour citer cet article :
|
||